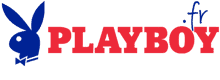March Hare 1965
Que reste-t’il de nos amours des années’60, ’70 et ’80 ? Faut-il les avoir vécues ! Si c’est le cas, elles furent libertaires et libertines, des termes définissant un positionnement de vie en dehors et en rupture avec “les normes” englobant la scène politicienne… et celle de la vie en société, car, pour le moins, il en allait d’être “politiquement incorrect” et de combattre l’ordre bourgeois tout en renversant le sens de l’opinion publique formatée par les “biens-pensants” qui, eux, s’accordaient à mettre anarchistes et libertaires dans le même sac. De nos jours, cette association de mots n’a rien perdu de sa pertinence pour les intéressé(e)s, même s’ils/si elles tiennent à préciser, comme ils/elles l’ont toujours fait, en quoi et pourquoi ces dénominations ne sont pas pour autant synonymes… L’anarchisme a pour dynamique et horizon l’auto-émancipation collective vis-à-vis des pouvoirs qui oppriment et exploitent, laquelle implique la libération des individus à l’égard des institutions, des normes et des croyances qui les aliènent. A l’extérieur des cercles restreints pour qui l’existence de l’Etat demeure plus que jamais attentatoire aux libertés qu’il est censé garantir, depuis quelque temps déjà, le couplage anarchiste-libertaire bat de l’aile ET ne va plus de soi. Il est devenu courant, parmi les politiciens, les intellectuels à gages et dans la presse dite “de marché” aux mains de milliardaires d’affaires, d’opposer de manière dichotomique, anarchiste et libertaire… D’un côté, l’anarchisme tend maintenant à remplacer le communisme défunt comme figure du mal aux côtés de l’intégrisme islamiste. De l’autre, l’épithète libertaire en est venue à constituer un label culturel et médiatique très prisé par toutes sortes de rebelles de confort pour enrober d’un vernis anticonformiste leur adhésion à l’ordre établi. Ce double processus de diabolisation et de neutralisation n’est, il est vrai, pas tout à fait nouveau. A l’aube du XXe siècle, l’anarchisme avait pu d’autant plus facilement être identifié au terrorisme, que la “propagande par le fait” menée en son nom, avait donné lieu, en Russie, en France et ailleurs, à des attentats aussi spectaculaires que meurtriers. D’une manière plus générale, l’anarchisme évoquera longtemps un chaos social nihiliste bien éloigné de cette conception de la vie en société que le géographe Elisée Reclus avait résumée en une formule : “L’ ordre sans le pouvoir”… Paradoxalement, l’anarchisme ne tardera pas à subir de la part de la critique mondaine une autre dénaturation langagière, mais dans une direction inverse, pour valoriser des artistes et des écrivains qui se faisaient fort de “bousculer les codes esthétiques bourgeois”. Ainsi en alla-t-il avec les protagonistes du “Mouvement Dada” puis de la “Révolution Surréaliste”, jusqu’aux turbulents cinéastes de la “Nouvelle Vague”, en passant par certains romanciers ou essayistes réactionnaires de l’après-guerre, se faisant passer pour des anarchistes de droite.
Par la suite, le qualificatif “libertaire” prendra la relève, notamment dans le domaine de la chanson (Georges Brassens, Jacques Higelin, Renaud) ou avec l’arrivée des écrivains sulfureux du “Néopolar Français” (Jean-Patrick Manchette, Frédéric Fajardie, Jean-Bernard Pouy). Dissociée d’un anarchisme relégué parmi les doctrines périmées de transformation sociale, l’appellation “libertaire” accompagnera une libération des mœurs et des esprits qui fera bon ménage avec la libéralisation de l’économie, au point d’accoucher de ce mutant oxymorique : le “libéral-libertaire”… Avant d’être érigée en concept, au sens publicitaire du terme, cette formulation fut une accusation lancée par un sociologue du Parti communiste français (PCF) pour fustiger l’avènement d’un “capitalisme de la séduction” à la fois répressif au plan social et permissif au plan sociétal, ce néologisme sera mis sur orbite idéologique un peu plus tard, ainsi que la dérive droitière de leaders de la révolte de mai 1968 qui ne retenaient plus de la révolution que celle des subjectivités. Le plus en vue n’était autre que Daniel Cohn-Bendit, revendiquant le stigmate de “libéral-libertaire”, il l’a transmué en logo valorisant, d’un réformisme écologico-social, qui lui permet depuis lors d’officier à plein temps au sein de l’establishment politico-médiatique en qualité de professionnel atypique de la représentation… C’est également sous l’enseigne libérale-libertaire qu’un autre rescapé de la “guerre de classes”, Serge July, lancera en mai 1981 la nouvelle formule du journal/magazine “Libération”, relooké pour être “résolument moderne”, le quotidien suivra une ligne inspirée, selon son directeur, par un double héritage : celui, libéral, des philosophes du siècle des Lumières… et celui, libertaire, des étudiants antiautoritaires de Mai 68. Entre ces deux périodes d’ébullition intellectuelle, un vide obscur, pour ne pas dire un trou noir, à l’instar des trous de mémoire du 1984 orwellien : un siècle et demi au cours duquel le mouvement ouvrier avait pris son essor et, avec lui, les idées et les idéaux qui l’avaient aidé à se développer… Autrement dit, l’anticapitalisme, qui n’était effectivement plus de saison au moment où la gauche gouvernante s’apprêtait à réhabiliter le marché, l’entreprise et le profit. De fait, c’est à qui parmi la “deuxième gauche”, enfin parvenue à imposer ses vues au sein du Parti socialiste (PS), hissera le plus haut la bannière libérale-libertaire. Au cours des années 1980, des “Fabiusiens” et des “Rocardiens”, regroupés dans l’association “Rouleau de printemps”, s’entendront, malgré leurs dissensions, à faire “Table Rose” d’un passé socialiste encombrant au profit de la “modernisation” de l’économie, avec la “rigueur” qu’elle imposait, compensée par l’éclosion libertaire de modes de vie créatifs et innovants, eux aussi libérés des archaïsmes et des pesanteurs d’une époque révolue.
Ce sera également l’avis d’Alain Minc, qui, entre une séance au conseil d’administration de Saint-Gobain et une autre à la Fondation Saint-Simon, usera et abusera dans ses prestations médiatiques de l’appellation libérale-libertaire pour dépeindre les délices d’un “Capitalisme soixante-huitard”... Au fil des années, marquées précisément par l’accentuation des inégalités, de la précarité et de la pauvreté, l’appariement libéral-libertaire va perdre peu à peu sa crédibilité, sans entraîner pour autant un re-couplage du libertaire avec l’anarchisme. Au contraire, la dissociation entre les deux ne fera que s’accentuer. Tandis que ce dernier se voyait de plus en plus criminalisé, avec la reprise des luttes fondées sur l’action directe en réaction à l’aggravation de la marginalisation de masse et au durcissement de la répression, la position, pour ne pas dire la pose libertaire, jouissait d’une vogue accrue au sein du complexe politico-médiatique. En témoigne l’aura grandissante du philosophe Michel Onfray, dont l’individualisme hédoniste et athée a pu faire illusion dans les milieux anarchistes, malgré son appétence publiquement assumée pour une gestion libertaire du capitalisme. Le laisser-faire des “Anars” à l’égard des appropriations plus ou moins indues dont le label “libertaire” fait l’objet, pourrait étonner. Il est vrai qu’eux-mêmes ne sont pas les derniers à l’apposer à des artistes ou à des œuvres qui ne dérangent plus guère que les réactionnaires avérés… Mais ils répondront que ce serait contrevenir aux principes auxquels renvoie ce label que de vouloir le convertir en marque déposée. Et, ajouteront-ils, les récupérations et détournements auxquels il donne lieu ne prouvent-il pas, après tout, que le combat libertaire gagne en popularité ? Sans voir qu’il perd beaucoup en radicalité critique une fois accaparé et absorbé par un culturalisme individualiste et dépolitisé. Dans ce registre, par l’entremise du sociologue Philippe Corcuff, passé du PS à la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) après un détour chez les Verts, la référence libertaire se retrouvera accouplée à son contraire, la social-démocratie, l’un des piliers les plus solides de l’Etat capitaliste. Olivier Besancenot, porte-parole du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), pour sa part, se réclamait de Rosa Luxemburg, mais aussi de Louise Michel et de l’anarchiste révolutionnaire Reclus. Il n’a pas hésité par ailleurs à accoler le qualificatif “libertaire” à un autre, moins compromis que “social-démocrate”, mais tout aussi antinomique, en se proclamant à la fois “Guévariste et libertaire”.... Or, si l’on peut savoir gré au “Che” d’avoir mené le combat anti-impérialiste au péril de sa vie, on chercherait en vain dans sa personnalité et son action une quelconque trace d’anti-autoritarisme… Cantonnée au mode de vie, la transgression participe du renouvellement du système. Cette vogue libertaire en France, y compris dans des milieux peu réceptifs aux formes de refus et de résistance que ce mot désigne d’ordinaire, contraste singulièrement avec la vindicte redoublée dont l’anarchisme fait l’objet, amalgamé à un vocable censé en souligner la dangerosité sous la forme d’une inquiétante mouvance anarcho-autonome apparue dans la prose policière.
Culturalisation tous azimuts d’un côté, criminalisation systématique de l’autre… à bien y regarder, cependant, il n’y a rien là qui doive étonner car les deux processus sont liés. Dans un contexte de restauration politique et idéologique, c’est à qui opposera le social, assimilé à l’embrigadement et à l’uniformisation, au sociétal, lieu de toutes les libérations, pour bien montrer que la soumission aux contraintes de l’économie n’implique aucun renoncement aux valeurs contestataires d’antan. Désormais préoccupé avant tout de son épanouissement personnel immédiat, le néo-petit-bourgeois libertaire rejettera toute perspective d’autoémancipation collective, perçue comme une menace contre la démocratie et l’Etat de droit. Cantonnée au mode de vie conçu comme style de vie, la non-conformité n’a donc plus de raisons de s’en prendre aux normes et aux codes officiels puisque leur transgression individuelle institutionnalisée, subventionnée et mercantilisée, participe maintenant du renouvellement de la domination capitaliste. En contrepartie, avec l’approbation, bruyante ou tacite, ou au moins avec le silence des bénéficiaires de ces libéralités, les gouvernants s’autorisent à interdire et à réprimer toute forme de lutte, tout comportement, voire toute parole, susceptible d’entraver cette domination… Et pour ce qui “nous” concerne en tant que (prenez-note ça peut servir en cas de procédures judiciaires) : “Néo-Révolutionnaires Automobiles”, peu enclins d’accepter le “Tout Electrique” et l’abandon obligé de nos si chers moteurs thermiques, particulièrement V8 et autres, ainsi que révoltés d’avoir vu peu à peu les Kit-Car’s et les Van’s et les Kustom’s et les Hot Rod’s et les Tuning’s… (j’en oublie), poursuivis comme des “Engins quasi criminels”, à tous le moins illégaux, donc interdits, c’est-à-dire considérés comme “hors-les-Lois”… Pfffffffff ! ChromesFlammes + GatsbyOnline est le survivant d’une extraordinaire épopée libertaire… qui étant maintenant 100% numérique, n’est plus aussi soumis aux diktats des affaires de presse, rongées par les coûts gigantesques de fabrication (le papier a triplé de prix, les frais de diffusion incluant les transports également) alors que les diffusions ont chuté parfois de 70% et que les mannes financières publicitaires se sont taries : Plus de pubs tabacs, plus de pubs alcools, plus de pubs vantant la puissance et la vitesse… Cerise sur le gâteux : la faillite du Groupe Michel Hommel (et d’autres) entrainant celle de divers commerces attachés à l’automobile “sportive”… C’est comme en temps de guerre, les populations doivent se contraindre et s’habituer pour survivre sachant que l’avenir sera “autre”... Que reste-t’il donc de nos amours des années’60, ’70 et ’80, lesquelles furent libertaires et libertines ? Ceux et celles d’entre-vous qui avaient la “vingtaine” dans les “autours-de la révolution de mai’68”, ont vu beaucoup de voitures en kit différentes basées sur VW arriver sur le marché de ces années bonheurs… Un soixante-huitard de 18 printemps à donc 74 ans en 2024… C’est tout moi… Voilà…
Lorsqu’est sorti en 1965, le “March Hare” qui est le sujet de cet article, j’avais 15 ans… Je n’avais alors jamais entendu parler, ni vu dans quelconque magazine, ce Kit Car qui pour cette époque était avant-gardiste… Je n’ai connu l’existence de celui-ci qu’il y a quelques semaines, lorsqu’un internaute américain abonné à ChromesFlammes/GatsbyOnline m’a communiqué par émail une annonce de vente d’une Volkswagen March Hare 1965, annoncée sur Hemmings au prix de 15.995 $, m’indiquant : “C’est certainement un changement de rythme par rapport à votre vieux Meyers Manx typique, et cette March Hare 1965 a au moins quelques goodies de moteur pour lui donner un peu plus de vitesse par rapport au flat Four Coccinelle standard. Est-ce suffisant pour mériter une plaque de vanité aussi audacieuse ? Seul le pilote pourra le vérifier, mais j’espère que la configuration agressive des pneus décalés n’est pas purement pour le spectacle. Cette voiture je l’avais répertoriée auprès d’un vendeur privé en Californie plus tôt cette année pour moins de 12 000 $ ; Maintenant, c’est chez un concessionnaire avec un léger ajustement des coûts. Combien paieriez-vous pour une voiture en kit rare comme la March Hare ? Et cela ressemble-t-il à un Hot Wheels pour vous ? En attente, encore bravo pour votre web-site que je lis facilement en américain grâce au traducteur incorporé, bravo, vous êtes le TOP. Amicalement : Ted Floyt”... Dernièrement, je m’inquiétais du désastre parmi les petits constructeurs de voitures étranges et celle-ci qui devient la curiosité du jour d’aujourd’hui portera probablement la médaille d’or “Top Maximum”. Nous ne pouvons pas la définir comme une voiture en tant que telle, puisqu’il s’agissait d’une voiture en kit basée sur la Volkswagen la plus connue, la Typ 1 ou Coccinelle, Käfer, Coccinelle, Vocho… Cette “Chose” en kit carrosserie ou peu importe comment vous voulez l’appeler, est donc la Volkswagen March Hare. Commençons par son nom, qui sonne “déroutant” dans nos régions européennes, mais qui a beaucoup de sens dans les pays anglo-saxons Il signifie : “Lièvre de mars”... En plus d’être un personnage qui apparaît dans “Alice au pays des merveilles” de Lewis Carroll, c’est une expression qui est beaucoup utilisée en anglais britannique (“fou comme un lièvre en mars”), puisque c’est l’époque de l’apogée de l’accouplement de ce sympathique léporidé. En espagnol, ce serait comme dire “Aussi excité qu’un lièvre en chaleur”… Eh bien, ce nom qui ne correspond a aucune appellation officielle de l’usine Volkswagen, puisqu’il s’agissait d’un kit carrosserie totalement fou qui a été conçu pour la Coccinelle classique, façon Buggy “civilisé”... Ces kits ont été fabriqués par Pegasus Design, une société située à Arlington, en Virginie (États-Unis). Leur slogan pour vendre ces kits était : “Le style champagne au prix de la bière”... Ils n’ont pas eu beaucoup de succès, car ni le style n’était le champagne ni le prix de la bière… La comparaison pourrait plutôt être celle des “potions” que beaucoup d’enfants préparaient à cette époque lorsqu’ils s’ennuyaient lors d’un repas de famille (en mélangeant diverses boissons) et décidaient de les vendre au prix de “Vega Sicilia”...
Si vous ne comprenez pas, c’est normal, vous n’êtes pas branché sur cette époque… Blague à part, ces kits datant des années ’60 et ’70 étaient fabriqués à partir de résine ignifuge et étaient montés sur des châssis de coccinelle de ces mêmes années ’60 et ’70… Pegasus Design se vantait à cette époque de fabriquer l’un des kits les plus résistants du marché, ce que ici chez Gatsby/ChromesFlammes, ne pouvons ni confirmer ni infirmer… Il se fait que pendant longtemps, la Coccinelle a été l’une des voitures les plus économiques d’Amérique, donc la base était bon marché et abondante. Son esthétique était difficile à digérer, mais avec le profil cunéiforme caractéristique que toute voiture de sport ou tentative de voiture de sport devait avoir à cette époque (oui, nous allons finir par vous ennuyer avec ce type de profil, mais c’était ce qui était à la mode dans les années ’60 et’70)… Et c’était difficile à digérer car il avait des proportions compliquées : il était étroit, court, avec un ajout en plastique noir sur le pilier B, rappelant celui des bus urbains américains à double plate-forme (entre une plate-forme et l’autre) qui avaient des vitres avant divisées en deux comme avant guerre, d’une taille plus typique qu’une fourgonnette, ressemblant à celles de l’arrière prises d’une capsule spatiale de la NASA… Tous les vitrages, à l’exception du pare-brise avant, n’étaient pas des vitres mais du plexiglas… Les seuls éléments “normaux” de cette apparition nommée “March Hare” étaient ses feux arrière, tirés directement d’une Mustang de cette décennie, ainsi que son bouchon de carburant, gracieuseté de Mopar. Seuls liens avec la Coccinelle : les phares et le moteur/boite/châssis (recoupé)… Les aspects les plus caractéristiques et les plus positifs (c’est le moins qu’on puisse en écrire), étaient les portes en forme d’ailes de mouette et l’arrière rappelant un mini break de chasse… Sous cette carrosserie, le châssis raccourci par rapport à l’origine, les suspensions et la direction, repris directement d’une Coccinelle des années ’60, tandis que le moteur qui lui a donné vie, était également issu d’une Coccinelle, mais un peu plus tard, c’est celui d’une 1302 des années 70 de 1,6 litre, toujours quatre cylindres boxer refroidi par air, délivrant environ 50cv. Avec son faible poids d’environ 800 kg, sans être une fusée, il ne devait pas trop mal se déplacer. Si vous voulez en obtenir un, vous allez avoir beaucoup de mal. On ne sait pas avec certitude combien sont encore en vie, mais il y a une unité complète qui a tenté d’être commercialisée aux USA il y a deux ans pour environ 10.000$… C’était un kit carrosserie. Avec de l’espoir et de la chance peut être que ce fou se fera connaître d’un autre fou capable de payer les frais d’une reconstruction en petite série à destination d’autres fous furieux qui auraient l’idée de l’acheter et de l’homologuer pour circuler on ne sait ou… Si vous aimez être regardé et que vous avez un goût atrophié différent, cela peut être votre voiture…