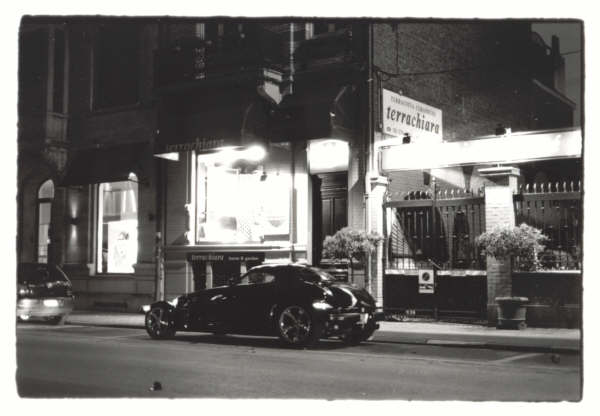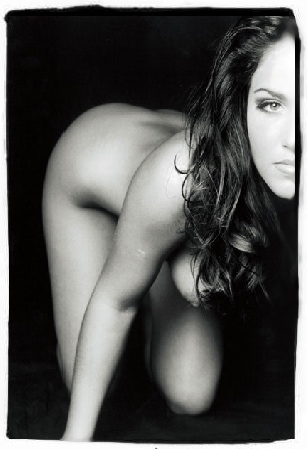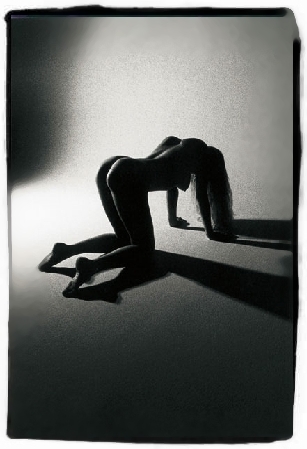Entre, viens, léche, admire…
Révèle-moi tes rêves… Entre, viens, léche, admire… Excalibur, Panther, Morgan, Cobra, Prowler, Iso, Jaguar, Cadillac, Bugatti, Corvette, Packard aussi…, en entier ou en morceau, repeinturé ou rouillé, clinquant ou flambant neuf, j’ai eu… Je collectionne des automobiles extraordinaires… pour mes rêves usagés. Mon univers sur quatre roues est mon bonheur rétro du futur, avec ou sans freins, avec ou sans air climatisé, tout ça, et bien plus encore. Dis-moi tes envies, révèle-moi tes rêves…
Parce que. Parce que la vie, ça ne peut pas être juste ça. Être enfermé dans une vie de con, fermé d’ouvertures comme dans une boîte de conserve, regarder les nouvelles de la même manière qu’on regarde un plat se réchauffer dans un micro-onde, être en prison dans son fauteuil, bâillonné par les paiements. Entendre le tic tac monotone de la bombe fiscale qui finit toujours par exploser. Attendre les jours vides, les jours répétés, calqués pour espérer ne pas mourir trop vite. Attendre. Attendre. Avoir un ordi dans les yeux et un téléroman dans le nez. Commander l’amour en appuyant sur une touche pour continuer, commander la mort en appuyant sur la détente pour arrêter, choisir de jouir dans un magazine porno et commander une poupée en latex parce qu’on ne peut pas tout avoir dans la vie. La vie ne doit pas être une mise en attente. Le paradis ne doit pas être un fond de retraite, la liberté ne peut pas arriver à l’heure du cancer, l’espoir n’est pas un numéro chanceux nul si découvert.
Parce que l’amour ne devrait pas être un virus qu’on attrape en solitaire. Parce que la tendresse ne devrait pas être en papier glacé, parce que les contacts humains ne devraient pas attendre pour garder leur priorité d’appel. Parce que j’avais de plus en plus besoin de bouffer des rondelles de saucisson et de prendre des pilules pour dormir, comme un cocktail de con, avec olive multicolore et Martini. Parce que je me levais plus fatigué que quand je m’étais couché, parce que je me réveillais déçu, toujours plus déçu que la vie n’ait aucun rapport avec les rêves, parce que je me réveillais vide, vide et seul. Parce que personne n’est responsable des balles perdues et que les statistiques sont déjà hautes, plus haute que les ponts d’où on saute parfois. Parce que ma haine de tout et tous ne pouvait pas être plus forte et que les pilules dans les contenants datés ne réussissaient plus à me sortir du lit, de la télé, parce que j’avais peur d’affronter le petit déjeuner, parce que l’envie de faire un vol plané vers le pavé pour vivre quelque chose une fois pour toute dans les quelques secondes avant l’impact, négociait trop dur avec les raisons de faire semblant, parce que tout ça…, je suis parti.
Je suis parti. J’avais beau me saouler tous les soirs en utilisant des faux pseudos, j’avais beau baiser les yeux fermés dans des lits naufragés, ça n’y était pas. Je suis parti. J’ai rangé mes bagnoles pour mes vieux jours, j’ai fermé le garage…, j’ai vendu bottin de téléphone, rêve de piscine, et idées de gazons, de plan de paiement prémâché et de drogues fortes. J’ai pris le Prowler, j’ai pris l’autoroute vers une raison de me lever le matin. Avec rien d’autre qu’un rasoir et quelques slips de rechange, une valise de pilule et quelques stupéfiants. Tout ça dans le coffre de l’auto qui allait me servir d’arche de Noé. Le déluge se passe toujours derrière des yeux brouillés. Je suis parti. Pour essayer de vivre. De rencontrer la vie. Parce que la vie ça ne pouvait pas être juste ça. Et depuis, je roule. Je poursuis la ligne au centre de l’autoroute qui m’amène où elle veut. La ligne jaune, parfois blanche, parfois droite, parfois double, parfois pointillée. Ça me fait du bien. Je fuis. Je regarde les arbres aussi. Heureux celui dont les rêves sont assez forts pour colorer l’eau des piscines qui nous tiennent lieu de vie. Heureux celui qui ne voit pas, qui ne se pose pas de question. Qui ne sait plus comment être touché par l’encre rouge des journaux, par les rayons ultra violent qui émanent des nouveaux téléviseurs et des nouvelles télévisées. Heureux celui qui réussit à se sentir se réaliser. Moi, j’aime pas les pilules qui font le travail. Je ne veux pas accepter de prendre des médicaments pour trouver une raison de vivre… Alors depuis quelques jours, j’erre entre les aiguilles des différents cadrans du tableau de bord. J’ai un requin bleu sur roues qui a l’aiguille du spidomètre dans le coude du chauffeur. Et la liberté n’est peut-être qu’un excès de vitesse comme une publicité pornographique du moteur de l’année. J’erre dans toutes les campagnes et dans les villes, chaudes, comme dans un road movie où il ne se passe rien. Depuis quelques jours déjà. Combien ? Je ne sais plus, mais mes yeux verts sont maintenant rouges amphétamines, et les Nescafés s’entassent. Je ne dors pas.
Je cherche. Je suis la ligne. Le pavé coupé en deux. L’illusion et la réalité. La nuit comme le jour. La ligne qui se pointille parfois, qui se dédouble à d’autres moments, qui devient jaune lorsqu’elle est blanche, simple, qui s’efface. La ligne blanche comme la mémoire. La mémoire. La ligne pointillée entre le rêve et le reste. La ligne que je poursuis pour basculer dans le monde du rêve. Je regarde les arbres peints en blancs sur le bord de la route. Les arbres peint jusqu’à la taille comme une robe contre les insectes. Je les regarde et j’imagine que ce sont des moulins à prière tibétains. Je les fais tourner, les arbres comme je ferais tourner les moulins entourés de Tibétains courbés, en récitant le mantra le plus puissant que ce nouveau millénaire ait récupéré. C’est pas d’hier que l’homme cherche. Je ne suis plus très sur de savoir où je suis. Quelque part. Sur une autoroute. Je crois avoir croisé un panneau “Voie sans issue“, aujourd’hui. Ou hier ? Je ne sais plus, les médicaments me mélangent. Et mes nerfs chauffent et tirent, et la peau de mon visage me semble trop courte à certains moments. Voie sans issue. Sur une autoroute. Sur le coup, ça m’a semblé bizarre. Puis, j’ai accepté. La fin du monde est, elle aussi, une voie sans issue. Elle n’est peut-être pas une chose à venir, une prophétie, c’est peut-être une date de l’histoire, une chose du passé. Une balle de foin oubliée au grenier, une balle perdue de plus. Une photo qui rougit de honte par le temps. Puis, je l’ai vue, la voie sans issue, au moment où mes yeux se fermaient sur le volant. Au bout de la ligne pointillée, la fin de l’autoroute, mes yeux se sont fermés. Et pour me sauver la vie, mon moteur aussi s’est arrêté. Ma bagnole, s’est étouffée et échouée sur la voie d’accotement. J’ai rouvert les yeux, un peu paniqué, un peu mélangé. À quelques pas de là, il y avait une affiche de motel.
Mon véhicule était mort. Comme une promesse non tenue. C’est peut-être contagieux le fait de simuler la vie. Je suis sorti sans prendre la peine de refermer ma porte et j’ai regardé l’affiche du motel en m’étirant. Rouillé par l’air de la mer comme si, à marée haute les vagues engouffraient le motel au complet. Une affiche de motel qui semblait servir plus de perchoir que de publicité. Un clan complet de mouettes me regardait sans bouger, pétrifié par la chaleur. Par la lumière trop forte. Surexposée. Une affiche brune rouille, blanche guano, rouge lettrage délavé par le soleil impudique. Je m’y suis dirigé. Mon auto ressemblait à un cachalot mort sur le bord de l’autoroute. Le motel était là et me regardait, avant le bout du monde, avant la fin de l’autoroute. La porte s’est refermée comme une guillotine. Je m’endormais debout. Le silence de la chaleur, l’odeur de la fin de journée, tout ressemblait à un mirage. Les mouches qui volent un peu au ralenti. Le bruit de leurs ailes qui s’arrête soudainement. Le silence. Le bruit d’un réfrigérateur. Le bruit d’un camion qui passe dehors, qui coupe l’air humide. Le silence qui revient. Et la mouche qui repart. Je me suis fais hypnotiser par les camions qui passaient derrière la vitre dans le soleil surexposé. Je voyais les camions passer à l’envers dans le miroir à l’envers. Pourtant l’autoroute aboutissait à un cul de sac ? D’où viennent ces camions et ou vont-ils ? Et les mouettes qui volent à l’envers elles aussi, jaunies par la poussière. Qui volent, qui jouent avec le vent à l’envers.
La porte de la chambre s’est refermée derrière moi comme un fouet d’esclavagiste. Et devant le motel, la mer et son ressac qui invite tout le monde même le soleil à venir se lover dans le confort marin. La mer. Avec les cargos. Immobiles. Silencieux, eux aussi. Je ne suis qu’une bouteille à la mer. Une bouteille de Mescal Mexicain. Et le ver au fond me ronge psychotrope. J’ai bu le fond de mon verre cherchant à déchiffrer le message. Je me suis vu avec des pilules et des glaçons, au fond d’une bouteille, dans la vase, au fond de la mer. Les bouteilles sont des bouées crevées. Je me suis surpris à répondre à l’appel du ressac. Je ne voulais pas écouter les lignes ouvertes aux poignets. Je ne voulais pas booster les statistiques aux stéroïdes. J’avais envie d’aimer la vie… La peau d’elle a la beauté des méduses. Sensuelle, ondulante, brûlante au 3e degré. Elle est venue me voir. Timide, elle a cogné la porte et elle est entrée, dans le noir du réverbère. “Je peux entrer ? J’ai mal au cœur, les étoiles sont avalées par la brume et j’ai froid. J’ai trouvé un anneau de Sature qui me scie en deux“. Elle est entrée silencieusement dans mon sommeil à marée haute. Son odeur douce de lavande m’a réveillé. Elle a fermé la porte sur la pénombre, dans le reflet du phare qui éclairait la plage. Comme une galaxie de sensualité qui me regardait. Des yeux à faire danser les aurores boréales. Ses hanches voguaient comme des nébuleuses. Elle me regardait sans malice, vulnérable, de ses yeux maladroits. De ses seins miraculeux. De ses lèvres humides. Elle a déboutonné sa blouse blanche avec pudeur, avec silence. Elle l’a laissé tomber par terre. En me regardant. Simplement. J’ai explosé. Ses seins étaient une promesse de paix. Elle s’est couchée sur moi comme un coucher de terre vu de la lune. Et ça, c’est beau. Nous nous sommes embrassés. Je buvais ses lèvres, les yeux saouls, les mains hésitantes, vagabondes. J’avais envie de pleurer. Son corps en expansion m’engouffrait comme la mer et recouvrait mon manque affectif. Ses fesses étaient des Atlantides douces, des El Dorado cutanées.
Avec bonheur, je me suis noyé dans sa peau. Dans sa bouche. Dans sa générosité. J’étais asséché. En silence. Ancré dans mes yeux. Et je suis mort mille fois. J’ai fait glisser sa robe de ses hanches et elle s’est retrouvée nue, sur moi, à faire fondre l’hiver, l’univers qui explose. Le souffle. Mon visage ruisselant. Et j’ai fondu. J’étais un iceberg chaud dans ses bras. On s’est donné de l’oubli, de la tendresse, du désir humide. Un peu d’amour. Parce que la baise, ce n’est pas le réconfort, c’est l’illusion. Mais la bouche sur les yeux avec un regard qui sait parler, ça réchauffe l’antimatière. Pour se laver le cœur des mains tachées du sang et des larmes sans goût. On s’est fait du bien. Comme une oasis. Comme rien. Je me suis perdu en elle, j’ai bu la vie de son sexe, nous avons joui nos problèmes et notre manque d’amour, elle a avalé ma solitude. Les courbes de sa peau, l’odeur de lavande de ses orgasmes, la salive sur mes angoisses, le plaisir de ses mamelons, la plaque tectonique de ses fesses, l’ampleur de mes fantasmes. Chaque pore a été pénétré, chaque courbe a été sucée, chaque mot a été susurré. L’eau salée désinfecte. Nous nous sommes collés l’un à l’autre. Nos dépouilles endormies étaient échouées sur le lit, naufragées en manque d’amour sur un radeau en matelas capitonné. Le plafond n’existait plus. Les étoiles brillaient. On ne devrait pas rester seul. Les femmes sont belles. Voilà une bonne raison de rester en vie. Même si l’amour brûle. Même si les caresses ont la confusion des cataclysmes. Les nuits seules ont la noirceur de l’encre des pieuvres géantes. Les rêves de pieuvres sucent le cerveau et nous laissent naufragés, le matin, dans un lit désert, une île déserte, vidé comme un poisson blanc, mort, gonflé par l’eau salée. Odorant. Comme un requin sans tripe avec uniquement une double rangée de dents pour mordre. Les nuits seules donnent l’envie de mordre et nous laissent la blancheur des cadavres gonflés par l’eau des larmes refoulées.
Je suis un grand brûlé. Comment aimer à l’heure avancée des agences de rencontres, des amours mis en boîtes vocales et des numéros sexy ? Comment s’y retrouver au milieu des contacts, des tchats et des caresses virtuelles ? Les rêves de pieuvres asphyxient. Sa peau a l’attrait des ressacs. Je coule en elle, sans air, avec l’ivresse des profondeurs. J’ai envie de rester en son ventre. D’y mourir. Le manque d’air rassure. Pour ressortir de ses bras, les paliers de décompressions sont de plus en plus long. Je coule. Un remous. Un petit tourbillon dans le courant du temps. Toi et moi, on n’est que des molécules égarées. Rien de plus. Et la douleur ne nous rend pas plus important que le reste des monstres du temps. Bulles d’amour… J’ai besoin d’être aimé par le temps et l’univers en entier. Est-ce 3e degré, comme le manque d’amour qui brûle. Même les révoltés. Surtout les révoltés. Avoir le cœur brûlé de tous côtés et se réveiller nu, échoué dans des draps, dans le lit d’un motel, ça donne l’envie de changer comme on change le monde. J’ai passé ma vie entre la révolte et l’envie d’être heureux. La révolte. Ne plus être capable de regarder le monde dans les yeux sans sentir la vague venir. Avoir les poings fermés pour cause de décès, avoir le dos courbé de rage devant ce qui n’est jamais dit. Avoir la lucidité du suicide, crier la nuit dans son sommeil, pleurer du béton, se durcir comme la politique, ne plus rien croire, ne faire confiance à personne, même pas en ses sens, même pas en ses causes, même pas en son sentiment d’injustice. La révolte. Comme un fruit tendre. Qui risque de pourrir. Les fruits ont des gènes d’insectes, mais le tiers du monde crève encore de faim et les enfants doivent manger des sauterelles avant d’aller travailler. Les molécules sont modifiées, mais rien ne change. Les enfants meurent encore sur les côtes sèches de la malnutrition, pendant que les semences du riz modifié sont propriétés des compagnies chimiques et privées.
Les femmes perdent les morceaux de leur humanité dans des mers de silicone, et leur image est elle aussi génétiquement modifiée, mutant de mode et de magazine lustrés. Les fillettes ont les décolletés des stars pornos, des menstruations à 10 ans et l’envie insatiable de vomir chaque repas. Elles n’entendent pas les ventres creux à l’autre extrémité de la chaîne alimentaire. Le mensonge, la perte de sens, la mort maquillée, le vide qui engouffre tout, la confusion et la solitude exponentielle. Les ménagères de banlieue ont la tête dans le four. Elles attendent les effets du gaz sur la solitude et la perte de sens. Elles attendent les gaz à effet de serre pour être serré dans des bras chauds. Absent. Alors, la tête dans le four. La tristesse est épidémique. Et les médicaments sont propriétés des mêmes compagnies chimiques et privées. La révolte. Comme un trou noir. Une étoile au bout de son souffle. Passer sa vie à espérer un jour réussir à les voir, les étoiles, derrière le voile lourd des brouillards. Espérer savoir les discerner des satellites. Faire le tournant de l’individualisme ostracisant, se battre pour rester humain quand nos femmes et nos aliments sont modifiés, quand l’air est lourd de plomb et que les anges ont du plomb dans l’aile, vouloir croire en soi, vouloir croire qu’on sera un jour quelque part là-bas, dans les étoiles pour pouvoir les regarder et en vouloir à mort à l’humanité. Savoir que certain avalent les petites économies comme d’autres, des pilules et ne pas pouvoir avaler.
Voir les pays se faire digérer en toute démocratie et vomir à l’idée qu’il y a définitivement pleins de gens et de dirigeants qui envahissent notre cul parce qu’on se penche. Avoir de a peine de mort à se redresser après qu’ils aient fait leurs sales besogne par en arrière, avoir honte de marcher la tête haute et se demander qui parle lorsqu’on ouvre la bouche. Espérer être encore un homme demain, non pas un produit pharmaceutique. Souhaiter ne pas être rappelé pour défaut de fabrication, classifié comme une auto. Savoir que nos gènes seront bientôt des délateurs incorporés. Voir son meilleur ami se pendre et se manquer. Se suicider à coup de télé, de drogues douces, de rêves usagés, espérer voir enfin quelqu’un d’autre dans son miroir, ne plus se reconnaître dans la crème à raser. Espérer encore être un homme à la fin de la journée. Passer sa vie entre la révolte et l’envie d’être heureux, se réveiller vide, épuisé, sur le bord des larmes, et ouvrir les yeux dans ceux d’une femme. Comme une réponse. Quand la révolte brûle, qu’elle décapite. Avoir la peau qui fend, brûlée par les mille et une cigarettes des chambres de torture ou brûlée par les caresses sans promesses, incontestablement, et voir une femme nous regarder sans rien demander. Voir une femme nous regarder au lever de la journée donne envie de choisir entre la révolution et l’envie d’être heureux. Je veux faire la révolution du bonheur. Malgré ma peau qui crie lorsque l’air la fend. Je sens la brûlure de mon visage se fendre. Aimer me donne le vertige. Je perds le nord. En toute chaleur. Et je retourne osciller entre la vie et la mort. Entre la révolution et l’envie d’être heureux. Je retourne re-ranger mes voitures, re-plonger la tête dans la télé… Téléphone, allo, bulle d’amour encore… Je veux faire la révolution du bonheur…Entre, viens, léche, admire… Excalibur, Panther, Morgan, Cobra, Prowler, Iso, Jaguar, Cadillac, Bugatti, Corvette, Packard aussi…, en entier ou en morceau, repeinturé ou rouillé, clinquant ou flambant neuf, j’ai eu. Je collectionne des automobiles extraordinaires… pour mes rêves usagés. Mon univers sur quatre roues est mon bonheur rétro du futur, avec ou sans freins, avec ou sans air climatisé, tout ça, et bien plus encore. Dis-moi tes envies, révèle-moi tes rêves…