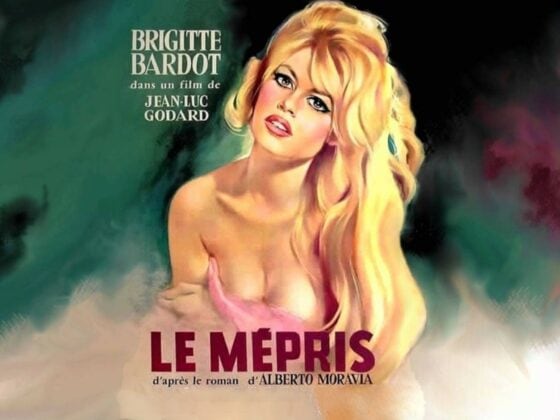Avatar… Négatif…
Realisation: James Cameron
Douze ans après son catastrophiste clafoutis naval, James Cameron revient avec le révolutionnaireAvatar, immédiatement célébré par une presse trépignante le qualifiant de titanesque.
L’épithète est d’une originalité misérable, et c’est bien cette misère intellectuelle crasse qui représente le mieux ce film torché comme on s’essuie après un coït trop rapide.
Je vous le dit de suite, Avatar, si ce n’est pas le cinéma de demain, n’en représente pas moins le parfait reflet de l’hypocrisie et du cynisme de notre époque, dispendieuse et vulgaire.
La prophétie est en marche et aujourd’hui le film est un succès monstrueux.
Face aux hordes hallucinées qui bouchonnent encore les travées des cinémas du monde entier, la bave aux lèvres et le collyre en poche, le spectateur déçu se sent dubitatif, il s’interroge, quelque peu soupçonneux.
Mais qui diantre est-il, cet homme de peu de foi, pour oser douter de la sorte ?
Ce mécréant n’est-il qu’un paraplégique du cerveau n’ayant pas su fouler le chemin de la félicité suprême ?
Comment peut-il être sourd aux suppliques humanistes d’un film produit par la Fox ?
Est-il aveugle, borgne (ou daltonien) qu’il ne fut transporté par la projection en relief ?
Cet infidèle, comme tous les chiens de sa race, n’a-t-il donc point de cœur ?
Est-il à ce point bouché qu’il aurait perdu son âme d’enfant dans les tréfonds d’un cœur trop aride que les sédiments de l’âge enfouissent un peu plus chaque année ?
Vous savez cette grâce qui vous permettait de voir dans les rues des villes à la Noël une féérie magique attisée par mille lucioles bariolées dansant dans une insouciante légèreté délicatement ponctuée par la chute aléatoire de quelqu’aimables flocons blancs…
Las, le peine à jouir abandonné par cet infantile hébètement hallucinatoire ne voit plus qu’un triste spectacle : trois pauvres guirlandes clignotantes accrochées par des ouvriers fatigués dans une avenue trop bruyante dégueulant une sombre bouillasse infâme de neige acide alourdie par les gaz d’échappement…
Bref, c’est durant ce rude hiver 2009, un peu avant la Noël donc, que Cameron a convoqué ses ouailles.
Suivez moi, et vous verrez la Lumière nous a-t-il dit…
Bon avant d’aller plus loin je note quand même que la Lumière c’est 12 euros, peut être un détail pour les Purs qui font le pèlerinage vers le seul Lieu Saint que nous ayons ici bas en France : Le temple de l’Imax du Disney Village.
La Lumière est là bas au bout du chemin, la révélation est au fond de la ligne D du RER…
Cette Lumière c’est Avatar, un récit de science fiction au service d’une expérience visuelle époustouflante qui décuplera vos sentiments et votre empathie.
Le cinéma total est arrivé.
C’est la forme qui culbute le fond dans un accouplement improbable du Jour du seigneur et du porno gonzo.
Le pauvre type tout gris du début deviendra un héros plein de couleur.
Il était paralysé, Avatar lui a redonné des jambes.
Lève-toi et marche, lui a dit Cameron.
Le temps du cinéma à papa est fini, balayé, consumé par ces nouveaux démiurges.
Voila où, grossièrement, la prose des marchands du temple, ces vulgaires vendeurs de papier se battant comme des chiffonniers à coups de scoops frelatés et de slogans panégyriques, voudrait bien nous voir.
Un véritable catéchisme inique déblatéré en une logorrhée de chiffres et de résultats en dollars galvanisant les fans dans leur foi de Templiers.
Nauséeux.
Et absurde comme l’engouement moutonnier d’une foule toujours prompte à aller là où on lui dit d’aller.
Médiocrité crasse d’un spectacle vautré sur prêt de trois heures à la finalité écœurante et à la roublardise malsaine et désespérante.
On va aller vite sur le joli bras d’honneur que représente l’histoire.
Jake, un humain à roulettes va participer sur Pandora à un programme scientifique visant à le propulser dans un autre corps sous la férule d’une scientifique aigrie mais passionnée.
Le problème c’est que des militaires sous les ordres de Quaritch sont là pour aider Selfridge, le représentant d’un conglomérat d’actionnaires, à piller les ressources de la planète.
D’abord résigné, le héros va vite reprendre goût à la vie grâce à ses nouvelles jambes et surtout grâce à la gironde fille du chef des autochtones qui, bien que promise au chef des guerriers, n’a d’yeux que pour cet étranger.
Après avoir été accusé de traitrise par les deux parties, Jake deviendra l’Elu, choisira la jolie meuf plutôt que le fauteuil roulant, et remportera la victoire.
Si tout ceci vous rappelle Call Me Joe, Frank Herbert, Matrix, Gorille dans la Brume, Pocahontas, Danse avec les loups, Le dernier samouraï, Pathfinder et un paquet d’autres trucs, dites vous que c’est normal, Cameron n’a jamais été très doué pour inventer des histoires.
On dit même qu’il a une propension maladive à chouraver les idées ou les concepts des autres…
Terminator a ainsi gagné un scénariste de plus à ses crédits (Harlan Ellison), évitant un procès pour plagiat.
Mais après tout, on est en droit de penser qu’un bon plagiat c’est toujours mieux qu’une bonne idée mal exploitée.
Voici donc la chronique d’une arnaque méticuleuse.
On nous avait promis un monde créé de toutes pièces et notre ticket de cinéma devait nous servir de passeport pour une virée exotique sans précédent !
Pensez donc, la faune et la flore ont été développées par les plus grands scientifiques de notre époque, leur vision a été couchée sur le papier par les plus grands artistes actuels et ce sont les plus grands magiciens de l’informatique d’aujourd’hui qui ont fait vivre tout cela.
Des livres ont même été publiés sur leur travail annoncé comme remarquable…
Tout ça, ces notes d’intentions ainsi que les discours formatés de la production, ce n’est rien de plus que du baratin aussi crédible que des promesses étalées sur un flyer de marabout…
On nous vante inlassablement Cameron comme un homme de science, érudit et passionné.
Dans son garage je n’en doute pas.
Mais à l’écran, force est de constater que le programme avatar et ses aspects techniques sont dégagés en moins de dix minutes.
La découverte d’un nouveau corps sur-humain en opposition à l’infirmité physique subie par Jake sera au centre d’une seule scène et rideau.
Le fait est acquis, on peut alors passer à autre chose.
Un petit peu comme on oubliera la bonne dizaine d’autres avatars aperçus à ce moment là et qui disparaissent purement et simplement du récit.
Vivre dans deux corps à la fois, voila pourtant une bien étrange affaire.
Ce thème fort actuel brassant virtualité et réalité est ainsi brossé d’une unique phrase, où l’on comprend que Jake néglige son hygiène et sa vie d’humain.
Le contraste est tellement appuyé que le spectateur n’a aucune raison de se poser plus de questions.
Tout ce qui pourrait créer un sens est soigneusement, méticuleusement et systématiquement contourné.
Le minerai précieux pourrait être à la base d’une question terrible pour le personnage principal.
Choisir le camp des indiens revient à condamner sa planète à l’extinction, voila un sacré dilemme.
Laisser mourir le monde qui l’a rejeté pour en choisir un autre, pour lequel il va devoir se battre pour être accepté.
L’épopée d’une revanche personnelle contre toute l’humanité, voila qui aurait eu un peu de panache.
Hélas à la place de la terrible vengeance on se tripote les nattes et le minerai n’est qu’un prétexte.
Il n’est important que pour des actionnaires.
Formulant un aveu étonnant en parlant de l’unobtainium comme d’un symbole, Cameron nous dévoile que ce qui l’intéresse ne va pas au-delà de la simple caricature.
Celle des méchants banquiers et des gentils indiens.
Il a voulu que le propos de son film soit évident, il est fléché comme des chiottes d’un UGC de province.
Là où l’on nous promettait sautés, fumés, croquants et fondants on se retrouve avec un truc surgelé mal dégelé, tiède, plein de flotte.
Là se trouve une bonne partie de la malhonnêteté du discours de Cameron, qu’on retrouve dans la bouche de Quaritch, le méchant colonel : vous allez voir ce que vous allez voir, c’est une planète super dangereuse, vous allez tous mourir.
Jamais pourtant on ne sentira ce danger annoncé, et ce jusqu’au dénouement.
Pandora donc, une jungle en plastique dont l’exotisme extra terrestre s’incarne essentiellement dans la présence de plantes aquatiques fluos au milieu de fougères à la con.
On remarquera bien la hardiesse d’une tentative pour nous faire rêver avec ces merveilleuses montagnes flottantes, c’est bien, mais c’est juste dommage que l’image soit si peu originale.
Le bestiaire foisonne d’une pauvre dizaine de bestioles qu’on verra épisodiquement, au gré des besoins du scénario.
Elles sont définitivement toutes plus ridicules les unes que les autres, et foin de protestation, vous les atrabilaires défenseurs de cette merde dispendieuse, votre amour pour Avatar ne prouve que votre manque flagrant d’imagination.
Un trou béant que toute la mauvaise foi que je ne pourrai jamais réunir ne saurait combler.
Alors merde quoi !
C’est pas décent de trouver ça beau et si vous vous contentez de loups dont la férocité tient à de grandes dents sans babines ainsi qu’à de petits yeux luisants de méchanceté, c’est dramatique…
Si pour vous un rhinocéros à tête de requin marteau, des chevaux, des dragons et un singe conçus en dépit de toute crédibilité biologique et de tout sens artistique vous suffisent, c’est effarant !
Alors c’est sûr qu’on peut se gausser, trouvant ridicule d’observer ces animaux juste créés pour faire rêver d’un œil trop terre à terre.
Mais si ces horreurs me sautent aux yeux, c’est surtout à cause du décalage avec le soin évident donné au réalisme de l’environnement humain.
Je pense à ces vaisseaux plutôt bien dessinés où l’on a pris soin de placer des détails pertinents comme les caches poussières devant leurs réacteurs.
Même si tout ça reste sans grande surprise c’est cohérent et efficace, là où le traitement de Pandora est bâclé et sans idée.
Alors devant un tel désastre les moins jeunes d’entre nous devraient regretter avec une pointe de nostalgie amère le temps où travaillaient des gens comme Syd Mead ou Ron Cobb.
On a aujourd’hui de talentueux infographistes, dotés de machines puissantes, mais dénués de vision globale.
Des films moches (Emmerich, Snyder) qui s’empilent les uns après les autres.
Voila la morne réalité de notre époque.
Les Na’vi. Ou Naa’vi ou Na’vy je sais déjà plus… Et Moat, le Tourouque Makto, Tsutey, Neytiri, Ikran, Eywa…
C’est pas parce qu’on est consterné par une telle inventivité lexicale d’analphabète qu’on ne peut pour autant détourner les yeux du ridicule achevé de l’ensemble.
Na’vi, tu vois, c’est un peu comme Natives, mais avec une apostrophe au milieu, pour faire extra terrestre…
Et ils nous racontent sérieusement que des linguistes se sont penchés sur le langage de ces xénomorphes proposant ainsi une sorte de caution scientifique tout juste bonne à remplir 30 secondes de featurette promo.
Vous savez ces petits modules balancés sur le net et à la télé, parfaits pour attirer le gogo et exciter le fan cherchant à tout prix à revivre l’orgasme du premier Star Wars, flatté et émoustillé de croire que pour lui un monde complet à été créé et réfléchi.
Dans sa quête, il est aussi pathétique qu’un toxico bavant de convoitise à l’idée de revivre son premier shoot, prêt à remplacer son propre dealer pour se promettre lui-même l’extase.
Les épluchures de navet ne trompant pas les porcs, il faut croire que ces animaux ont plus de sens critique que n’importe quel adorateur du King of the World fantasmant devant ces copaux de making of qu’on lui jette en pâture.
Tout cela sert surtout à vendre des bouquins remplis de conneries inutiles et de photos moches dont le premier degré discourant des branchies des chevaux apparait comme surréaliste à la vue des énormités d’un récit torché aussi prestement qu’un pet foireux malencontreusement lâché lors d’un diner en ville.
On pourra toujours dire ce que l’on veut de Lucas, mais ses marchands du temple proposaient quand même autre chose qu’un PDF minable avec un dictionnaire de 30 mots Navis visiblement improvisés par des stagiaires lors d’une partie de scrabble censé nous faire croire qu’une langue complète a été créée.
Cameron a su capitaliser sur ce travail.
Le spectateur consterné constatera donc constamment que tout le film durant les Na’wi parlent anglais avec l’accent de Brooklyn !
Ces mêmes dépliants publicitaires nous expliquent que c’est à cause de la faible gravité de la planète que ces machins bleus ont atteints la taille de 4 mètres.
Pourquoi pas, il faudra juste m’expliquer pourquoi pour les humains tout semble normal, jouant au basket et se déplaçant tout à fait classiquement. Il y a un tel désir d’entourlouper le chaland avec un discours de bonimenteur de foire que j’avais peur de me faire piquer mon larfeuil pendant les longues heures de projection.
Mais passons donc ces considérations aigries d’enculeur de mouches pour revenir sur l’essentiel.
Les Nah’vis, un peuple ombrageux de fiers guerriers.
Dix ans de développement pour déboucher sur des humanoïdes de quatre mètres avec une queue de chat et une gueule de panthère pour faire illusion.
La queue ne sert qu’à faire joli, on se demande quelle utilité elle peut avoir pour un bipède… et l’aspect panthère ne sert qu’a les rendre plus sexy, tout en conservant une figure suffisamment humaine pour que le film reste grand public.
Sur ce point précis même le frileux Tim Burton avait eu plus de courage avec sa Planète des singes.
Le choix de la couleur repose également sur une logique imparable : Les couleurs du jaune au rouge sont trop humaines, en vert on les aurait confondu avec la forêt, le bleu était donc l’idée du siècle !
Voulant créer un monde original, Cameron nous dit sérieusement qu’il a décidé de prendre le contrepoint des petits hommes verts en proposant une grande femme bleue.
On se retrouve donc avec ces machins vivant dans une autre galaxie mais s’habillant chez Artisans du Monde, un peu masaï pour le côté proche de la terre, un peu apache pour le côté badass et surtout tous gaulés selon les standards de la mode actuelle…
Une race plus que pure, une race élégante.
Un fantasme bobo de merde rendant d’un coup presque subtil le final “africanophile” de 2012.
Cameron, plutôt malin, a peaufiné tout ça pendant dix ans.
Il a donc eu le temps de développer une idée révolutionnaire : cette tribu vit en harmonie avec la nature !
Et le film de verser dans le fantasme occidental des peuples primitifs qui, n’étant pas souillés par la technologie développée par des types comme Cameron, sont restés innocents.
Purs comme s’ils n’étaient jamais tombé du Jardin d’Eden, les bons sauvages Na’vvis sont notre double immaculé.
Ce qui est naturel est bon, point barre.
Subtil comme une pub pour un 4X4 diesel.
Et c’est sans surprise qu’on constate une fois de plus que ce qui pourrait rendre ces personnages crédibles, donc attachants, est évacué comme une punkette bourrée hors d’une soirée parisienne.
Qui sont-ils ?
Comment vivent-ils ?
Ce n’est clairement pas le propos.
Leurs lieux de culte (mais quel trou de balle a trouvé un concept aussi crétin que L’arbre aux âmes ?), l’existence d’autres tribus, tout ça n’est même pas survolé, juste évoqué.
Et pour éviter que le spectateur ne s’intéresse à ce qui pourrait rendre le film intéressant on va l’occuper avec des attrapes-couillons, des gadgets numériques, des hochets en relief.
Houuu regarde je vole, houuu regarde je fais du cheval !
Et au bout du compte on te balance en pleine face un bon gros délire mystique bien suranné.
Plus c’est gros, plus ça passe.
Plus c’est grossier, plus les spectateurs du monde entier se sentiront flattés d’être face à un spectacle dont ils maîtriseront les tenants et aboutissants.
Plus c’est con, plus les légions de fans retrousseront leurs manches pour se l’astiquer.
La seule et unique caractérisation de cette peuplade, c’est donc leur foi dans la nature s’incarnant dans des ballets new-age au son d’une musique tribale cheapos.
Et tout gravite autour : leur vie, leur peuple, Jake, les humains et le scénario.
La morale est si limpide qu’elle en est gênante.
A tel point que les plus éclairés des zélotes d’Avatar préféreront regarder ailleurs !
Les Na’vih sont tellement spirituels qu’ils ne peuvent être vaincus.
C’est le panthéisme extra-terrestre face à la cupidité humaine, mais c’est surtout la puissance de Dieu face à l’Homme.
Drapé dans une vision rousseauiste minable, glorifiant le bon sauvage face à la technologie, la foi face à la cupidité, Cameron nous pond un final phénoménal à la Shyamalan.
Mais toujours timoré, il ne va pas aller jusqu’au bout de son propos, privant le spectateur du spectacle réjouissant de marines se battant contre TOUTE la planète (fougères, herbes, insectes et autres animaux compris).
L’épique frilosité du Roi du Monde et son étroitesse de cœur nous offrent juste un gros bestiau venant se faire adouber par l’héroïne dans une scène burlesque, hommage que l’on devine involontaire à la scène du tigre de 10000 BC.
Cameron célèbre la spiritualité vécue cul nu dans la forêt face au développement technologique forcément destructeur.
Pour lui, en même temps que les humains perdent le contact avec la nature, ils perdent la foi et le sens du sacré.
Pas tout à fait sûr qu’un affrontement théorique entre ces deux valeurs soit assez clair pour les spectateurs qui viendront tremper leurs truffes dans son auge, Cameron pousse son pion un cran plus loin en faisant de la croyance des indigènes une réalité découverte par la bienveillance du docteur Grace.
Oui, la planète a une conscience et oui, chaque être vivant dépend de cette dernière.
Vous aviez la foi, nous vous apportons la preuve que Dieu existe.
Les pontes de la Fox ont du être content du petit cadeau et les siphonnés qui se foutent à genoux à n’importe quelle occasion pour fustiger la décadence de la modernité ont trouvé leur prophète.
Il a décidément une belle gueule le cinéma du XXIème siècle, versé dans l’obscurantisme débile et le primitivisme racoleur.
A l’instar de ce chatoyant univers bien neuneu, la mise en scène de Cameron soulève bravos et vivats.
Et même si à propos du scénario les plus illuminés du clergé cameronien avouent à demi-mot son indigence ils préfèrent tous axer leur analyse sur le spectacle, consentant à reconnaître la linéarité basique et souvent maladroite du script.
Je pense que personne n’a rien contre le rabâchage d’une histoire universelle, si tant est que l’on ait quelque chose à en dire, ou qu’on s’appelle Terence Malick.
Mais ici le script se borne à un canevas éculé, sa codification extrême devrait par sa simplicité dynamiser le rythme du film qui pourtant demeure singulièrement poussif et elliptique !
De plus, sachant qu’Avatar rentrera dans ses frais en séduisant un large public qui d’habitude ne va pas au cinéma plutôt qu’en misant uniquement sur les amateurs de SF, il se sent obligé de souligner tout ce qu’il fait en appuyant ce qui était déjà évident.
Pour être sûr que personne ne loupe rien le récit utilise carrément deux voix offs.
La première commente de manière redondante l’histoire, la seconde au travers des vidéos que tourne Jake nous bourrine les états d’âme du personnage à chaque moment clé.
Penser que le banquier vénézuélien, l’ouvrier chinois ou la mère de famille française ont besoin d’une telle artillerie pour appréhender son univers me fait penser que Cameron a une bien haute opinion de ce qu’il écrit, et une bien faible de son public.
A ce titre, l’introduction du film est édifiante.
A peine arrivé sur Pandora la caméra va d’un personnage à l’autre, chacun se retrouvant affublé d’un trait unique de caractère en deux lignes de dialogue.
Le personnage de Grace Augustin est emblématique de cette pantalonnade.
Elle sort de son caisson et réclame une clope avec supériorité.
Grossièrement présentée comme autoritaire, un personnage secondaire déboule pour nous confirmer qu’elle aime les plantes plus que ses semblables.
Grace est une misanthrope qui excelle dans son travail, la caricature est dressée en une dizaine de secondes.
Les 15 suivantes seront consacrées à sa relation avec Jake qu’elle commence par humilier avant que ce dernier ne lui tienne tête avec morgue.
Les deux caractères et l’évidence de leur relation future sont scellés en une minute.
Elle traverse ensuite la base pour que nous puissions avoir une idée du décor (quelques secondes de plus) et retrouve le grand patron pour râler.
En réponse aux deux lignes de dialogue de Grace, celui-ci lui résume toute la situation puis l’emmène dans son bureau lui montrer l’élément central du film : l’unobtainium, répétant pour les deux ou trois dans le fond qui seraient encore en train de jouer avec leurs lunettes que ses profits sont menacés par les sauvages. Deux minutes pour tout ficeler et planter tous les enjeux.
Une chercheuse sévère mais juste, trait propre à tous les génies, préférant ce qu’elle étudie à ses semblables et son patron borné et désinvolte, ne s’intéressant qu’à ses gains financiers.
La scène suivante c’est Jake et son premier transfert.
Difficile de faire plus expéditif.
Et pitoyablement, tout est à l’avenant.
L’écriture du personnage du pote humain du héros est insipide, tout comme l’est celle du chef des guerriers, parfait dans son rôle de faire valoir transparent jusqu’à sa mort, évidemment héroïque.
Il a, comme d’habitude et de film en film, l’élégance de laisser sa place à l’Homme Blanc.
Et le colonel affublé d’une outrancière cicatrice ?
Guindé dans son paternalisme et son autoritarisme guerrier, il est bien sûr bad-ass et fort en gueule, la punch line prémâchée au bout des lèvres.
Les bouseux qui trouvent tout ça admirable ne méritent pas d’avoir des yeux, qu’ils se laissent pousser des nattes car ils sont juste bons à se rouler dans les pissenlits !
Et il n’y a pas que l’exposition qui glisse comme une motte de beurre dans un film de Bertolucci, le reste ne présente aucune aspérité, aucune ambiguïté.
Tout ce qui nous est présenté a une fonction et n’existe que pour cela.
Chaque animal aura son utilité lors du dénouement, le truc féroce reviendra tuer les méchants, le gros herbivore dont on apprend de suite que sa carapace est trop épaisse pour les balles des GI’s servira lors de la charge finale, Trudy Chacon, le personnage joué par Michelle Rodriguez (et son cocasse “Je n’ai pas signé pour ça” qui ne sert qu’à justifier son revirement) permettra au héros de s’échapper de sa prison, c’est tout.
Elle reviendra juste se faire crever, son personnage étant sauvé de l’indifférence générale que par le ridicule achevé de ses peintures de guerre.
Des personnages en carton pâte gesticulant dans une intrigue éculée…
Comment diable vont-ils faire pour forcer l’empathie pour Jake et son destin téléguidé ?
Et bien c’est tout simple, en ayant recours au kitsch le plus exubérant !
D’envolées lyriques inspirées des meilleures pubs Vanya pocket aux effets de manches éhontés (troupes galvanisées, discours démagogiques et guerriers à la Braveheart, mais on pense aussi à Vercingetorix peuples en pleurs…) rien ne nous est épargné, rien.
A l’instar de l’exposition, la fameuse mère de toutes les batailles fait peine à voir.
Un ballet aérien virtuose mais vain et un combat à terre riquiqui.
Filmée comme une suite de morceaux de bravoure interchangeables, elle ne dégage aucune perspective militaire et aucune émotion.
Ca voltige beaucoup mais pour pas grand-chose vu qu’on se contrefout royalement d’un final aussi attendu que naïf.
Des Navis fades contre des silouhettes de GI’s…
On ne compte même pas les points, on subit juste un triste spectacle tape l’œil et imbu de lui-même.
Aussi roublard et mensonger qu’un Roland Emmerich nous promettant, il y a quelques mois, rien de moins que la fin du monde pour au final nous livrer un drame intimiste sur les fuites nocturnes d’une petite fille.
Bref, tout ça débouche sur une fin consternante et résolvant à la va vite une intrigue minimaliste.
Ultime os à ronger pour assurer une pérennité universitaire au film, ce bouzin aussi excitant qu’un grand verre de coca quand on rêve de whisky se conclu sur une réplique calibrée pour le culte qui fera bander les exégètes zélé du barbu canadien : Je te vois…
Passons sur le relief, une technique ne servant qu’à immerger le spectateur dans le cadre à grands coups de lattes dans le cul.
Pour raconter son histoire Cameron avait-il vraiment besoin qu’on ait l’impression d’avoir les pieds dans la boue ou que le cinéma soit rempli de lianes ?
Pour saisir les astuces de l’intrigue, fallait-il vraiment qu’on perçoive avec une telle acuité la profondeur de champ du secrétariat de Selfridge ?
Il faut croire que oui, car cette combine, c’est une chouette diversion.
Tant qu’on parle de ça, on a quelque chose à dire du film et puis, pour l’industrie, c’est une carotte inespérée pour faire les poches des clients.
En résumé un attrape-couillon de plus et pour ce qui est de la fameuse création numérique, il faut avouer que si les expressions des visages impressionnent, c’est loin d’être le cas lorsque les créatures évoluent de plain pied.
Interaction minimale avec le décor, mouvements gauches et sans consistance…, la révolution du nouveau monde de demain a les mêmes soucis que ceux du monde d’hier.
Ce qui fait la différence tient plus dans le budget que dans le réel bond en avant ventilé par la publicité.
Au-delà de la facture extrêmement consensuelle, je reste consterné par ce que le film choisi d’éluder.
En filigrane on peut apercevoir un autre film, moins caricatural, qui aurait pu expliquer que l’unobtainium est indispensable pour la survie de l’humanité.
Par là même Selfridge aurait gagné en complexité, dépassant son rôle de petit branleur cynique, Quarritch incarnerait une menace moins manichéenne et surtout le dilemme de Jake serait au centre d’un enjeu un peu plus intense.
Si le film peut être ponctué de moments d’émotion (forcée) très ponctuels, aucun souffle épique ne le parcourt.
Quand je parle de souffle épique je parle d’autre chose que de voir des hordes de ptérodactyles tomber du ciel ou 12 indigènes hurler ensemble en levant leurs arcs…
Je parle également d’autre chose que de la symbolique lourdingue qui parsème le film (les ressources et la guerre en Irak, le débarquement de Colomb, la guerre du Vietnam et son imagerie hélico-napalm) qui créé des métaphores creuses dont le récit n’a que faire mais qui contentera le fan voyant en Avatar rien de moins que le reflet de notre monde.
Savoir en sus que son film adoré a été critiqué par les ultranationalistes américains (et quelques intégristes anticlopes) sera la preuve irrécusable de son bon goût et de la légitimité pacifiste de l’ensemble.
Tous les 3 ans un film révolutionne le cinéma, et à chaque fois on a le droit au même air de pipeau joué par les mass-médias à la botte des commerciaux californiens.
Depuis Terminator 2 c’est devenu un marronnier.
Lassant, surtout qu’au final la conclusion est toujours la même : un film ne peut reposer sur ses seuls effets spéciaux.
Dans ce domaine, Cameron, c’est le meilleur et le pire.
Visionnaire et courageux lorsqu’il réalise Terminator il est aussi le propre fossoyeur de ses ambitions lorsqu’il sort une suite aseptisée dont la substance du récit s’efface devant le spectaculaire.
Aujourd’hui, après avoir transformé la SF en sous genre fétide du film de guerre (grâce au très reaganien et très belliciste Aliens), toujours opportuniste dans son époque, il nous exhibe la carte de la conscience écologiste et du discours humaniste.
C’est proprement scabreux, une pirouette commerciale diégétique clashant de manière balourde la promotion du film, finissant de noyer le tout dans un cynisme odieux et désespérant.
C’est le spectacle pitoyable de l’humanisme cameronien pataugeant dans un grand verre de Coca Cola et de sa conscience écologique imprimée sur des emballages de Big Mac, le tout dans le monde entier, qui m’offre la plus belle conclusion.
Un beau résumé pour un film qui trouve sur ces supports sa place idéale.
Venez piloter l’hélico de combat d’Avatar sur le site Coca Cola Zero ou vous faire une tronche de Naa’vi sur celui de McDo !
La réalité dépasse la fiction et l’ignominie capitaliste lorsqu’elle déploie ses ailes sur des milliards de dollars occulterait tous les pires méchants du cinéma.
Selfridge n’est qu’un pantin en carton ondulé face à Ruppert Murdoch et Quarritch a beau éructer sous ses cicatrices, il est bien moins flippant que le King of the World.
Je ne peux même pas me consoler de la plume des mécontents, la plupart des critiques faussement courageuses mais toujours prêtes à se faire remarquer ne font pas illusion dès que pointant le paternalisme dégradant du film, ils regrettent la subtilité d’un Danse avec les loups…
Pauvre de nous…
Alors je vous emmerde, vous, les dévots illuminés qui voient en Avatar le futur, notre futur, car votre foi conditionne notre châtiment.
Et vous qui vous extasiez, priez, pleurez, vous qui vous agenouillez ou qui retournez simplement voir le film, vous portez une lourde responsabilité devant l’Histoire.
Vous êtes les victimes volontaires du gavage de l’industrie cinématographique, vous pensiez vous attabler aux côtés des plus grands alors que vous n’êtes que la dinde qu’on leur sert.
Avatar est à votre image, sans tripe, mais fourré de conneries.