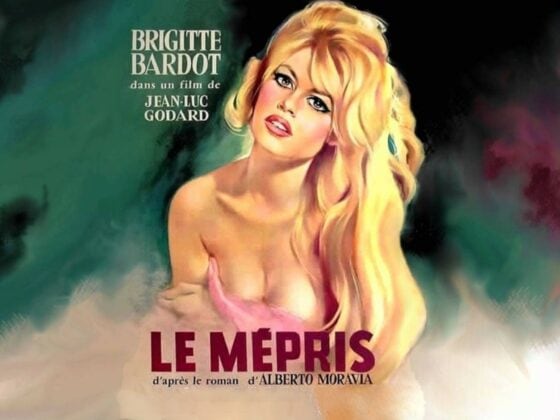C’était un temps où le cinéma ressemblait à l’Olympe…, avec des hommes à moitié dieux… et des femmes complètement divas, c’était au temps des Garbo, Marilyn, Bogart, Dean et Liz Taylor.
Avec cette dernière, la mythologie hollywoodienne allait, dès la fin des années cinquante, prendre des airs d’opéra italien, entre péplum et roman de gare, folie des grandeurs et mélodrame, collection rose et passion guimauve.
Le regard violet de Liz Taylor était un venin trouble…, les hommes pouvaient y laisser leur âme, en bénissant cette couleur de paradis artificiel.
Y perdre aussi la tête, quand ces yeux tournaient (au mieux) au parfum kitsch, (au pire) à l’ivresse de mauvais Bordeaux.
Le vin, l’ivresse se prennent à deux comme on se prend l’un l’autre, jamais chacun sans l’autre…
Boulimique et outrancière, petite fille perdue et monstre castrateur, amoureuse en série et icône des hommes efféminés voire lesbiens (Michael Jackson, Montgomery Clift), éternelle victime et briseuse de ménage abonnée aux scandales (du style qui vient sonner et tambouriner à la porte de son amant pour qu’il se décide enfin à la prendre)…, cette magnifique et extraordinaire “mégère”, définitivement inapprivoisable, était sans doute au cinéma ce que Maria Callas était à l’opéra : une furie qui semait les passions.
Et qui fut adorée, puis brûlée par des tifosis en perte total de contrôle avec la même énergie fiévreuse.
Entre son public et elle, la Taylor ne cessa d’imprimer, pas toujours délibérément, le rythme de ses instincts sensuels.
On la désira autant qu’on la chassa.
On rêva de dompter autant qu’on voua aux gémonies cet animal blessé, dont Joseph L. Mankiewicz aimait à louer le talent primitif…
Liz Taylor connut en somme ce qui eut attendu (si la mort ne l’avait pas libérée prématurément), la fragile Marylin.
Si souvent célébré, le corps d’Elizabeth Taylor devint dans les années ’70 la décharge publique de commentateurs amers, qui ressemblaient parfois furieusement à des amoureux éconduits.
On la moqua.
On la caricatura.
On la traita même dans un film de potache (Les Pierrafeu) de fossile préhistorique !
L’outrance appelait sans doute l’outrance.
Mais on fut injuste avec Elizabeth Taylor.
Car la femme avait prit, dès la fin des années ’50, des risques inconsidérés, en salissant consciemment son image.
Face à Paul Newman dans “La Chatte sur un toit brûlant”, puis plus tard face à Richard Burton dans “Qui a peur de Virginia Woolf”, Elisabeth Taylor fut l’une des toutes premières à oser exposer la fin de l’innocence et l’éclatement du couple, ailleurs conté sur le mode badin (la comédie à l’italienne) ou retenu (Bergman).
Avec Taylor et Burton, la psychanalyse devenait ainsi l’affaire de sauvages, qui inspirèrent peut-être bien plus qu’on ne pense le cinéma, si contemporain, des femmes sous influences cher à John Cassavetes…

Elizabeth Taylor a illustré à plus d’un titre le cliché hollywoodien de la star et notamment dans sa vie amoureuse qui défraya à maintes reprises la chronique.
Avec Burton, elle s’offrit l’adultère le plus célèbre du monde.
Même le pape s’en mêla, condamnant leur liaison qui, selon Radio-Vatican, mettait en péril la santé morale de la société !
Cataloguée briseuse de ménages telle une mante religieuse, elle était une véritable croqueuse d’hommes et savait les mettre à ses pieds.
Richard Burton dira : “Elle est l’amante la plus vorace que j’aie jamais connue”.
Dans “L’oiseau bleu”, de Cukor, Liz incarne l’amour maternel face à Ava Gardner qui est le vice.
Dans la réalité, elle faisait preuve d’une vitalité extraordinaire pour enchaîner les relations à la vitesse grand V.
Elle se maria huit fois avec sept hommes différents.
Ce, sans compter ses amitiés amoureuses avec les plus célèbres homosexuels de Hollywood et sa longue liste d’amants.
Effet de ses yeux violets ?
La brune incendiaire dira : “Le mariage, c’est une période de repos entre deux passions”.
Celle qui fit le plus couler d’encre est sans conteste sa relation tumultueuse avec Burton.
Sur le tournage de “Cléopâtre” où tout démarre, Mankiewicz parle de deux tigres en cage.
Pourtant, avant la rencontre, Liz Taylor était pour Burton Miss Nichons de M.G.M., un pur produit de Hollywood, c’est-à-dire inculte et frelaté.
De son côté, la diva, connaissant la réputation de Don Juan de l’acteur, aurait déclaré : “De toutes les actrices ayant joué avec Burton, je serai la première et la seule qu’il n’aura jamais”.
Dès les premières scènes, pourtant, ils s’embrassent si volontiers que le réalisateur s’époumone en vain à crier “Coupez” !
Burton trouve en Taylor une maîtresse à sa mesure, mais aussi une compagne de beuverie, une boute-en-train, une copine et une conseillère cinéma.
Leur couple explosif vivra dix ans de vie commune, deux mariages, deux divorces.
Au programme : bagarres homériques, mémorables cuites, séparations, retrouvailles.
Dans “Qui a peur de Virginia Woolf ?”, où ils se battent comme des chiffonniers, le couple joue plus vrai que nature et immortalise la plus grande scène de ménage de l’histoire du cinéma.
En pensant à Liz, on pense à cette phrase de Musset qui lui va si bien : “J’ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui”.

C’est une chanson de Jacques Duvall : “Elizabeth Taylor/Retire lentement/Son peignoir lamé or/Ses bas et ses diamants/En sifflant du Gershwin/Et du Jack Daniels/Elle dénude sa poitrine/La plus belle c’est bien elle”… et cette chanson dit tout.
La beauté, la sensualité, le goût des pierres précieuses et de l’alcool, la fascination qu’elle a exercés et qu’elle exerce encore sur les hommes et les femmes, sur les amoureux du cinéma et sur les autres.
Elle était née en Angleterre le 27 février 1932.
Elle est morte mercredi 23 mars 2011 à Los Angeles.
Elle a bien vécu.
Comme une star et comme une femme : avec passion.