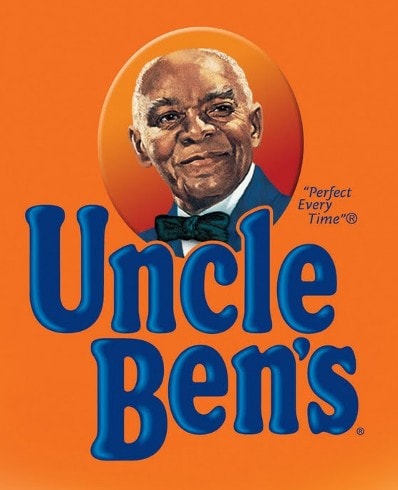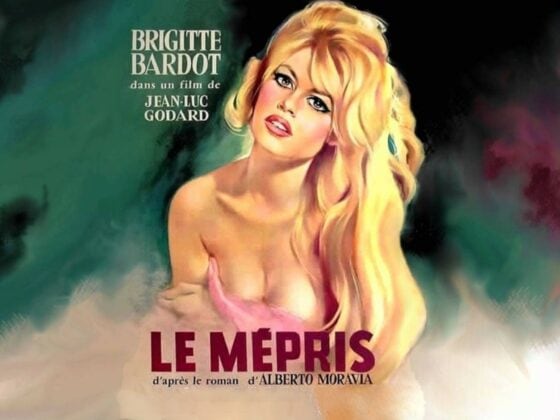En sortant du cinéma, la première chose que j’ai dit résume tout…
Ces américains, quand même, ils donnent des leçons de morale à la terre entière pour justifier leur manière d’être, mais la réalité est que ceux qui sont arrivés avec Colomb et sa suite… puis avec le Mayflower et sa suite…, sont des européens, nos ancêtres… et ils ont massacré les amérindiens (les indiens des films Hollywoodiens)…, importé des esclaves d’Afrique (une part de ce qu’aborde magistralement Tarantino dans Django Unchained) pour s’en servir pire que du bétail (il faudra attendre les années ’70 pour que les noirs fassent partie réellement de la nation USA Lisez en bas de page :* L’abolition de l’esclavage ne fut pas la motivation de la guerre de Sécession qui déchira le pays)…, largué deux bombes atomiques expérimentales sur les populations civiles d’Hiroshima et Nagazaki…, massacré les populations civiles de Corée, du Viet-Nam, de divers pays d’Amérique du sud…, poussé sous menace les pays du monde a accepter la création d’Israel en terre Palestinienne… et organisé les pires perversités afin d’avoir le prétexte d’envahir l’Afghanistan, l’Irak et de f… le souk en Géorgie, en Serbie, en Tunisie, en Libye, en Egypte, en Syrie et bientôt en Iran…
Ce sont eux aussi qui perpétuent la peine de mort, la condamnation à 20 ans de prison ferme pour 3 infractions identiques, qui autorisent et pratiquent la torture et l’enfermement à vie sans motif, sans inculpation et sans procès…
Et j’allais oublier que ce sont eux aussi qui se donnent le droit de tuer n’importe qui via des drônes tueurs sous prétexte d’un contact avec le “terrorisme” (un terme fourre-tout)…, qui ont totalement anéanti l’économie mondiale, avec l’abandon du droit de “frapper la monnaie” à un groupement privé (la Fed)…, qui ont organisé une gabegie financière en supprimant que le dollar soit basé sur la richesse réelle convertible en or stocké… et en inventant les Subprimes vendues aux banques du monde entier !
Les américains, nos sauveurs ?
Mon oeil !
C’est donc ça que j’ai ressenti après avoir vu Django Unchained…
Ensuite, j’ai été frappé par la question posée par le personnage sinistre joué par Léonardo diCaprio : Pourquoi les noirs ne se sont-ils pas révoltés, pourquoi n’ont-ils pas tués leurs oppresseurs ?…
Les Amérindiens ont essayé, mais c’était un crime que pour eux se défendre…
Et ailleurs, un parallèle peut être fait avec les Juifs de la Shoah, si chacun d’eux avait ne fut-ce que tué un Nazi, il n’y aurait pas eu d’holocauste…
De là à penser qu’Israël existe à cause de la Shoah, c’est encore une fois le fait des USA…
Et maintenant, si un Palestinien se révolte pour Yer Dassim ou Gaza, si un Libanais hurle sa rage pour Chabra et Chatila, su un Afghan ou un Irakien se lève pour dire à juste titre que son peuple est assassiné…, c’est pareil que dans le film de Tarantino, il est torturé pour être l’ami des “terroristes”…
Alors, Django Unchained est une fiction passéiste, ce que les noirs auraient du faire, plutôt que jouer soit les soumis…, soit la pute du Maître…, soit, pire, le garde-chiourme ami du Maître (dans ce rôle, Samuel Jackson est extraordinaire, fourbe, pervers, sadique, obséquieux…, pire encore que les négriers blancs)…
C’est la force du film…
Pour le reste.., .Tarantino s’amuse à vampiriser jusqu’à la moelle le western spaghetti et le western en général (mais le film est beaucoup plus que ça, assurément, et plus tripant que True Grit qui se plantait en beauté).
Film fleuve de 2h44 flirtant avec le genre tout en cherchant à le réinventer, Django unchained balance la dose sans complexe, bien loin d’une polémique dont la majorité des gens cherche encore à comprendre le sens alors qu’il m’est apparu de la manière dont je vous le narre en début de ce billet d’humeur.
Alors quoi ?
Nigger or not nigger ?
Le contexte historique s’y prête pourtant sans hésitation.
Fallait les appeler, comment les esclaves noirs de l’époque, réduits à pire que des animaux, pour “choquer” personne ?
Cher monsieur et chère madame !
La grande Histoire se déplace de l’Europe (Inglourious basterds) à l’Amérique pour raconter une période tout aussi trouble et honteuse que les États-Unis digèrent encore mal, celle de l’esclavage, évoquée ici dans sa forme la plus sombre et la plus crue.
De fait, certaines scènes sont costaudes : esclave mâle déchiqueté par des chiens, esclave femelle enfermée dans une boîte en ferraille en plein cagnard, obligé de se battre jusqu’à la mort, fouetté(e) sans pitié…
Et quand Django se retrouve nu attaché par les pieds prêt à se faire arracher les couilles, on frémit d’horreur parce que la réalité devait être sacrément dans ce goût-là.
Tarantino prend son temps (un peu trop même et le film souffre d’une mise en place laborieuse) pour dérouler son histoire de vengeance et de renaissance puisant son inspiration dans la légende allemande des Nibelungen et son célèbre Siegfried “là-bas dans la forêt” (genre choc des cultures : c’est un peu le spaghetti qui rencontre la schupfnudel).
En gros, aller délivrer la princesse retenue prisonnière et faire triompher l’amour et la justice.
Soit la femme de Django séquestrée dans une plantation du Mississippi, devenue catin pour dégénérés noirs et blancs aux mains de l’ignoble Calvin Candie (joué par Léonardo diCaprio).
On est en plein vigilante movie, loi du Talion, œil pour œil et tout le bazar (Kill Calvin) ; Django a les nerfs, frétille de la gâchette (qu’il a fine), veut faire mordre la poussière et galope dans le far-west au cul de ses vils ennemis pour sauver sa dulcinée, mais sans cercueil à trimballer (ici c’est une roulotte avec une énorme molaire dessus montée sur ressort : pas la classe de la caisse en sapin, mais c’est franchement comique).
Tarantino ne lésine évidemment pas sur la violence, lancé sur les traces de Leone ou d’un Peckinpah (filiations évidentes) dopé comme un fou ; le sang gicle en gerbes démesurées, affolantes, sidérantes, et le gunfight final prend des allures de chorégraphie dingo et juteuse à La horde sauvage ou Scarface.
Il ne lâche pas non plus son art du dialogue et de la rhétorique, de la litote et de l’oxymore, en abreuvant jusqu’à la lie un script à l’intrigue microscopique.
Là où Inglourious basterds pêchait par vantardise et par mollesse, Django unchained crépite d’un feu certain, cinéphilique et atypique : on est en terrain tarantinesque archi-connu (surenchère d’hémoglobine, faste référentiel, bande-son superlative) et en même temps ravivé, c’est drôle (la scène des cagoules), enlevé et interprété avec gourmandise.
Les acteurs justement, à la fête comme jamais :
Christoph Waltz, chasseur de primes éloquent, élégant, dont la verve et l’ironie font mouche à chaque mot.
Jamie Foxx, sobre et puissant en vengeur à lunettes dont les goûts vestimentaires laissent parfois à désirer (Leur duo, incongru au début, est ensuite d’une parfaite logique, irrésistible surtout, genre vieux couple prêt pour la noce).
Samuel L. Jackson, magnifiquement odieux en maître larbin passé du côté obscur.
Et puis il y a Leonardo diCaprio, impérial carrément en riche propriétaire aux chicots pourris dont l’exquise suavité n’a d’égale que l’ignoble perversité.
On peut croire qu’il cabotine le Leo, mais non, son regard intense, habité, suffit à comprendre qu’il est dans le ton, dans la justesse, dans le truc quoi.
Tarantino le sait, le chérit, lui fait les yeux doux et lui offre des séquences de haute volée (la scène du crâne par exemple).
Plus toute une série de crapules et de seconds rôles sortis des Enfers (Don Johnson, Walton Goggins, Bruce Dern, M. C. Gainey…) et y retournant avec du plomb dans la gueule.
Jubilatoire même dans ses défauts et ses débordements, Django unchained se gausse d’une humanité répugnante et vautrée dans sa fange (tueurs sans scrupules, avocat véreux, shérif louche, péquenauds, couards, racistes, bouseux…), exactement semblable à ce qu’est véritablement l’Amérique… vis-à-vis du reste du monde !
Du coup, vive Tarantino…
* L’abolition de l’esclavage ne fut pas la motivation de la guerre de Sécession qui déchira le pays.
Le poncif veut que cette guerre fratricide fût déclenchée par Lincoln (une audace qu’il paya de sa vie) pour libérer les Noirs…
Et permettre, un siècle et demi plus tard, à un Obama d’occuper la Maison-Blanche ?…
Raccourci séduisant.
Mais l’historien américain James Mc Pherson rétablit quelques vérités à ce propos.
Demeurent les faits.
Terribles.
Une guerre entre voisins, entre cousins : 617.000 morts du 12 avril 1861 au 9 avril 1865 : un bilan plus lourd, pour les Américains, que celui de la Première Guerre mondiale (120.000 morts) et la Deuxième (400.000) réunis.
Et des plaies symboliques, profondes.
Il n’est guère aisé d’appréhender ce conflit de civilisations, dès lors que l’on choisit de sortir des clichés.
La plupart des historiens s’accordent en tout cas à reconnaître que ce fut avant tout une guerre capitaliste, entre un Nord industriel et libre-échangiste et un Sud agraire où, pour des raisons de compétitivité à l’exportation, la monoculture du coton exigeait une main-d’œuvre abondante.
Et qu’elle laissa intacts les préjugés raciaux.
Qu’il suffise de glisser que ce n’est qu’en 1967 (bien « mille neuf cents soixante sept) que la Cour suprême jugea anticonstitutionnelles les lois interdisant les mariages mixtes entre individus de couleurs différentes.
Et pour le coup, Lincoln, n’est pas exempt de reproches : “Je ne veux que leur soumission et l’arrêt des combats. Accordez-leur les conditions les plus généreuses”, ordonna le Président au général Sherman, le tombeur de Richmond.
Dans ces conditions : “Comment la race noire peut-elle obtenir l’égalité politique dans les États où, hier encore, elle était soumise à la plus dure oppression”, s’interrogeait déjà un observateur français, un an seulement après l’armistice…
Mais d’un autre côté, comment ne pas sortir perplexe d’un ouvrage qui fit florès dans le Sud, I’ll take my stand, publié par douze intellectuels du cru (Twelve Southerners), qui met en procès la civilisation mécaniste : “La capitalisation des sciences appliquées qui a réduit nos énergies à un esclavage dont on éprouve aujourd’hui clairement la rigueur en lui opposant la civilisation agricole du Sud, où une ferme n’est pas faite pour récolter des dollars, mais pour récolter du blé” ?
Si la civilisation bucolique, raffinée et individualiste du Vieux Sud peut avoir son charme en ce XXI ième siècle à bien des égards inhumain, il convient tout de même de rappeler qu’elle fut créée à son seul profit par une minorité, et construite sur l’esclavage de près de 4 millions d’Afro-Américains.
Un “détail de l’Histoire”… pour lequel la Chambre des représentants ne présentera des excuses qu’en 2008 !

Le Django de Tarentino, ou la black exploitation…
Quelques longueurs et quelques petites surprises pour ce film de Tarentino, très noir… S’il existe bien quelques réalisateurs de films que je n’aime pas, dont David Linch, Tarentino est en tête de liste, mais lorsque celui-ci fait appel à Léonardo Di Caprio, la curiosité me pique…
Hier soir donc, famille recomposée au complet ayant envie d’aller voir un bon film du samedi soir, j’avais le choix entre Lincoln, Fligth et Django…, le vote a élu Django à la majorité… Youpie ! J’ai échappé à Flight, le film d’avion-catastrophe que Patrice voulait absolument voir… Django Unchained tenait en effet de belles promesses en visionnant la bande-annonce… et puis, si Léonardo est plan rapproché face à moi, pourquoi et comment résister ?
Ben oui, le déclencheur, pour moi, c’est lui !
Et il est aussi l’atout majeur du film ! Le parfait méchant (en sus de Samuel Jackson), c’est Di Caprio…
Je l’attendais avec impatience pendant le premier tiers du film ou coulait des hectolitres d’hémoglobine… et pas de déception, même s’il arrive un peu tard dans le scénario, (le film dure 2h44), hélas, il disparaît trop tôt, là où on ne l’attend pas… Pour ne pas gâcher la surprise pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore vu, je ne dévoilerai pas comment le sinistre négrier va s’en sortir…
Un classique sans être tout à fait un classique du genre pour un faux western spaghetti, un petit clin d’oeil à Sergio Léone mais surtout un solide coup de poing a Sergio Corbucci, avec l’apparition d’un Franco Nero vieilli, forcément, mais toujours aussi beau…
Corbucci, auteur du “Django” (l’original de 1966), qui n’a jamais égalé le maître Léone, mais dont les films possédaient un véritable charme, voire de réels atouts que vampirise son faux remake américain…
Si l’admiration que voue le cinéaste américain à Corbucci est sincère, on ne peut s’empêcher d’y voir une certaine condescendance, y compris dans la façon de pousser à l’extrême certaines spécificités du genre, l’idée de départ basique reste toujours la même : des effusions de sang à la limite du gore, un second degré assumé et un pseudo humour noir… qui paraissent surannés…
Oppression des noirs et vengeance dans le but de retrouver une esclave noire (la femme de Django)…
J’avais un peu crainte d’être éclaboussée d’un geiser d’hémoglobine, mais les corps qui explosent dans un déluge de tripes et de sang est tellement irréel, translucide, (plutôt grenadine avec beaucoup d’eau que du jus de tomate), j’ai quand même fermé les yeux lors d’une scène particulièrement horrible (la scène ou les chiens dévorent un esclave)…
Evidemment, Tarantino a un incontestable sens de la mise en scène et plus de talent que les réalisateurs de série B dont il s’inspire…, mais il est tout d’abord un excellent directeur de casting et d’acteurs…
De temps en temps créatifs, parfois justes, où trois acteurs donnent au film une intensité qui s’évanouit dès que l’on en revient au personnage principal, car Jamie Foxx, en Django, héros du film, n’est pas à la hauteur de ses partenaires !
Dès qu’il occupe le devant de la scène, le film s’enlise dans la parodie et un peu dans l’ennui…
Je baille…
Ce qui sauve la fin du film est finalement l’Oncle Bens,(Samuel Jackson) ici, en beaucoup moins sympatique que celui qui nous sourit devant l’eau qui frémit…
Quant à Kerry Washington, pourtant si belle, son personnage semble peu intéresser le réalisateur, à se demande bien pourquoi il nous l’inflige…
L’attention du spectateur comme du réalisateur se portant uniquement sur les seconds rôles (une première pour un réalisateur qui soigne tant les premiers d’habitude)… Au fond, la grande force de Tarantino, sa manière à lui de cacher certaines faiblesses, c’est d’écrire et de filmer d’incroyables face-à-face, des monologues inattendus qui rentreront dans l’imaginaire collectif…
Django peine à devenir autre chose qu’un film à sketchs alternant moments de bravoure et longueurs pesantes…, même si la photo est belle ainsi que quelques morceaux de musique…
La véritable nouveauté réside dans ce que Tarantino n’a pas tiré de ses influences, mais qu’il a lui-même mis à jour une description de l’esclavage parmi les plus brutales, les plus poignantes que l’on ait vues au cinéma…
Les séquences laissent entrevoir ce que serait le cinéma de Tarantino s’il était enfin débarrassé de l’accumulation de références qui finissent par parasiter son œuvre…
Tant qu’il utilisera sa cinéphilie comme une béquille, son cinéma sera à l’image de ce Django, traversé d’éclairs de génies mais aussi de facilités…
Tarentino aime que ses films soient reconnaissables au premier coup d’œil…
Pari réussi ?
Il est le seul à préférer dédier son talent à des cinéastes moins talentueux, mais qui possédaient une qualité qu’il n’a pas (encore) : l’audace…
Osé, mais pas assez pour que ce film reste dans ma mémoire, j’aime pas Tarentino… A voir tout de même…
Lorenza