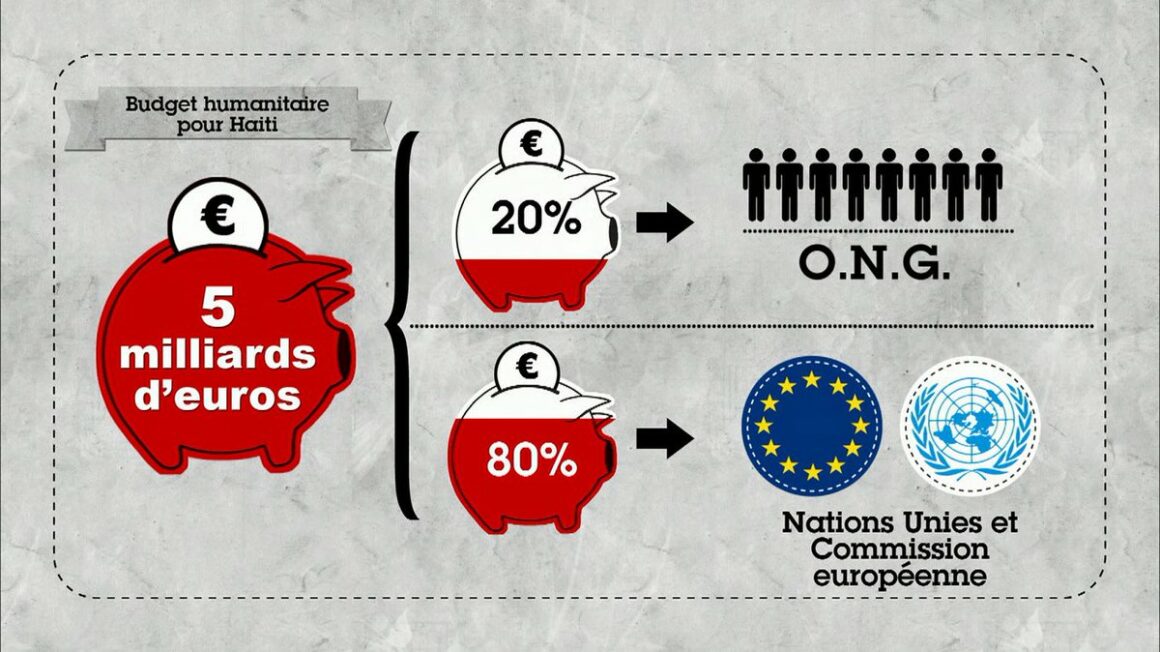La joie dans les cœurs, la générosité, l’amour entre les peuples !
Flash sur le charity business, ou comment les stars font leur BA, pour le meilleur et pour le pire !
Le charity business, c’est tout simple : un chanteur connu défend une cause connue en interprétant des chansons connues…, ça marche aussi avec des acteurs, des sportifs ou des humoristes.
A l’image des Enfoirés ou de certaines chansons devenues des classiques (We Are The World de Michael Jackson et Lionel Richie enregistrée par le groupe de musiciens USA for Africa), ces opérations ont rencontré un succès incontestable, au point qu’on en oublie presque parfois la cause qu’elles défendaient.
Mais à force d’être omniprésente, cette pratique pleine de bonnes intentions n’est-elle pas sur le point de saturer ?
Organisé par George Harrison et Ravi Shankar, bénéficiant de la présence de Bob Dylan, Ringo Starr ou Eric Clapton, le Concert for Bangladesh, premier grand concert de charité, avait pour objectif de sensibiliser l’opinion publique sur le désastre qui avait frappé la population bengalie, touchée par une tempête, puis décimée par l’exode que celle-ci avait entraîné.
A l’époque, George Harrison avait déjà compris que, dans une société de starification à outrance, le sponsoring d’une noble cause suffit à attirer l’attention des médias et du public.
Aussi absurde que cela puisse paraître, une vie vaut plus chère lorsqu’elle est défendue par un type ayant vendu son dernier disque par camions entiers.
Puisque cela marche, pourquoi ne pas en profiter ?
Le Concert for Bangladesh fut un succès qui en appellera beaucoup d’autres.
Les opérations de charité sont devenues si nombreuses et certaines ont eu un tel impact culturel qu’elles pourraient avoir leur propre rayon chez les disquaires.
We Are The World est sans doute le titre caritatif le plus célèbre.
Mais c’est le Band Aid qui remporte la palme du plus grand super groupe : Bob Geldof, à l’origine de cette formation en 1984, réunit en effet autour de lui pas moins d’une cinquantaine de stars de la pop !
D’abord exclusivement aux mains des musiciens, ce vent de “générosité” gagne petit à petit toute personne connue au-delà de son pâté de maisons : la troupe des Enfoirés s’est ainsi élargie pour accueillir des sportifs ou des comiques.
On retrouve leur esprit charity business à travers leur concert annuel en faveur des Restos du Coeur ou dans des chansons créées spécialement pour une occasion (par exemple Sa raison d’être, parue en 1998 au bénéfice de la lutte contre le sida).
L’utilité de ces initiatives n’est plus à démontrer : elles ont permis de récolter des fortunes qui s’en sont allées pour la plus grande partie dans la poche des organisateurs.. et aussi des chanteurs !
Et surtout, elles ne nous ont pas toujours offert pléthore de chefs-d’oeuvre.
On pourrait presque avancer que les plus grandes catastrophes de notre temps ne sont pas les ouragans ou les guerres, mais bien les disques qu’ils ont engendrés.
Dans un album caritatif, le produit d’appel est malheureusement les noms prestigieux qui s’y associent et non leur musique, reléguée au second plan (d’où l’omniprésence des reprises).
La volonté de créer des hymnes fédérateurs et universels accouche par conséquent de morceaux emphatiques, écrits en vitesse et tous très similaires : combien de We Are The World ou de Chanson pour l’Ethiopie braillés par cinquante personnes en même temps, une fille s’extrayant de la mêlée pour effectuer une petite acrobatie vocale sur le dernier refrain ?
Bob Geldof, l’initiateur du Live Aid en 1985, fait preuve à ce sujet d’une géniale autodérision : “Je suis responsable des pires disques de l’histoire de la pop !”
L’objectif de ratisser le plus large possible implique souvent les groupes les plus en vogue, donnant à ces opérations une portée éphémère : que représentent aujourd’hui Ultravox et Bananarama, des groupes intégrés au Band Aid mais qui n’ont pas survécu aux années 1980 ?

Plus gênant, la médiatisation de l’action humanitaire fait apparaître une charité-spectacle qui n’a plus grand rapport avec les valeurs qu’elle prétend véhiculer.
Les opérations de bienfaisance font ainsi paradoxalement étalage du plus grand luxe : elles couronnent une sorte de jet-set pop et s’accompagnent de partenariats publicitaires, de galas de charité en tenue haute couture ou de méga-concerts dans les stades.
Tout ce que la musique offre de pire !
A l’image des Enfoirés, les artistes sont devenus des professionnels de la charité, une charité théâtralisée, une sorte de chantage émotionnel dont le moteur reste la pitié et la mauvaise conscience : on frôle le mauvais goût lorsque pour convaincre le client, un chanteur se sent obligé de faire figurer dans son clip un quota de petits Noirs tout maigres souriant à la caméra.
Peut-on réduire l’action humanitaire à ce manège médiatique ?
En la détournant d’une réalité plus complexe et moins glamour, le charity business n’est-il pas en fin de compte contre-productif ?
Mais on aurait tort d’attribuer au charity business des problèmes qui sont d’abord ceux de l’humanitaire tout entier.
Rares sont les catastrophes qui échappent aujourd’hui à la circulation planétaire des informations.
On a ainsi l’impression que le nombre d’inondations ou de famines augmente.
Le nombre d’ONG a explosé en trente ans, au point qu’un véritable marketing de la générosité s’est mis en place.
Ce sont désormais les associations humanitaires qui vont vers les célébrités pour s’attacher leur image.
“La charité est devenue un produit de consommation de masse”, constatait Bernard Kouchner dès 1986.
Dans cette course au don, le message humanitaire s’est brouillé, sa portée s’est réduite et le malheur s’est banalisé : le grand public n’identifie plus qu’un ensemble de “grandes causes”, sans plus de précision, comme si cette étiquette regroupait tous les sida, réchauffements de la planète et guerres dans des pays lointains dont le nom se termine en “-istan”.
Les artistes ont suivi le mouvement, d’où cette impression qu’ils attendent parfois une catastrophe pour sortir un disque.
L’exemple caricatural, c’est le Live 8 de l’été 2005 : dix concerts partout dans le monde pour dire “Non à la pauvreté”.
La fausse sincérité des artistes présents était pathétique !
On pourrait en dire autant de la chanson Et puis la Terre, dont Patrick Bruel et ses amis chanteurs se sont fendus début 2006, en donnant le sentiment de surfer sur la vague du Tsunami, un désastre qui n’avait pas besoin de coup de pouce pour émouvoir le grand public.
Forcément, la méfiance s’installe, il faut bien admettre que les grands rassemblements du style USA for Africa n’ont jamais été purement désintéressés : c’est une forme de consécration d’y être convié.
De la même manière, un chanteur qui intègre la troupe des Enfoirés est en quelque sorte adoubé par le milieu.
Mais à l’image du Live 8 ou de sa déclinaison Live Earth de l’été 2007, dénonçant cette fois le réchauffement de la planète, le charity business s’est mis à revendiquer tout ce qui lui passait sous la main.
Les concerts de bienfaisance sont presque devenus une étape obligée, au même titre que la promotion d’un album.
Cette surenchère de bons sentiments ne répond pas à un élan naturel, elle est imposée au public jusqu’au bout de l’absurde, tel Bob Geldof (encore lui), organisant un second concert planétaire, cette fois-ci pour la dette du tiers monde qui n’en a jamais vu le moindre cents…, escroquerie géniale qui a propulsé Bob dans la sphère des méga milliardaires avec, en prime, une accolade décorative de la reine d’Angleterre… tandis que les chanteurs et chanteuses complices, souvent au bord du gouffre, retrouvaient le succès !
L’overdose est proche : parmi les nombreuses opérations de bienfaisance, seules celles qui sont installées depuis longtemps (le Téléthon) ou qui offrent un produit artistique de qualité (les Solidays) surnagent.
Les autres laissent de plus en plus indifférent.
A force d’être cuisiné à toutes les sauces, le charity business n’a plus aucun goût et a atteint son seuil d’inefficacité.
Prochaine étape, sa disparition ! On peut affirmer que le charity business est une absurdité.
Où est passée la volonté propre d’un public que seules ses idoles peuvent convaincre de faire preuve de générosité ?
Pourquoi la somme récoltée par une association est-elle proportionnelle au prestige de la star qu’elle aura débauchée ?
Rien de bien noble là-dedans.
Sans compter le risque non négligeable de déresponsabilisation des pouvoirs politiques, à qui il revient normalement de gérer les conflits et autres crises humanitaires.
Au point que le possible déclin du charity business n’est peut-être pas une mauvaise chose.
Quelle meilleure nouvelle pour le véritable altruisme et pour la musique que de le voir réduit à l’inutilité…