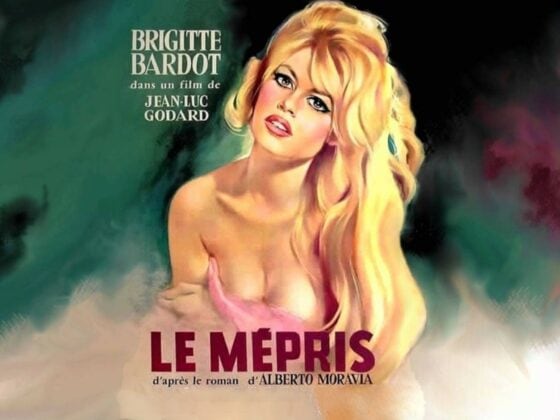La vogue des remakes pourrait laisser croire que les scénaristes de Hollywood sont en panne d’inspiration…, en fait, ce sont surtout les producteurs qui, rendement financier oblige, préfèrent s’appuyer sur des œuvres qui ont déjà fait leurs preuves.
Le cinéma, dit-on parfois, est une industrie du prototype.
Il possède en effet cette particularité de mettre sur le marché des produits uniques.
Incapables de prévoir la réaction du public, les producteurs prennent le risque d’un retour sur investissement médiocre, voire d’une perte sèche.
Aussi cherchent-ils à réduire la part d’incertitude en s’appuyant sur des -œuvres qui ont déjà fait leurs preuves : ce que les professionnels appellent un presold concept, un concept prévendu.
Comme le disait Henri-Georges Clouzot : “pour faire un bon film, il faut premièrement une bonne histoire, deuxièmement une bonne histoire, et troisièmement une bonne histoire”.
Pour trouver la bonne histoire, celle dont on peut penser qu’elle plaira parce qu’elle a plu, tous les domaines sont mis à contribution : littérature, bande dessinée, théâtre, histoires vraies, séries télévisées et… cinéma.
Car les films ne se contentent pas de distiller des références à d’autres films ou d’en imiter les trouvailles formelles : ils peuvent aller jusqu’à en reprendre intégralement le scénario.
Les remakes peuvent correspondre à une ambition d’auteur, mais ils sont d’abord et massivement une réponse aux soucis des producteurs.
Le phénomène n’est pas nouveau : il a presque commencé avec le cinéma.
Les grandes ruptures technologiques (avènement du film sonore à la fin des années 1920, généralisation de la couleur dans les décennies suivant la Seconde Guerre mondiale…) ont rendu obsolètes les œuvres réalisées avec les moyens anciens : quels que soient leur qualité et leur intérêt, ces films passaient irrémédiablement au statut de monuments historiques, qui n’est pas le label le plus susceptible d’attirer les foules dans une salle obscure.
Cecil B. DeMille avait triomphé en 1923 avec Les Dix Commandements?; muet, en noir et blanc, le film fut bientôt invisible.
En 1956, le même réalisateur en fit un remake resté célèbre, dont les effets spéciaux du dernier cri n’étaient pas le moindre des arguments commerciaux.
La même année était distribué L’Homme qui en savait trop, où Alfred Hitchcock refaisait son propre film anglais de 1934, en y ajoutant de la couleur, des stars internationales et une patte plus assurée : “le premier était l’œuvre d’un amateur de talent, le second celle d’un professionnel”, dira-t-il à François Truffaut.
Il est rare cependant que cette forme d’actualisation soit mise en œuvre par la même personne.
Le grand succès français de 2004, Les Choristes (signé par Christophe Barratier), était le remake d’un film de 1945, La Cage aux rossignols (réalisé par Jean Dréville).
True Grit, le western des frères Coen qui a fait une belle carrière en 2010-2011 (250 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 38 millions), est le remake d’un film de 1969 réalisé par Henry Hathaway.
Dans ces derniers cas, la langue restait la même entre les deux versions.
Mais dès l’apparition du parlant s’est posée la question, toujours actuelle, de la barrière linguistique.
Il y eut une période où les studios élaboraient des films en multiversion, les décors étant conservés et l’équipe changée, afin de produire en une fois un film américain et un film français…
La solution du doublage a connu des fortunes diverses : bien acceptée en France, par exemple, mais rejetée aux États-Unis, qui restent le marché dominant.
À côté de ces remakes qu’on pourrait qualifier d’internes (les majors puisant dans leur catalogue, les réalisateurs dans leur cinéma national) existent des remakes externes, qui visent à adapter un film étranger à une culture locale.
Les Sept Samouraïs d’Akira Kurosawa évoluaient dans le Japon du XVIe siècle?; Les Sept Mercenaires de John Sturges vivaient des aventures semblables dans le Mexique de la fin du XIXe.
Les frères Weinstein, producteurs hollywoodiens, ont récemment annoncé leur intention d’en produire un remake, qui sera situé en Thaïlande à l’époque contemporaine.
Mais plus que dans les classiques, c’est dans les films de genre – dont est friand le public recherché, composé d’adolescents et de jeunes adultes –, que puisent les studios américains.
Après une vague de comédies françaises dans les années 1980 (à la suite de Trois hommes et un couffin, de Coline Serreau), ce sont les films d’horreur japonais qui sont passés à la moulinette du made in Hollywood, à la fin des années 1990.
The Ring a été un succès au Japon en 1998 avant de devenir une machine à cash américaine à partir de 2002, des suites ayant exploité le filon jusqu’à épuisement.
Le remake avait coûté 48 millions de dollars?; il en a rapporté 250, dont la moitié en dehors des États-Unis.
L’affaire est d’autant plus rentable que ces remakes ne se contentent pas du marché américain : ils peuvent s’exporter partout, y compris dans le pays de la version originale.
La domination culturelle américaine s’appuie sur un savoir-faire redoutable pour vendre ses produits à l’exportation.
La première de ses armes est évidemment la présence de stars d’envergure mondiale.
Le thriller romantique Anthony Zimmer de Jérôme Salle a rassemblé près de 800.000 spectateurs en France en 2005?; cinq ans plus tard, sa version américaine en fera autant.
Mais rebaptisé The Tourist et propulsé par les très bancables Angelina Jolie et Johnny Depp, ce remake aura rapporté près de 280 millions de dollars, dont les trois quarts à l’exportation.
Pour gagner en temps de préparation, il n’est d’ailleurs pas rare que les studios demandent directement au réalisateur de l’original de prendre en charge son remake.
Quelques voix reprochent à Hollywood de ne plus rien inventer et d’écraser les autres cinémas.
La réalité est plus nuancée.
Les grands cinémas nationaux (France, Corée, Japon, Inde) résistent assez bien et le remake n’est pas une exclusivité américaine.
De battre mon cœur s’est arrêté de Jacques Audiard, sorti en 2005, est le remake d’un film oublié de James Toback (Fingers, 1978).
Cependant, la plupart des remakes sont des modernisations de films nationaux : The Housemaid de Im Sang-soo (2010) est le remake du classique coréen La Servante de Kim Ki-young (1960)…, ou des adaptations locales de films étrangers.
Fort de son immense succès populaire en France, Bienvenue chez les Ch’tis (Dany Boon, 2008) a fait l’objet d’un remake en Italie (Benvenuti al Sud), qui a rassemblé près de 5 millions de spectateurs.
Aux États-Unis, Will Smith a acheté les droits du film mais semble avoir du mal à monter une adaptation satisfaisante.
Poids lourd du box-office espagnol en 2010, Tres metros sobre el cielo est le remake hispanique du succès italien de 2004 Tre metri sopra il cielo, et des déclinaisons française et allemande sont envisagées.
Dans le prolifique cinéma indien, les échanges se font entre les langues de la production : hindi, tamoul et télougou.
Cependant, les succès hindi s’exportent en version originale à la fois pour le public de la diaspora (en Amérique du Nord) et dans les régions traditionnellement sensibles à ces divertissements à la fois populaires et codifiés (les pays arabes en particulier).
Mais Hollywood et Bollywood se sont récemment rapprochés, notamment avec l’entrée de Disney dans des coproductions indiennes.
On peut prévoir qu’un jour ou l’autre les studios américains s’aventureront dans un remake de ce style particulier.
En attendant, les grandes machines bourrées d’effets spéciaux générés par ordinateur continueront sans doute de former les remakes les plus prisés, les plus chers et les plus rentables.
En 2010, Le Choc des Titans (la première version de ce péplum fantastique date de 1981) a cumulé près de 500 millions de dollars de recettes tous pays confondus.
La suite a logiquement été aussitôt annoncée.
Car, dans le mouvement qui bouleverse l’industrie, la mode des remakes n’est pas ce qui devrait le plus la transformer.
Les mots les plus fréquents à Hollywood sont désormais franchise, prequel (ce qui s’est passé avant) et sequel (ce qui s’est passé ensuite), ou reboot (une nouvelle version du film qui fonde une série).
Pour amortir les risques, les studios misent sur la possibilité d’exploiter une histoire sur plusieurs films, à la façon de la saga Star Wars, lancée par George Lucas en 1977 et qui continue de générer des recettes.
Une franchise cumule la force du concept déjà vendu et le pouvoir de captation de la série.
Un simple coup d’œil sur le box-office permet d’en mesurer l’efficacité : en 2010, sur les dix films les plus rentables dans le monde, la moitié -faisait partie d’une franchise (Toy Story 3, Shrek 4, il était une fin, Iron Man 2, Twilight, chapitre 3 : hésitation, Harry Potter et les Reliques de la mort).
La durée de vie multipliée des licences et produits dérivés facilite la trésorerie, tandis que le marketing bénéficie de l’inertie des premiers succès.
Ce n’est pas la fin des prototypes, puisque la suite du cycle dépend de l’accueil réservé au premier film, qui reste un pari incertain.
Mais c’est assurément la prime à un certain type de narration, volontiers épique, qui conjure avec une inquiétante insistance le temps qui passe, vieillit les héros et voue les mythes à l’oubli.
Le cinéma rêve d’une histoire sans fin qui ressemble à la fin de l’histoire.