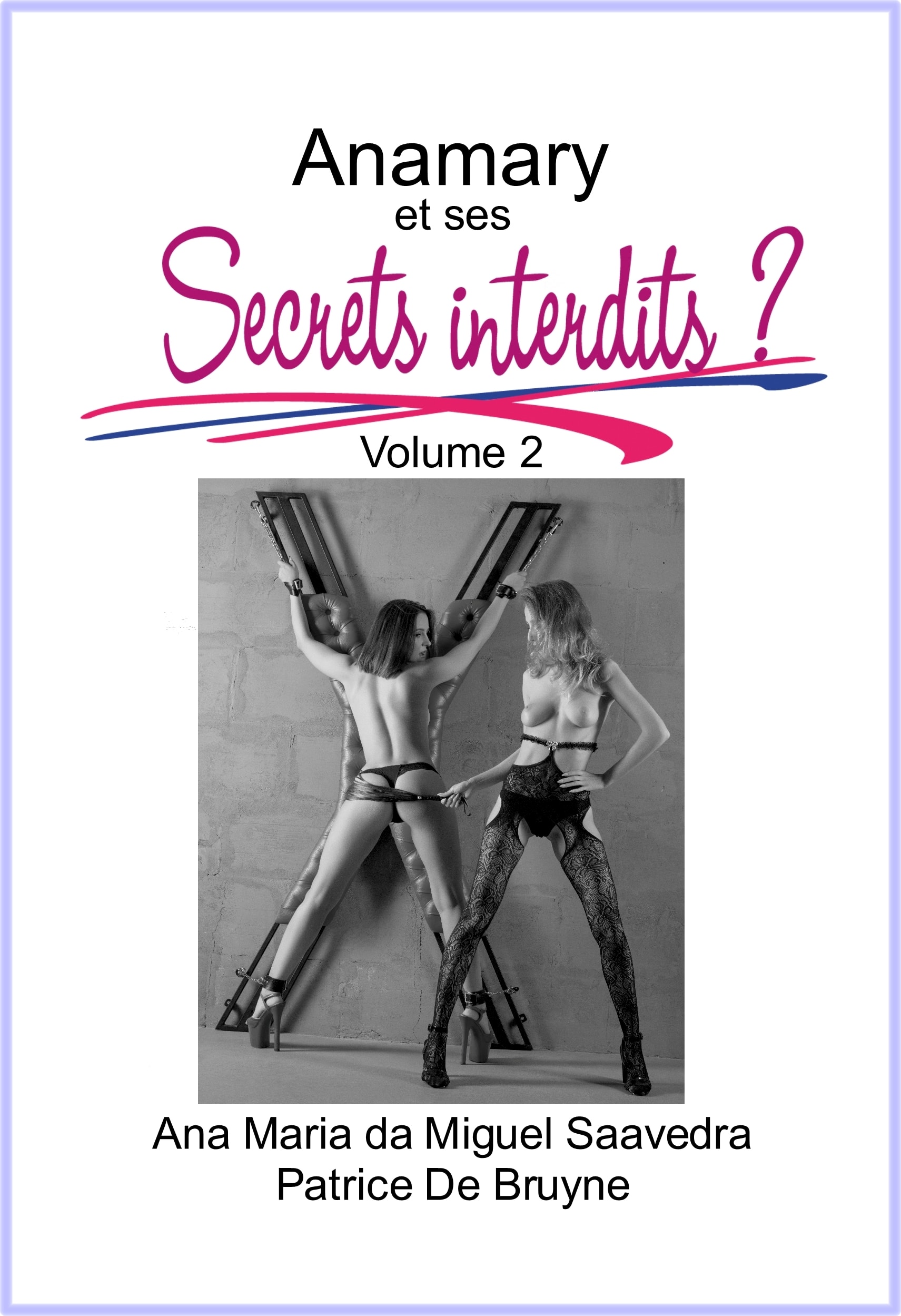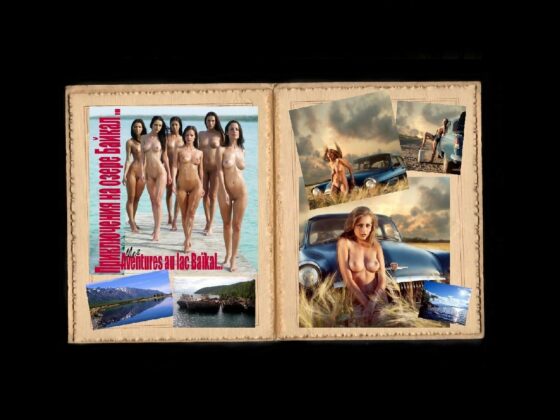Anamary et ses Secrets Interdits #02…
En ce temps-là, tout était grand. Je passais mes journées à réaliser de grandes affaires et mes nuits dans de grandes rêveries. J’avais de grandes mains, des grands-parents et de grandes espérances. Les adjectifs qui revenaient le plus souvent dans mes conversations étaient : grandiose, immense, gigantesque, énorme. Moi-même n’avais probablement pas terminé ma croissance. De grands hommes ordonnaient de grands travaux, d’autres opéraient de grands changements un peu plus à droite sur la carte de la Grande Europe. De grandes épidémies menaçaient mes grandes envolées lyriques. J’avais grande peur que cela ne tourne mal. À force, j’ai été tenté de devenir un gagne-petit. Je me souviens que je bêtisais beaucoup. Il y avait des après-midis pluvieuses et des nuits de soleil ou des femmes se dénudaient sans penser bronzer, me laissant clairement voir l’air entrer dans leurs poumons, gonfler leur poitrine et ressortir par les narines.
Il y avait la mode des chemises à fleurs, celle des carreaux, des lignes… et celle du nihilisme post-moderne. Il y avait partout des tulipes dans les vases des salons et une planche de bois avec du saucisson coupé en tranches épaisses sur toutes les tables. Bref, il n’y avait pas de quoi se plaindre. Je tombais amoureux les jours pairs et je voulais mourir les jours impairs ou pour passer le temps… Je trempais délicatement les asperges dans la sauce mousseline prévue à cet effet après avoir lu Gary et San Antonio. Je faisais la tournée des saints : Saint-Jean-de-Luz, Saint-Domingue, Saint-Wandrille, Saint-Tropez… et ceux des femmes… Il n’y avait rien de bien catholique là- dedans. Ce n’était pas vraiment ma faute : autour de moi, tout le monde ne pensait qu’à s’amuser et, depuis toujours, on m’avait enseigné que le travail devait primer tout le reste. Parfois il m’arrivait de trouver cette vie imbécile. Entre un bon livre et une poignée de confettis, je n’hésitais pas longtemps.
Un jour pourtant, j’ai bien été obligé de se mettre au travail. J’en suis venu à écrire plein de choses vraies et fausses dans différents journaux sur papier journal…, puis magazines sur papier glacé. Et comme on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, j’en suis venu à m’éditer et à méditer sur l’avenir du monde et le mien en particulier…, joignant l’utile à l’agréable ! Après l’âge ingrat vient l’âge gratin ; après le club Mickey, le mickey des clubs. Au sortir d’une adolescence solitaire et acnéique, car l’un va rarement sans l’autre, j’ai fait une entrée sans transition dans la société la plus superficielle qui soit : la mondaine. De rallyes sans autos en pots sans échappement, j’ai vite acquis les rudiments d’un savoir-vivre dont la première règle est la pantomime.
Pantomime de l’esprit, pantomime de la fête, pantomime de la drague. Quand on a tenu correctement son rôle dans ce type de farce, on est prêt à affronter avec le recul nécessaire n’importe quelle calamité. Quel ennui !
Graduellement le théâtre de mes sévices s’est élargi aux boums d’après-midi, soirées d’après-minuit, cocktails d’après-vernissage, galas d’après-désastre, bals d’après-mariage, fêtes d’après-inauguration, tournées d’après-examen et petits déjeuners d’après-coup.Je devenais un spécialiste qu’on consultait régulièrement pour savoir où il fallait être… et à quelle heure. L’argent honnête ne couvrant plus ce train, j’ai vendu mes connaissances suite aux conseils d’une amie très chère qui me disait qu’elle ne côtoyait que des personnes enrichissantes… Ainsi, pendant que les invité(e)s se saoulaient, je pouvais me justifier : ma présence parmi eux/elles me rapportait, je gagnais à être connu. Hypocrisie confortable : attention, une pantomime peut en cacher une autre.S’il est possible que la vie soit une fête, j’ai toujours eu du mal à croire que la fête puisse convenablement remplir une vie. Comme vous allez le lire, je ne me trompais qu’à moitié.
– Pauvre MERDE ! (Grosse gifle sur la joue gauche). – Tu vas me le payer ! (Coup de tête sur le nez). – ENCUUULÉÉÉ ! (Pied dans les couilles). – Crève ! (Tabouret en bois sur les dents). – Je vais te TUER ! (Cafetière d’eau bouillante dans les yeux). Anamary et moi nous disputions souvent. C’est pourtant ma meilleure amie, si tant est qu’il existe une pareille chose. Mais c’est aussi ma pire ennemie : ça va bien ensemble. Elle vit seule dans une gigantesque péniche mais n’hésite pas à investir un magnifique hôtel particulier qu’elle prétend lui être prêté par son vieil oncle écossais. Après plusieurs tentatives de suicide que je la soupçonne d’avoir involontairement ratées, Anamary a décidé de tromper autrement son ennui. C’est ainsi qu’elle est devenue la plus grande fêtarde de Paris, buveuse invétérée et droguée notoire. Mais elle a les défauts de ses qualités.
Il y a toujours un fond de vérité dans les pires lieux communs.
J’ai rencontré Anamary dans un grand foutoir wébien qui m’a amené dans une partie de cache-cache dans un grand hôtel Bruxellois (le Hilton), dans une queue leu leu sexuelle de soixante personnes ! C’était comme un Opéra-Comique. Plus tard, au cours d’une de ces soirées de gala où l’on s’empiffre à prix d’or au profit des déshérités (Il n’y a d’ailleurs rien de critiquable là-dedans : au contraire, cette charité-là a le mérite d’être moins hypocrite que d’autres, et nettement plus rigolote.), j’ai remarqué cette jeune dame qui invectivait les invités. Petit à petit, elle était parvenue à les entraîner dans une danse autour des tables, rythmée par un orchestre tzigane. Elle avait ainsi formé un long serpent de personnalités battant des mains parmi lesquelles je reconnus trois ministres en exercice, deux magnats de la presse internationale, un prince de sang royal, un autre de sang mêlé et un troisième sans importance… sans oublier sept top modèles de haut vol.
Je me suis bien évidemment élancé à sa suite. Tout le monde hurlait de rire, faisait de grands gestes, jetait éventails et chapeaux en l’air. Malheureusement, comme toutes les folies, cela ne dura qu’un temps et, peu à peu, la chenille se vida de ses troupes. Chacun alla se rasseoir et, au bout d’une minute, Anamary se retrouva seule. N’importe qui, moi par exemple, aurait immédiatement couru se cacher derrière un pilier, histoire de laisser le ridicule s’effacer.
Anamary n’en fit rien, elle grimpa sur une table et se mit à haranguer l’assemblée, buvant le vin au goulot, renversant les coupes de Champagne, embrassant le corsage d’une vieille duchesse, bondissant de table en table comme une démone de légende. Elle finit par atterrir à pieds joints dans mon assiette.
Ma chemise Ralf-Laureen fut aspergée de sauce au foie gras, ma voisine ne m’adressa plus jamais la parole. C’est à cette suite qu’elle me tortura sexuellement dans les caves…, mais c’est à peu près tout ce dont je me souviens.
Par la suite, je ne me suis jamais tout à fait habitué à ses frasques. En réalité, l’hôtel particulier qu’elle squattait n’avait rien de si particulier, si ce n’est son côté auberge espagnole : en permanence couchaient chez Anamary une dizaine de personnes, hommes et femmes il est préférable que vous ignoriez ce qu’ils (et ce que je) y faisaient. Cette maison méritait bien le nom d’hôtel particulier, quoique squat particulier n’eût pas mal sonné non plus. Quand j’entrais chez elle (en elle), elle m’accueillait toujours avec générosité : si j’avais soif elle me donnait un verre, si j’avais faim elle m’ouvrait son frigidaire, si j’avais d’autres envies elle faisait de son mieux. Certaines soirées chez elle demeureront parmi mes meilleurs (et mes pires) souvenirs…, mais petit à petit j’ai préféré voir Anamary dans d’autres lieux. Chez elle, elle n’était jamais tout à fait naturelle. Ou peut-être trop. La nuit, les gens ne suent pas : ils suintent. Ils ont les mains sales, les ongles noirs, les joues rouges, les bas filés, les cravates tordues.
Au bout d’une heure dans une boîte de nuit, la plus jolie fille du monde ressemble au barman. Comment ai-je pu sortir autant ? Certains soirs, en rentrant chez moi (ou ailleurs), je jouais à faire le compte de ce que j’avais absorbé dans la nuit. Sept whiskies, une bouteille de Brouilly, sept autres whiskies (par goût pour la symétrie), deux vodkas, une demi-bouteille de Popper’s et deux aspirines font une bonne moyenne. Heureusement que j’avais Gustav Mahler pour m’endormir. J’ai l’air de dénigrer cette époque mais il n’en est rien. C’étaient de beaux moments, la vie pesait moins lourd. On ne peut pas comprendre ça de l’extérieur. Aujourd’hui je sais que je ne ferai plus le tour du monde de la même façon, que je ne serai jamais numéro un au Top-50, que je ne serai jamais Président de la République, que je ne me suiciderai pas, que je ne serai jamais pris en otage, quoique, le Mossad a un mauvais oeil sur moi depuis que j’ai publié “Les Protocoles de Sion”, que je ne serai jamais héroïnomane (ni héros), que je ne serai jamais chef d’orchestre, que je ne serai jamais condamné à mort !
Quoiqu’il m’arrive d’avoir des envies de meurtre, aujourd’hui je sais que je mourrai de mort naturelle (d’une overdose d’amour). La pratique régulière de la fête m’a amené à établir une sorte de code déontologique et éthique en quatre règles d’or. Premièrement, toute fête réussie est improvisée ; deuxièmement, l’esprit de contraste est indispensable ; troisièmement, les filles sont les deux mamelles de la jouissance, quatrièmement, un fêtard n’a pas de règles… De même… La pratique régulière de la masturbation m’a amené à établir une sorte de code déontologique et éthique en quatre règles d’or. Premièrement, toute masturbation réussie est improvisée ; deuxièmement, l’esprit de contraste est indispensable ; troisièmement, les filles sont les deux mamelles de la jouissance, quatrièmement, un queutard n’a pas de règles… Un soir, Anamary et moi regardions la télévision. Il y avait une émission sur l’alcoolisme. Un écrivain raté mais célèbre racontait les ravages que l’alcool avait causés dans sa vie : sa femme l’avait quitté, son talent aussi.
– Combien de glaçons dans ton scotch ? Me demanda Anamary…. Je trouve que cette anecdote donne une idée de l’intelligence avec laquelle nous nous apprêtions à affronter notre destinée. À l’époque je n’arrivais pas à me droguer. J’abusais de toutes sortes de cocktails mais échouais à m’initier aux paradis artificiels. Cette infirmité ne provenait pas d’un manque de curiosité : j’avais essayé de fumer des joints, mais d’incontrôlables quintes de toux réduisaient mes efforts à néant ; quant aux poudres et pilules diverses dont mes amis se repaissaient, elles me donnaient l’impression de revenir aux cours de chimie.
Mon élitisme restait l’éthylisme. En ce temps-là les rails du crackoke n’atteignaient pas ma blanche narine… et les seules piqûres intraveineuses que je connus ne visaient pas à anéantir la réalité. Anamary réunissait des étudiants ivres, des experts en art barbus, des fils à papa orphelins, des femmes (dont une pas mal roulée), des jeunes avides d’expériences, des vieux en quête de sang neuf, des mannequins à la recherche de vitrines, des touristes croisés sur les Champs-Elysées, des couples amoureux, des couples désunis, des couples en gestation, des couples solitaires et des couples en couple.
Les occupations pouvaient varier…, mais le matin les trouvait fidèles au poste, exsangues dans un caniveau, ou un palace, ou une Rolls-Royce voire une Lamborghini, ou un commissariat de police. Avant qu’ils et elles redeviennent sérieux… et partent acheter des meubles anciens puis jouer au tennis chez des amis le dimanche après-midi. En attendant, ils et elles rêvaient de vies sur des yachts au soleil, où, allongés sur des transats, ils sirotaient des Daïquiris à la fraise en compagnie de jeunes actrices de cinéma. Ou alors dans les bas-fonds New-Yorkais, comme clochard-écrivain faisant fortune et sombrant dans la cocaïne des parties d’Alphabet City. Des vies d’insouciance, où ils et elles n’iraient pas au bureau, où ils et elles ne rentreraient pas chez eux pour se faire Druckériser devant la télévision. Des vies de parasites bourgeois, des vies de terroristes luxueux, des vies en villégiature, se voyant Boni de Castellane au Palais Rosé, John Fante à Point Dume, Corto Maltese dans les jardins d’orangers de la Mesquita de Cordoue, Patrick Modiano à l’Hôtel du Palais de Biarritz, Joe Dallessandro à la Factory, Alexis de Rédé à Ferrières, Chet Baker à Rome, Helmut Berger à Saint-Barthélémy, Antoine Blondin au Rubens, Charles Haas au Jockey Club, Alain Pacadis au Palace, Maurice Ronet au Luxembourg ou Joey Ramone au C.B.G.B.
Tout était permis, il suffisait de monter dans un taxi et de murmurer “à droite, à gauche” en souriant. On s’endormait sur la banquette et on se réveillait à Samarcande ou à l’Alhambra de Grenade. Des créatures approximativement persanes offraient des bouquets de fleurs sacrées et l’on chantait toute la nuit.
Ou bien c’était Berlin, une chambre sale, des verres poisseux renversés sur la moquette, des cendriers pleins, des livres de Castaneda et des seringues sous la langue… Ils et elles hésitaient entre un idéal d’extrême confort et le fantasme aristocratique de n’avoir rien pour avoir tout. Ils et elles n’étaient pas dans les temps. Ils et elles n’auraient pas été zazous dans les années 40, ni existentialistes dans les années 50, ni yéyés dans les années 60, ni hippies dans les années 70, ni Yuppies dans les années 80 : mais tout cela à la fois en l’an 2000. À chaque jour de la semaine correspondait une décennie. Lundi, contrebande, couvre-feu, caves de jazz. Mardi, cabriolets, cravates larges, cheveux courts. Mercredi, chansons dans le vent, chaussettes noires, Carnaby Street. Jeudi, chanvre indien, communauté, communisme. Vendredi, cafard moderne, col anglais, caisson d’isolation. Le week-end ils et elles tentaient l’impossible : être eux-mêmes pour achever ce siècle débordé, comme disait l’autre.
Malheureusement ils avaient beaucoup de mal à supporter la triste jeunesse d’aujourd’hui, son mal de vivre creux, sa voix plaintive, sa new wave sinistre, ses discours convenus, ses looks stéréotypés. Heureusement il restait quelques vieux cons et vieilles connes à admirer. Malheureusement les vieux cons et les vieilles connes pontifiaient. Heureusement ils et elles vieillissent plus vite que prévu, cela réglait le problème. La vie était une bossela schopenhauerienne.
On dansait quand tout allait bien, pour lutter contre la morosité du bonheur. On tombait par terre quand tout allait mal, pour dormir sur ses ruines.
Au temps de la house music, ce patchwork taillé dans les vieux hits de James Brown, Otis Redding, George Clinton, Sly Stone…, la bossela s’imposait comme un geste symbolique. Car le monde était devenu un disque de house, un maelström d’époques, de cultures, de langues, de gens et de genres, ponctué par les ooh yeah de Lyn Collins. Nous vivions l’ère du Sampling Universel, du Mégamix Collectif, du Zapping Permanent. Ce n’était pas si mal, si seulement on nous avait dit QUI était le disc-jockey ! La bossela, elle, ne reflétait pas la société mais proposait un mode de vie à deux temps : l’allégro et le lamento, alternés jusqu’à l’épuisement.
La house était un constat, la bossela un combat. La house était une danse actuelle imbriquant des éléments passés ; la bossela était une danse du passé, applicable à la vie actuelle. Une sinusoïde distrayante était toutefois préférable à un électro-béat plat. La première fois que j’ai vu Claire, elle était allongée par terre à coté de sa Jaguar TypeE, Elle n’avait que quelques égratignures mais le responsable de cet accident avait été projeté à 50 mètres dans un chenil ; ce qu’avaient particulièrement appréciés les Doberman qui mouraient de faim. Il y avait des hurlements dans tous les sens, des bouts de bras collés au mur, et Claire qui regardait le ciel et moi qui regardais Claire. Je me souviens que je l’ai crue morte et que j’ai regretté qu’il y ait autant de pompiers autour de nous : je crois bien que j’aurais abusé de la situation en d’autres circonstances (partir avec la Jaguar TypeE, par exemple). Nous ne nous sommes pas adressé la parole avant l’hôpital. – Vous croyez qu’ils vont nous garder longtemps ? – Je ne sais pas mais ça m’embête parce que ma voiture est garée en double file.
Ma rencontre avec Claire occupa mes pensées pendant de longues nuits qu’entrecoupaient des journées aussi courtes que les bonnes plaisanteries.
Cette fille m’obnubilait. Elle m’irradiait, m’irisait, m’irritait. Je m’en voulais d’avoir joué les gentlemen en ne lui demandant pas son numéro de téléphone.
La reverrais-je un jour ? Il me semblait qu’après avoir fait sa connaissance de manière aussi incongrue, j’aurais peu de chances de la retrouver. Je me trompais lourdement. En réalité, l’attentat fut le contexte le plus calme où je ne la vis jamais. Je ne tardai pas à entendre parler d’elle. Il faut dire que j’étais disert sur notre aventure. Je me figurais qu’en racontant partout cette histoire, je finirais par découvrir une piste. Je déformais l’épisode, rajoutant çà et là quelques actes d’héroïsme plus vrais que nature. Quand on sort un peu, on finit par radoter. Les mêmes gens produisent les mêmes conversations. Alors je préférais arranger la vie à ma sauce. Jusqu’au soir où un vieux type doublement mentoné me ricana au visage.
– Ah ! C’est vous qui racontez n’importe quoi sur ma fille ? Elle m’a chargé de vous dire que c’est elle qui vous a porté dans l’ambulance, et non l’inverse !
Le bonhomme croyait me vexer, il faisait mon bonheur. Je savais désormais où la joindre. Cela me coûta une bouteille de bourbon : le père de Claire cachait une sacrée descente derrière sa cravate à pois. Mais la fin justifie les moyens, non ? L’ennui c’est que je ne vivais pas seul. Victoire s’était installée chez moi après un an de bons et loyaux services et je m’étais habitué à sa présence. Nous formions ce qu’on appelle un jeune couple dynamique, c’est-à-dire que nos deux égoïsmes se complétaient et que notre paresse sentimentale nous rapprochait considérablement. Je mentirais en affirmant que je ne l’avais jamais aimée ; disons que mon inclination du début, au lieu de s’amplifier comme je l’avais espéré, s’était amenuisée au fil du temps, des dégoûts et des mille brimades que l’existence inflige aux âmes romantiques. Nous en étions réduits à tout simuler, au lit comme ailleurs. Notre amour était devenu une sorte d’hologramme baudrillardien. C’était branché mais pas très poétique : à tout prendre, j’aurais préféré Belle du Seigneur (Je suis plus Solal que solipsiste) …
Elle fumait des Marlboro light, buvait du Coca light et baisait light (paradoxalement, elle éteignait la lumière). Quoi qu’il en fût, Victoire sonnait ma défaite.
Quel gâchis : elle était belle, longue, née, bête, snob et multimillionnaire en livres sterling. Elle ne pensait qu’à dilapider l’argent de ses parents et l’énergie de sa jeunesse. Elle sortait tous les soirs et ne posait pas de questions quand je rentrais plus tard qu’elle. Son père possédait des appartements dans toutes les grandes capitales : Londres, New York, Banjul, Tokyo, Bormes-les-Mimosas. Sans compter les maisons de famille. À nous deux, nous pouvions postuler pour le Guinness Book des résidences secondaires. Pourquoi fallait-il que je m’embarrasse de principes ? C’était plus fort que moi, je sentais venir notre séparation. Je voulais être amoureux. Une lubie, un fantasme malsain m’interdisaient de prolonger cette liaison peu dangereuse. Quelque chose me disait que Victoire justifiait le caprice des adieux. J’aurais tout le temps d’épouser une riche héritière, pour l’heure, je préférais épouser les élans de mon cœur.
De Victoire je ne garderais que des souvenirs de bouffe. Nous avions passé l’année dans des restaurants.
Autrefois, pour séduire les femmes ou les garder, il fallait les emmener au théâtre, à l’Opéra ou en barque sur un lac. À présent, les théâtres étaient subventionnés, les opéras embastillés et les lacs avaient perdu l’essentiel de leurs charmes. Désormais il fallait subir le restaurant. On devait regarder l’objet de son désir mastiquer des rognons de veau, la créature de ses rêves hésiter entre un morceau de camembert ou un quartier de brie bien coulant, la divine beauté victime de gargouillis intestinaux et même de pets saccadés… La déglutition remplaçait les baisers, les bruits de fourchette supplantaient les déclarations. Que restait-il à l’heure des amours mortes ? Des souvenirs gastriques. Gloria me rappelait la tarte aux fraises à la crème Chantilly, Léopoldine avait failli s’étrangler avec un pépin de melon, Margarita était soûle au troisième verre de tavel. Adieu les cavatines ! De Victoire ne demeureraient en somme que des mémoires indigestes. Au début, je croyais que l’amour montait ! Après plusieurs déconvenues, j’ai compris qu’il descendait.
Il existe peut-être une troisième voie, un coup de foudre à peu près réciproque peut se transformer en passion durable à condition de l’entretenir à coups de voyages, de beuveries et de scènes de ménage gratuites. Comme quoi la rigueur mathématique ne messied pas à l’analyse des sentiments. J’ai fini par retrouver claire. J’ai fait semblant de tomber sur elle par hasard ; en réalité je poireautais devant son immeuble depuis plus d’une heure quand elle est apparue. J’ai admiré ses fines chevilles et ses sourcils parfaits, je lui ai dit que je sortais de chez le dentiste et elle a joué avec la fermeture Éclair de son Perfecto. J’ai rougi (je ne sais pas mentir) et elle aussi, sans doute par contagion. Tout le monde rougissait, les feux passaient au rouge, les voitures qui freinaient allumaient leurs feux arrière et il m’a même semblé que le soleil s’empourprait lui aussi. D’un commun accord, nous avons décidé que son père m’inviterait à dîner le lendemain soir. Il savait très bien faire le pot-au-feu et avait très bien connu mon grand-père.
Ainsi, ce cher homme avait parlé de moi à Claire ! Il faut toujours s’acoquiner avec les parents (sauf en cas de conflit de générations ; il faut alors choisir son camp ; en l’occurrence cette question ne se posait pas : il était clair que Claire admirait son vieux papa à la retraite, ex-professeur, savant alcoolique et philosophe bougon, qui lui laissait faire ce qu’elle voulait depuis que sa femme était partie avec un psychanalyste italien, emprisonné depuis). Cette entrevue n’a pas duré cinq minutes mais elle s’est inscrite dans ma mémoire. En rentrant chez moi, j’ai fermé les yeux pour revoir la scène, les genoux de Claire, son rouge à lèvres, sa main qui jouait avec la fermeture Éclair. Toutes les fermetures sont des éclairs. J’ai rouvert les yeux devant la glace et je leur ai dit : Rendez-vous, vous êtes cernés ! …, car il n’y avait aucune raison de se priver d’un jeu de mots hilarant. Puis j’ai décroché le téléphone pour appeler Anamary afin de tout lui raconter, mais Victoire est entrée dans la chambre et j’ai dû écourter la communication.
Elle portait un Jean’s, un pull à col roulé noir et l’indifférence sur son visage. Notre rupture était imminente ; restait à savoir lequel de nous deux en prendrait l’initiative. Ma lâcheté m’en empêchait, mon amour-propre m’y poussait. Je ne prenais pas de décision : la galanterie n’exige-t-elle pas que les femmes passent d’abord ? – Je vais au cinéma avec Bernadette. Tu veux venir ? me demanda-t-elle. – Merci, j’ai un article à taper. Bernadette, sa copine, s’habillait comme une bonne sœur et, en l’occurrence, l’habit faisait la nonne. Je savais très bien le genre de film qu’elles iraient voir toutes les deux : long et égyptien.
Après, elles iraient manger des sushis en parlant de Samuel Beckett. – Je vais essayer de me coucher tôt, embrasse-la de ma part, lançai-je à Victoire qui descendait déjà l’escalier, pressée d’oublier mon existence. Anamary avait la voix enrouée. Impossible d’en placer une. Elle me raconta sa nuit de la veille : ayant retrouvé quelques amies et amies dans un club échangiste, ils et elles avaient effectué une petite tournée de routine, rencontré une fille enceinte d’on ne savait quoi, et ils et elles l’avaient raccompagnée à son hôtel pour la baiser en tous sens.
Anamary n’avait pas réussi à jouir, elle avait pris une douche, était sortie de sa chambre totalement nue, semant des flaques d’eau savonneuse dans les couloirs, s’était fait engueuler par le concierge et par le chauffeur de taxi. Maintenant elle avait un peu mal à la tête. Pourquoi je l’appelais ? J’allais parler de Claire quand elle m’interrompit : elle devait aller acheter du Champagne pour ses amies. Préparatifs pour le dîner chez Claire. Hésitation devant les cravates.
Pas droit à l’erreur. Cravate marine à pois blancs, chemise blanche, blazer croisé, pas de fioritures. Ni de pochette : trop risqué. Pantalon de flanelle gris foncé. Tristounet mais simple. Classique mais classieux. Chaussures à double boucle. Maintenant l’horreur : les points noirs sur le nez, les poils de barbe qui résistent à douze passages du rasoir, la coupure au treizième…, l’eau de toilette qui brûle les joues, le gel qui colle les cheveux et poisse les mains. Dernière minute : le poil qui dépasse du nez, les sourcils qui se rejoignent et la pince à épiler égarée. Une tache de sang sur le col de la chemise. Tout à recommencer.
Une heure de retard et je dois encore trouver une bouteille de vin. J’ai finalement choisi une chemise à carreaux rouges avec la même cravate. J’ai pris du Mouton-Rothschild 1986 (ce sont des amis). J’ai réussi à me garer pas trop loin. Je me suis recoiffé dans l’ascenseur, j’avais le trac. J’ai attendu de dérougir avant de sonner et puis en avant toute. Ce fut une catastrophe. Claire n’a pas dit un mot de la soirée. Dès mon arrivée, je me suis senti ridiculement overdressed. Son père avait invité des amis : bluejeans à pattes d’eph et cheveux gras. Je lisais dans leurs yeux la sordide étiquette qu’ils m’apposaient : déjanté, ou bien étais-je simplement parano ? Le fait est que je gênais tout le monde, Claire y compris. Elle fuyait mes œillades et ne manquait pas un prétexte pour se lever de table. J’ai même fini par la trouver moins mignonne que les autres fois. Et la conversation se focalisait sur moi : ce que je faisais, ce que je pensais des événements, quelles étaient les nouvelles tendances…
Après le dîner, j’ai brillé par mes connaissances de l’inutilité de tout, évoquant mes tentations sodomites, mes envies de fouetter Claire dans un donjon !
Tout le monde bâillait, même le décolleté de Claire ; j’ai aperçu un de ses seins ; je n’étais pas venu pour rien. Cette nuit-là, j’ai fait l’amour à Victoire pour la dernière fois. C’était un oral de rattrapage. Quitte à être mesquin, autant y aller carrément. Il n’y a pas que les cercles qui soient vicieux. L’instant fatidique a fini par arriver : Victoire m’avait déposé un mot dans l’entrée : “Dînons en tête à tête ce soir chez Faugeron. Il faut que je te parle”. C’était bon signe : Henri Faugeron servait un excellent magret. J’irais : mieux vaut bouffer du canard que poser un lapin. Claire m’appela l’après-midi même pour me demander si je ne m’étais pas trop ennuyé chez son père. Preuve de perspicacité. En tout cas, elle était plus psychologue que moi, qui pensais être grillé. Un bonheur n’arrive jamais seul. D’ailleurs elle terminera sa vie comme Psychologue-voyante en banlieue Bruxelloise, donnant des conseils à deux balles pour quelques euros…
Triste fin, mais je suis ici pour vous conter la faim que j’éprouve à la vue de ses seins, pas la fin de son épopée freudienne…
Tout était fini entre Victoire et moi : je l’ai su dès son arrivée chez Faugeron. Comme à son habitude, elle était en retard de douze minutes exactement.
Cela m’a laissé le temps de goûter leur whisky Sour. Il se défendait : nettement plus whisky que Sour. À quoi reconnaît-on un bon restaurant ? Les verres à vin y sont plus grands que les verres à eau. On peut classer les filles selon leur parfum. Il y a celles qui vous en rappellent une autre. Il y a celles qui empestent : leur odeur les précède comme un aboyeur. Il y a aussi des parfums qui évoquent la place d’un village provençal et des assiettes de tomates-mozzarella où l’on ne mange que la mozzarella. Est-il besoin de préciser que Victoire ne faisait plus partie de la troisième catégorie ? Plus le dîner avançait, plus ma certitude se confirmait : notre amour s’était auto-dissous comme une pastille d’Alka-SeItzer dans un verre d’eau du robinet. Avec le même effet salvateur.
– Ce que je vais te dire n’est pas très agréable…, attaqua Victoire. – Où est le sel et le poivre ? – Je crois que cette vie ne nous mène pas à grand-chose… – Scrunch, groumph, sploutch (le magret de canard était accompagné d’un gratin de courgettes). – Respecte ce que nous avons connu ensemble… – Garçon, s’il vous plaît, la même bouteille de vin ! – Je ne sais jamais ce que tu as dans le crâne… – Gloub, gloub, gloub (haut-brion 1975, le vin perdu de Matznefï).
Rien ne sert de courir, il faut partir à pied. Je me suis levé de table très lentement, je me suis passé la main dans les cheveux, j’ai fini mon verre, j’ai vidé le reste de la bouteille sur la tête du chien de la dame d’à côté, j’ai dit à Victoire que j’allais téléphoner, que je revenais tout de suite et je n’ai pas regretté ce mensonge qui m’a évité de payer l’addition. Les deux phrases les pires au monde sont : II faut que je te parle et J’aimerais qu’on reste amis… Le plus drôle est qu’elles arrivent toujours au résultat opposé et cassent aussi bien la conversation que l’amitié. Je ne voudrais pas jouer les durs à cuire, mais enfin je trouve que je prenais assez bien mon récent célibat, l’ayant largement prévu et en partie provoqué. Sachez qu’il m’en coûte beaucoup d’écrire cela. C’est alors que mon destin pila devant moi en crissant des pneus. Claire avait dû m’entendre ou bien avait-elle déjà lu mes texticules ? Elle m’offrit en tout cas l’hospitalité.
Elle aurait pu passer pour une femme pressée, avec son tailleur charnel et son walkwoman, mais les femmes pressées n’écoutent pas Jean-Sébastien Bach en brûlant tous les feux (même les verts).
J’ai vite regretté de ne pas avoir décliné son offre. Elle conduisait comme une malade mentale. – Pourquoi est-ce que tu accélères dès que le feu passe au rouge ?
– Mais non il était orange ! Il s’agissait donc d’un cas de daltonisme, tout à fait banal et nonobstant mortel. – Je suis désolée pour le dîner de l’autre soir… – Mais c’était génial, je t’assure, je me suis marré, FREINE, Y A UN PIÉTON, LÀÀ ! – Calme-toi, enfin… J’étais très calme : je gardai les yeux fermés durant tout le trajet. Elle allait chez Castel, j’étais d’accord et puis je n’avais pas le choix. Aimer c’est agir, a dit Victor Hugo. Je jugeai bon de suivre le précepte du vieux play-boy. Dans cette boîte, j’aurais tout loisir de la saouler, pas seulement de mots. J’admirais ses dents et m’employais à la faire sourire pour les contempler le plus souvent possible. Le temps passait vite avec elle. Les minutes duraient quelques secondes. À l’intérieur, je fis l’imbécile. Le club était plein de célébrités, de poivrots, de mythomanes, d’écrivains, de putes et de violeurs. La clientèle habituelle. Je forçais Claire à danser, la quittais pour saluer des copains, embrassais des jolies filles devant elle. Je pensais l’épater mais je ne faisais que la décevoir. Je le sentais, mais continuais mon petit jeu car je n’avais pas d’autre idée et mon cerveau s’embrouillait.
Je ne peux m’en prendre qu’à moi si ce qui devait arriver arriva. Claire a fini la nuit au cou d’un petit nain. Je les ai vus s’embrasser sur la bouche, avec moult échanges linguaux et salivaires. Adieu veaux, vaches, cochonneries. Ce soir-là, j’inaugurai un nouveau cocktail : le Case Départ. Un tiers de vodka, deux tiers de larmes. J’ai dormi la fenêtre ouverte. Je ronflais, la chatte aussi, le frigidaire aussi. J’étais gelé, la chatte aussi, le frigidaire aussi. En fait je ne dormais pas vraiment, la chatte non plus, le frigidaire non plus. Je me suis levé pour fermer la fenêtre ; l’animal domestique et le matériel électro-ménager ont cessé de me préoccuper. Deux amours foirent en deux jours, ça commençait à bien faire. Il était temps de prendre le large. Justement, Anamary partait en voyage.
Elle avait dégoté un bal à Vienne. Un bal en Autriche, c’était exactement la cure qu’il me fallait. Rien de tel qu’une ivresse parmi les fantômes pour remettre les pendules à l’heure. Moi-même, j’étais presque un revenant, alors…
Liste des sujets de conversation abordés pendant le voyage : le prix exorbitant des boissons dans les trains, le dernier Roman à la mode, la haine de la publicité et de ceux qui la font, qui sort avec qui, le dernier Fellini, Victoire (ah bon ? C’est fini entre vous ?), les imbéciles qui ne mangent pas la peau du saucisson, qui a largué qui, l’œuvre de ma vie, la haine des mecs qui portent des chaussettes de tennis quand ils n’y jouent pas, nos copains morts, nos copains mariés, nos copains papas, Claire (c’est qui ? On l’a déjà vue ?), la haine de Magritte, Buffet, Vasarely et César, le suicide, le meurtre, les prochaines fêtes, Casanova, Don Juan, Roger Vadim, les filles qui ne se maquillent jamais, celles qui se maquillent trop, les ceintures de smoking, les sandwiches grecs de la rue Saint-Denis… La vie est un carnaval / Et le monde est un immense bal / Où nous tournons inlassablement / Portant tous un déguisement » (Georges Guétary dans Monsieur Carnaval de Frédéric Dard), la Traviata, le rap, l’herbe, le gin tonic, le gin rummy, les jeans troués, les gros seins, l’Amérique du Sud, la baie de Rio, Stan Getz, les voitures décapotables, l’alcootest, le bal à Vienne, thème Valmont is back, tenue XVIIIe siècle de rigueur, cinq cents invités, au château de Rosenburg, à vingt minutes au sud de la ville, et ce sont des Français qui reçoivent !Ivres-morts, nous sommes descendu du train un quart d’heure après son entrée en gare de Vienne.
Nous avons erré dans la ville à la recherche d’un hôtel, effrayant les autochtones. Nous étions devenus des hooligans cravatés. Nous sommes montés dans un autobus in petto, sine die et manu militari. Anamary s’est endormie sur mes genoux…, a priori, ipso facto et ex abrupto. Je condense la suite des événements : taxi, hôtel, bain, aspirine, déguisement, taxi, arrivée au bal. En piteux état, mais parés. J’ai tout aimé à Vienne. Surtout les mollets de Claire, demeurés à Paris. Néanmoins ce bal costumé s’est avéré un remède efficace à ma mélancolie. Il faut dire qu’il avait commencé sous de bons auspices puisqu’on nous y a laissé entrer sans poser de questions : gage d’un exceptionnel savoir-vivre ou amortissement de nos locations de costumes ? Le carton d’invitation exigeait la tenue libertine du siècle des Lumières ; nous lui avions obéi au doigt (et ce n’était pas à l’œil). Je me sentais d’attaque, quoique embarrassé dans mes jabots et perruques poudrées. Il faut souffrir pour être libertin.
Une belle fête se reconnaît dès l’entrée. Combien de fois ai-je voulu tourner les talons deux secondes après une arrivée dans un salon sinistre, fleurant le fiasco à plein nez ? Jamais mes intuitions ne m’ont trahi ; ruminant ensuite ce bon réflexe hypocritement réprimé, subissant les private jokes et le name dropping pushy de ce social flop. Les Anglais ont d’excellents idiomes pour ces idioties. Le bal viennois, lui, m’a estomaqué au premier coup d’œil.
La façade du château était éclairée aux chandelles et le parc scintillait de mille petites taches lumineuses. À notre arrivée un quatuor à cordes rythmait nos pas d’un gentil allegro mozartien. Tous les invités étaient somptueusement déguisés. Louis XVI était là. Marie-Antoinette aussi… et, comme à l’époque, ils n’étaient pas ensemble. Sauf quelques anachronismes déplorables (Richelieu se gavait de petits fours dans un coin, Napoléon Bonaparte n’osait même plus se montrer), on se croyait vraiment revenu deux siècles en arrière. N’ayant malheureusement pas connu cette époque, cela m’évoquait plutôt quelques films de Milos Forman.
Les gens jouaient le jeu et se mettaient même à parler en vieux français, employant des expressions comme “Messire, ce festoiement m’agrée fort” ou “Ma mie, vous m’échauffez les sens, je m’en vais vous foutre derechef”, qui donnaient à ce tableau une vérité criante, si l’on peut dire. Partout ce n’étaient que libations, stupres, concours de boissons sous les tonneaux de vin rouge, batailles de nourriture (les cailles, bien que rôties à l’estragon, continuaient de voler) et course après les marquises (nues) autour des tables et dans les buissons. A l’intérieur du château, le bal envahissait tout le rez-de-chaussée. Un historien méticuleux se serait sans doute offusqué : l’on dansait moins le menuet que l’acid-house. Cela dit, si Valmont était revenu (mais nous a-t-il vraiment quittés), il n’aurait pas eu tellement de mal à s’adapter aux danses modernes qui ne sont, grosso modo, que des variantes de la bourrée médiévale. Quelques couples s’aventuraient à visiter les étages, par curiosité architecturale ou pressés par l’urgence. Des gens dormaient, d’autres partaient, se suicidaient, faisaient l’amour, ou engageaient la conversation en se masturbant.
J’eus du mal à me débarrasser d’une marquise de Merteuil encore plus excitée que l’originale. Elle ne cessait de me demander si je voulais voir combien elle portait de jupons. Je fis semblant de ne pas comprendre l’anglais et déguerpis quand elle engagea un effeuillage complexe. Dans le jardin, la bataille en était aux desserts. J’évitai de justesse un vacherin à la framboise et en fus quitte pour quelques taches de coulis de fraises sur mon pourpoint doré.
Il faut vivre dangereusement. Un prince avait piqué des bouteilles de champagne sous le buffet et arrosait deux Tourvel qui se demandaient laquelle copiait l’autre. J’en ai trouvé un autre en grande discussion avec le futur roi de Belgique sur l’authenticité d’un soutien-gorge trouvé sur la piste de danse.
Puis je suis tombé sur Marie, une jeune Allemande, cousine des Habsbourg, à côté de qui j’avais dîné aux Bains l’année précédente. Elle me demanda si j’avais de la coke. Elle ne devait pas avoir plus de vingt-cinq ans, mais dans ces pays-là c’est un âge relativement expérimenté. Je n’en avais pas ; elle daigna tout de même accepter une coupe de Champagne tandis que je buvais un plein verre de vodka, cul sec. Ma réputation était sauve.
Je l’ai suivie dans les jardins à la française et, quand nous sommes revenus, ma patrie était vengée. Cependant presque tout le monde était parti. Par chance, Marie logeait dans une suite au palais Schwartzenberg. Je ne me fis pas prier pour accepter son invitation. Comme tous les enfants gâtés, je fais semblant de cracher dans la soupe mais j’ai des habitudes de nouveau riche. Nous devions seulement marcher sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller ses parents.
Le retour se fit sans encombre sous les décombres. Nous traversions la nuit, ombres dans la pénombre. Malgré les apparences, cette équipée ne rimait pas à grand-chose. Tout marcha toutefois comme sur des roulettes… et lorsque le petit déjeuner arriva (également sur roulettes), Marie avait un nouveau room mate. J’ai été choqué en constatant la joie de ses parents, à croire que je venais de me taper un cageot esseulé. Ce n’était pas le cas : Marie ne proposait pas un visage avenant mais disposait d’une paire de loches de 92 centimètres bonnet C, c’était une femme avec beaucoup de qualités. Nous nous sommes promenés dans Vienne mais le cœur n’y était plus.
Les lendemains de fête ne chantent pas. Tous les cafés étaient fermés. Quelle étrange manie ont ces peuples de ne pas travailler le dimanche ! À Paris, tous les magasins sont ouverts. Vienne était une ville morte. À moins qu’un couvre-feu ait été décrété en notre honneur ? Ses habitants semblaient claquemurés derrière leurs volets vanille-fraise. Le retour à la gare fût pénible. En comparaison, la retraite de Russie avait dû être une promenade de santé. Anamary se noyait sous les références littéraires. Elle mélangeait Zweig, Freud, Musil, Hitler et Schnitzler dans un maelström de cuistreries incultes. Elle négligeait mes Autrichiens préférés : Hofmannsthal et Nicki Lauda. Sur un point cependant, elle ne se trompait pas : comme nous, ces grands hommes n’avaient pas été tellement dans leur assiette ici. Elle se lança un jeu de mots sur le Pont Mirabeau d’Apollinaire (VIENNE la nuit, sonne l’heure, etc.) et je fus pris soudain d’une crise de vomissements incontrôlables. C’était vraiment pire que la campagne russe. Au moins là-bas, la garde mourait mais ne rendait pas…
Le soir, nous avons pris des trains qui rentraient… Autrefois, on appelait ça cristalliser. En ce qui me concerne, je dirais plutôt que j’avais flashé sur Claire, car il faut vivre avec son temps. Elle était mon idée fixe. Incapable de cacher mes sentiments, j’en avais fait part à Anamary qui m’avait écouté poliment. Elle m’avait même donné quelques conseils : ne jamais lui dire je t’aime, ne jamais lui envoyer les lettres d’amour que j’écrivais jour et nuit, me raser de près, arrêter de boire, avoir les cheveux propres, ne jamais lui téléphoner mais être présent, comme par hasard, partout où elle sortirait, toujours aimable, drôle, galant et bien habillé… et attendre, attendre encore, et attendre cette attente. Ce serait Claire qui déciderait. C’était une pure perte de temps, mais il n’y avait pas d’autre solution ! Mes journées commençaient de façon positive… Je me levais, me brossais les dents, buvais une tasse de café, tuais quelqu’un.
Il suffisait de regarder par la fenêtre : la ruelle était pleine d’inutiles souffreteux qui attendaient mon coup de grâce. Je mimais un fusil avec mes deux mains, visais calmement. Mon doigt ne tremblait pas quand j’appuyais sur la détente. J’étais un horrible serial-killer, un terrifiant mass-murderer, un traumatisant sexual-maniac ! J’avais toutes les polices à mes trousses, des laboratoires analysaient scientifiquement mes cheveux.
En éclatant d’un rire sardonique, tout d’un coup il m’est devenu indifférent de ne pas me masturber. J’avais enfin l’impression de concorder avec mon temps.
Il y avait des révolutions partout, pourquoi pas en moi ? On nous parlait de la Fin de l’Histoire. Or la mienne redémarrait. La Fin des Idéologies avait engendré une idéologie de la Fin. C’était le culte de la chute. Tout était bien qui finissait mal. Foutaises ! Méfiez-vous des idéaux soft car ils donnent des envies hard.
On a voulu faire de nous des lopettes fatiguées et voici qu’une génération déboule, violente, sexuelle, révolutionnaire et amoureuse. Qui a dit que l’histoire ne repassait jamais les plats ? En attendant, j’occupais soigneusement le terrain : Claire ne pouvait pas aventurer le nez dehors sans retrouver les miens en face. Visitait-elle une exposition ? J’étais en train de plaisanter avec le peintre. S’asseyait-elle pour découvrir une collection de mode ? Je l’invitais à boire une coupe de Champagne dans les cabines. Descendait-elle au Festival de Cannes ? J’étais dans le même avion. J’essayais d’être le moins collant possible mais j’étais tout de même souvent dans ses pattes. C’est ainsi, ma vie est une suite d’éjaculations précoces, je n’ai jamais su me retenir de vivre. Croyez-le ou non, dès qu’elle m’a vu, dans l’avion, elle s’est approchée lentement et m’a pris la main.
Une fois arrivé à Nice, elle m’a entrainé en taxi à Cap d’Ail ou elle avait loué un appartement somptueux chez Pierre&Vacances et m’a entraîné dans la chambre. Là, elle m’a serré la main un peu plus fort et m’a embrassé sur les lèvres, doucement, comme au cinéma. Trois fois. Ensuite, ce fut magique, trois nuits et trois jours ! Puis elle est repartie. Je me suis souvenu de Jean-Pierre Léaud demandant si les femmes étaient magiques, au lieu de réfléchir, j’aurais mieux fait de suivre Claire, mais était-ce possible ? Quoi qu’il en fût, j’eus beau retourner l’appartement dans tous les sens, elle avait bel et bien disparu.
J’étais incapable de dire si j’avais rêvé ou non : “Oh Seigneur, faites que ce ne soit pas un rêve !”… C’est fou ce qu’on devient croyant dans ces moments-là.
Et le quatrième jour s’est levé. Je n’avais pas rêvé. Claire m’a rappelé, elle n’avait pas agi gratuitement, dans le feu de l’action, mais d’une manière calculée.
Elle m’a certifié qu’elle n’était pas ivre, qu’elle était en parfaite possession de ses moyens sexuels. Ça me suffisait. Je n’ai jamais été particulièrement boulimique dans ce domaine. Disons que j’ai fait de nécessiter vertu, ce qui ne m’empêche pas d’être d’un romantisme très inflammable.
A partir de ce coup de téléphone réparateur, j’ai pu vérifier la validité de la courbe tracée plus haut. Quant aux autres courbes, je me dévouai pour en faire l’inventaire. Notre passion fut en effet chérivante, gélinienne et trognonne. (Les mots sont tellement malhabiles à décrire ce que nous avons vécu que je me suis permis d’en inventer d’inédits.) Chez elle, j’aimais : – ses mollets (déjà dit) ; – ses compliments (mais ils me faisaient rougir) ; – sa façon de se passer la main dans les cheveux (doigts écartés) ; – ses seins (phénoménaux) ; – sa colonne vertébrale (surtout quand elle se penchait) ; – son rire (à mes blagues) ;
– ses salières (ou clavicules) : – sa peau ; – et l’envie qu’elle me donnait de faire ce genre de listes…. Je me suis acheté un fusil à canon scié. Je ne sais pas ce qui m’a pris. J’étais incapable de me servir de cet engin et je ne voyais pas pourquoi j’en aurais eu besoin : j’étais d’un naturel plutôt calme et mes ennemis se comptaient sur les doigts d’une main. En plus ce truc m’avait coûté une fortune… Il arrache la tête d’un être humain à cinquante mètres. Nous restions dans notre lit, nous nourrissant exclusivement de foie gras et de Coca-Cola (l’anorexie est un hédonisme), regardant les vidéoclips à la télévision jusqu’à la fin des émissions. Il nous arrivait aussi de manger des pistaches mais cela me donnait des aphtes. Quoi d’autre ?