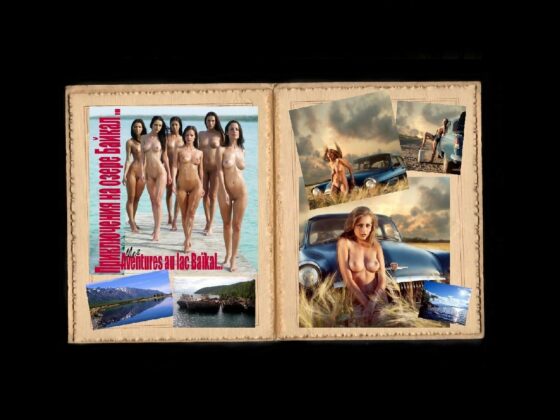Confessions sexuelles d’un patriote Russe d’Ukraine…
Monsieur Gatsby…
L’évolution des folies Russo-Ukrainiennes attisées par les Américanskys ces derniers mois, m’incite à vous confier le Grand-Mémoire de ma vie en son aspect sexuel, car je suis un ardent lecteur de votre web-site www.SecretsInterdits.com depuis la fin des années’90. Mes “Confessions sexuelles d’un patriote Russe du Sud d’Ukraine”, sont celles de moi-même, de bonne famille, instruit, capable d’analyses psychologiques sur les réalités du monde et des populations, ce qui m’a permis de les rédiger en français. Il faut tenir compte que je demeure en Ukraine qui était Russe avant l’abomination de son abandon, avant que le très Saint et Vénéré Vladimir Poutine devienne Président de la Fédération de Russie. Cela permettra à vos lecteurs et lectrices de comprendre certaines allusions politiques et sociales de mon texte. Sachant, par les récits exceptionnels publiés dans SecretsInterdits dont ceux de cette chère Anamary del Miguel Saavedra, qui, m’a-t-on dit sans que je sache si c’est vrai ou faux, qu’elle était horriblement décédée dans une des tours le 11 septembre ! Si c’est le cas, vous avez courageusement, en sa mémoire, publié ses écrits et nul doute en mon esprit que vous trouverez dans mon récit autobiographique qu’il sera profitable à la science par la connaissance des traits biographiques concernant le développement de l’instinct chez différents individus, soit normaux, soit anormaux. J’ai eu ainsi l’idée de vous faire parvenir le récit consciencieux de ma propre vie sexuelle. Mon récit ne sera peut-être pas très intéressant au point de vue scientifique (je n’ai pas la compétence nécessaire pour en juger), mais il aura le mérite d’une exactitude et véracité absolues ! De plus, il est très complet. Je crois que, par pudeur, la plupart des gens instruits cachent à tout le monde la partie sexuelle de leur biographie ; je ne suivrai pas leur exemple et il me semble que mon expérience, malheureusement très précoce, dans ce domaine, confirme et complète beaucoup de remarques que j’ai trouvées disséminées dans divers articles dont ceux de cette chère et extraordinaire Anamary del Miguel Saavedra. Vous pouvez donc faire un usage illimité de mes notes, c’est-à-dire l’usage que vous voudrez en faire, naturellement, et, c’est impératif, sans me nommer.
Je suis de race Russe (issu du croisement de Grands-Russiens et de Petits-Russiens). Je ne connais aucun cas de morbidité caractéristique chez mes ascendants et parents. Mes grands-parents, du côté paternel et maternel, étaient des gens très bien portants, très équilibrés psychiquement, et ils eurent une longue vie. Mes oncles et tantes également étaient fortement constitués et vécurent longtemps. Mon père et ma mère étaient enfants de propriétaires ruraux assez riches : ils ont été élevés à la campagne. Tous les deux ont mené une vie intellectuelle absorbante. Mon père était directeur d’une banque et président d’un conseil provincial électif (zemstvo) où il menait une lutte ardente pour les idées avancées. Comme ma mère, il avait des opinions très radicales et écrivait des articles d’économie politique ou de sociologie dans les journaux et revues. Ma mère faisait des livres de vulgarisation scientifique pour le peuple et pour les enfants. Très occupés par leurs luttes sociales (qui existaient alors en Russie sous une forme différente de celle qu’elles ont aujourd’hui), par les livres et les discussions, je crois que mes parents négligeaient un peu l’éducation et la surveillance des enfants. Des huit enfants qu’ils ont eus, cinq sont morts en bas âge ; deux autres, à l’âge de sept et huit ans ; seul de tous les enfants, je suis arrivé à l’âge adulte. Mes parents se sont toujours bien portés, leur mort eut des causes fortuites. Ma mère était très impétueuse, presque violente de caractère ; mon père était nerveux, mais savait se contenir. Leur tempérament, probablement, n’était pas érotique, car, comme je l’ai su arrivé à l’âge d’homme, leur mariage était une union modèle ; dans leur vie pas l’ombre d’une histoire amoureuse (excepté celle qui finit par leur mariage), fidélité absolue des deux côtés, fidélité qui étonnait beaucoup la société qui les entourait, où cette vertu ne se rencontre guère (la morale des intellectuels russes étant très libre dans le domaine sexuel, et même relâchée). Jamais je ne les ai entendus causer de sujets scabreux. Même esprit dans les familles de mes autres parents oncles et tantes. Austérité des mœurs et des conversations, intérêts intellectuels et politiques. En contradiction avec les idées avancées qu’avaient tous mes parents, il y avait chez quelques-uns d’entre eux un peu de vanité nobiliaire, innocente et sans morgue il est vrai : car ils étaient nobles dans le sens qu’a ce mot en Russie (c’est une noblesse beaucoup moins aristocratique que celle de l’Europe occidentale).
J’ai passé mon enfance dans plusieurs grandes villes de la Russie méridionale lorsqu’elle était encore “La Grande Russie” (surtout à Kiev) ; l’été nous allions à la campagne ou au bord de la mer. Je me souviens qu’à cette époque vivait chez nous une fillette qui avait à peu près mon âge. C’était, comme je l’ai su plus tard, la fille d’une prostituée Ukrainienne de bas étage qui, en mourant, laissa orpheline cette enfant de deux mois. Ma mère recueillit l’enfant (la mort ayant eu lieu dans une grande maison dont nous louions un étage), la fit allaiter et eut l’idée de l’élever avec ses propres enfants. Mais, chose intéressante pour ceux qui croient à l’hérédité des sentiments moraux, cette enfant, quoique recevant absolument la même éducation que nous, manifesta dès les premières années de sa vie de fortes inclinations immorales. Nous ne savions pas du tout qu’elle n’était pas notre sœur, elle non plus n’en savait rien et pour elle notre mère était sa maman comme pour nous ; étant des enfants très aimants, très tendres, nous l’aimions comme nous nous aimions entre nous, tandis que cette petite démone ne pensait qu’à nous faire du mal. Quand elle devint plus grande, nous nous rendîmes compte de son caractère typiquement de style Ukrainien. Nous avons fini par voir, par exemple, que, chaque fois que l’occasion s’en présentait, elle faisait une action contraire à notre éthique d’enfants Russes, mais avec une infaillibilité de loi physique. Par exemple, jamais elle ne racontait ce qui s’était passé en l’absence des grandes personnes sans calomnier ses compagnons de jeux. Elle avait la passion d’inciter les autres à un méfait pour aller tout de suite en dénoncer l’auteur. Elle était habile à semer la division entre les grandes personnes (domestiques, etc.) par des inventions calomnieuses. Alors que nous adorions les animaux, elle les tourmentait jusqu’à la mort quand elle le pouvait et puis nous en accusait sans vergogne. Elle aimait à faire des cadeaux, mais sans que jamais cette règle ait souffert la moindre exception, c’était pour les reprendre immédiatement après et jouir des pleurs de la victime. Comme elle était plus forte physiquement et plus intelligente dans le mal que nous, nous étions ses souffre-douleur. Elle nous battait et nous n’osions pas nous plaindre, elle nous calomniait et nous ne savions pas nous disculper. Elle nous volait sans cesse nos joujoux ou les détruisait ; très gourmande elle nous enlevait (quand les enfants n’étaient pas surveillés de près) notre part des friandises. Chose curieuse, malgré tout cela, nous n’avions pas la moindre animosité contre elle et continuions à l’aimer parce que c’était notre sœur. Cela s’explique sans doute par la débilité mentale des enfants qui aiment parfois les personnes qui les maltraitent (les parents brutaux par exemple) par incapacité de raisonner sur les actes. Nous savions seulement qu’il faut s’aimer entre frères et sœurs et nous obéissions à cette règle éthique. Cette fillette eut l’idée de voler l’argent que notre bonne cachait dans son lit. Nous, c’est-à-dire mes sœurs et moi, savions aussi que la bonne mettait de l’argent sous son matelas, mais, outre que l’idée de vol nous faisait déjà horreur, nous n’avions pas le moindre intérêt pour l’idée de posséder de l’argent, tandis que notre compagne, élevée absolument dans les mêmes conditions que nous, ne manquant naturellement de rien, ayant les mêmes joujoux, avait déjà l’instinct de cupidité ! Du reste, mes souvenirs concernant les six premières années de mon existence sont très fragmentaires et incomplets. Alarmée par le développement précoce de ses inclinations vicieuses et craignant le voisinage de celle-ci, ma mère l’éloigna enfin de sa famille : la fillette fut confiée à l’une de mes tantes, vieille fille très charitable et à idées philanthropiques : cette brave personne s’attacha extraordinairement à notre pseudo-sœur, l’éleva le mieux qu’elle put, mais tout fut inutile au collège, Olga ne voulut jamais travailler ; à dix-huit ans, ayant abandonné sa bienfaitrice, elle faisait déjà le métier de sa mère. À vingt-deux ans, elle fut envoyée en Sibérie pour vol avec tentative de meurtre. J’ai fait cette digression un peu longue, ayant été frappé par l’opinion de Wundt qui, dans son Ethik, prétend que la doctrine de Spencer, suivant laquelle les inclinations morales peuvent se transmettre héréditairement, est du pur roman. Je crois que l’histoire d’Olga semble bien indiquer que des dispositions morales héréditaires (car l’éducation ici n’a joué aucun rôle) se manifestent de bonne heure chez certains enfants. Mais je reviens à mon récit.
Nous passions l’été dans une villa au bord de la mer Noire, dans une ville du Caucase. Nous avions pour voisins la famille d’un général dont les trois fils venaient souvent jouer avec moi dans l’immense jardin qui entourait nos maisons de campagne. Je me souviens qu’un jour j’étais seul avec Sérioja (diminutif de Serge), auprès d’un mur sur lequel était dessiné au charbon un homme avec un énorme pénis et cette inscription : « Monsieur de la p… pointue. » Je ne sais plus de quoi nous causions ; Sérioja me dit tout à coup : « Est-ce que tu fous tes sœurs ? (Il employa un équivalent russe de ce terme, tout aussi grossier ou même davantage.) — Je ne comprends pas ce que tu veux dire, lui répondis-je ; je ne connais pas cela. — Comment, tu ne sais pas ce que veut dire le mot foutre ? Mais tous les garçons savent cela. » Je lui demandai l’explication de ce mystère : « Foutre, me dit-il, c’est quand le garçon enfonce sa pissette dans la pissette de la fille. » Je pensais que la chose n’avait pas le sens commun et n’offrait aucun intérêt, mais, par politesse, je ne dis rien et me mis à parler d’autre chose. Je ne pensais plus à cette conversation qui avait été une déception pour ma curiosité, mais quelques jours après, voilà que Sérioja et Boria (Boris), l’aîné des trois frères, me dirent : « Victor, viens avec nous foutre Zoé. » Zoé était une jeune Grecque, fille du jardinier du général. Ayant déjà appris la signification du mot foutre et m’intéressant d’autant moins à un acte qui me paraissait absurde, je déclinai d’abord l’invitation ; mais ils insistèrent : « Viens donc imbécile ! Tu verras comme c’est bon ! » Ayant eu toujours par tempérament peur de désobliger quelqu’un, toujours poli jusqu’à la pusillanimité, je les suivis ! Nous pénétrâmes dans les profondeurs du jardin. Là, dans un bosquet retiré, les garçons sortirent leurs pénis du pantalon et Zoé les maniait avec ses doigts, introduisait des brins d’herbe entre le prépuce et le gland et dans l’urètre. Zoé voulut me le faire à moi aussi, mais cela me fit mal et je protestai. Puis Zoé se coucha sur l’herbe en retroussant son jupon, en écartant ses cuisses et montrant ses parties sexuelles. Elle écarta les grandes lèvres avec les doigts et je fus étonné de voir que la vulve était rouge à l’intérieur. Cela me fit une impression désagréable. Alors les garçons se couchèrent, l’un après l’autre, sur le ventre de Zoé. Comme la chose continuait à ne pas m’intéresser, je n’ai pas essayé de me rendre compte s’il y avait eu une immissio penis ou si le contact était superficiel. Je les voyais seulement s’agiter beaucoup, l’une dessous, les autres dessus pendant assez longtemps. Vint mon tour. Toujours par politesse pour la compagnie, je mis mon pénis sur la vulve de la Grecque, mais celle-ci ne fut pas contente de moi, me traita d’imbécile et de vieux rossinante (kliatcha), dit que je ne savais pas faire l’amour, que ma pissette était comme un chiffon. Elle essaya de m’apprendre à mieux faire, mais n’y réussit pas et répéta que j’étais un imbécile. J’étais très blessé dans ma dignité, surtout de la qualification de vieille rosse, d’autant plus que j’avais conscience de faire une chose si absurde et si insipide par pure courtoisie pour la compagnie et sans m’y intéresser le moins du monde. Du reste, je n’avais pas le moindre soupçon que tout cela pût être considéré comme honteux ou immoral. Aussi, de retour à la maison, je racontai à ma mère devant tous et le plus tranquillement, le plus ingénument du monde (ce n’était nullement une délation, puisque je ne savais pas que foutre une jeune femme fût répréhensible, à quoi nous nous étions amusés. Épouvante générale, terrible scandale. Mon père va voir le général pour l’avertir du danger moral auquel ses enfants ont été exposés, sans doute par la fréquentation de quelques mauvais sujets, comme cette Zoé ; mais le général devient furieux à l’idée qu’on ait pu supposer sa fille (pensez donc, la fille d’un général !) capable de faire des choses sales, il affirma que j’avais menti, il dit des injures à mon père qui lui répondit avec virulence ; la brouille entre les deux familles voisines fut complète. Tel fut mon premier contact avec les choses sexuelles, contact qui, du reste, ne me salit nullement, car je n’ai jamais rien compris à ce que j’avais vu et n’ai pas ressenti l’ombre d’une émotion génésique.
Je me souviens que, quelque temps après cet incident, et de retour à Kiev, ma tante, venant d’arriver de la campagne, causait avec ma mère sans savoir que je les entendais. Elle disait avoir découvert qu’Olga qui, à la campagne, dormait sur la terrasse à cause des chaleurs estivales, avait été continuellement visitée la nuit par le fils du chauffeur, qui s’introduisait dans son lit « pour lui faire des saletés ». Après le scandale du Caucase, je compris de quelles « saletés » il s’agissait. Et ma mère de dire à ma tante : « Ah je comprends maintenant pourquoi Olga est arrivée ici si jaune et avec des bleus sous les yeux. » J’en conclus que faire des « saletés » était nuisible à la santé. À cette époque, j’étais excessivement pudique. Cette pudicité n’avait aucune base sexuelle et était, je pense, purement imitative, mais je croyais que c’était chose effroyable que de se montrer à une personne du sexe féminin non seulement nu, mais même en caleçon. J’avais une chambre pour moi tout seul et je me souviens de la terreur que j’ai éprouvée quand notre femme de chambre faillit me surprendre pendant que je changeais de caleçon. Depuis ce moment, je m’assurai toujours avec soin si ma porte était bien fermée avant de me déshabiller, etc. Ce qui me fait croire qu’il n’y avait rien de sexuel en cela, c’est que je connais des amis éprouvant les mêmes terreurs pudiques : c’est un phénomène d’imitation et de suggestion. Mon père, pour m’inspirer le courage physique, parlait devant moi avec mépris des jeunes hommes faibles, poltrons, qui sont comme des « femmelettes » : cela fit sur moi une si profonde impression que jusqu’à l’âge adulte je considérai la faiblesse physique comme la chose la plus honteuse, pire que les plus grands vices, et je m’épouvantai à la pensée que j’étais peut-être une de ces « femmelettes » dont me parlait mon père, alors que j’étais, au contraire, très robuste et physiquement courageux quoique poltron moralement. Pour revenir à la pudicité, j’ai eu à cette époque des rêves qui se sont perpétués à travers toute mon existence et se continuent encore aujourd’hui je rêvais que je me trouvais dans la rue ou dans un salon, sans vêtements : je tâchais de cacher ce scandale et j’éprouvais d’indicibles souffrances. Comme je viens de le dire, ces rêves, je les ai encore maintenant et ils me font souffrir autant qu’avant. Et pourtant je n’éprouvais plus dans la vie réelle aucune espèce de sentiment de pudicité et, si j’évitais de me faire voir nu, c’était par respect pour les règlements publics et nullement par sentiment intime. Nouvelle preuve de la profondeur des traces subconscientes des impressions. Un autre rêve horrible dont rien n’a pu m’affranchir, c’est la vision d’être sur nu un banc dans un parc ! J’ai ce torturant cauchemar, encore maintenant, au moins une fois par semaine. Quant au rêve d’être complètement nu au milieu des gens, je l’ai tous les quinze ou vingt jours et il est vraiment pénible. Des conversations m’ont appris que beaucoup de personnes (surtout les femmes) ont des rêves angoissants où elles se trouvent dévêtues au milieu des gens. Quand j’étais enfant je rêvais souvent aussi que je tombais dans des profondeurs ou que j’étais poursuivi par des bêtes sauvages et des chiens, mais arrivé à l’âge adulte, j’ai cessé d’avoir ces rêves-là. À cette époque nous avions une jeune dame, Mlle Pauline, qui nous enseignait le français qui était française, très brave fille de 20 ans que nous aimions beaucoup. Elle me faisait lire des livres français, ce que je faisais avec passion, surtout quand c’étaient des livres de voyages ou d’aventures de guerre. Nous aimions bien aussi la femme de chambre et je ne sais pas ce que je préférais écouter : les chansons provençales que chantait Mlle Pauline en s’accompagnant du piano ou les histoires salaces que nous racontait la femme de chambre Pélagie.
À cette époque de ma vie, tout près de notre maison il y avait un corps de garde où j’avais de nombreux amis parmi les soldats, et j’ai noué des relations d’amitié avec plusieurs soldats qui, à mes yeux, étaient entourés d’une auréole de majesté quasi divine. Les soldats m’ont initié au patriotisme russe en m’assurant que l’armée russe n’avait jamais été battue et ne pouvait être vaincue par aucune force humaine, parce qu’un seul soldat russe est plus fort que cinquante soldats allemands, français, anglais ou turcs. Mon père me disait que Sébastopol avait été pris par les Français, mais mes amis les soldats assuraient que, tout au contraire, ce sont les soldats français et anglais qui avaient été battus et exterminés sous Sébastopol et cela me paraissait bien plus vraisemblable. Moi, je lisais passionnément les journaux et m’exaltais au récit des victoires de mes compatriotes (les revers n’étaient jamais avoués par la presse russe). Les généraux Gourko et Skobéleff étaient mes héros préférés. Vers la même époque je faillis devenir croyant. Mes deux sœurs et moi, nous avions été élevés en dehors de toute religion, ce qui est le cas de presque tous les enfants d’intellectuels en Russie. On ne sait pas assez en Europe que les classes instruites en Russie sont totalement irréligieuses et athées. On juge la Russie d’après des esprits exceptionnels, tels que Tolstoï ou Dostoïevski. Leur mysticisme, leur christianisme est complètement étranger à la société éclairée en Russie. Et les femmes, chez nous, sont aussi peu croyantes que les hommes. Nous autres Russes, nous ne pouvons même comprendre comment les gens instruits, dans l’Europe occidentale et surtout en Angleterre, s’intéressent tellement aux questions religieuses ; nous nous étonnons que des Anglais intelligents, et quelquefois savants, aillent dans un temple pour écouter les banalités morales et les plats lieux communs d’un prédicateur ; l’habitude anglaise de lire sans cesse la Bible, de la citer en toute occasion, nous paraît une manie étrange, car nous trouvons qu’il y a des milliers de livres plus instructifs, plus agréables, plus intéressants à tous les points de vue que la Bible. De même, lorsque nous apprenons que, dans les pays de l’Europe occidentale, des savants et des philosophes, des penseurs sérieux discutent pour savoir si le sentiment religieux est éternel et si l’humanité pourra jamais s’en passer, nous ne pouvons pas cacher notre surprise, puisque nous vivons dans un milieu où tout sentiment religieux a disparu sans laisser de trace. Comment pouvons-nous admettre la nécessité et la pérennité de la religion, si chez nous toute la société instruite, la fleur et l’élite de la nation, un million d’individus ou davantage, vit sans éprouver le moindre besoin des croyances religieuses ? À ce point de vue, le Russe typique ce n’est pas l’excentrique Tolstoï, mais bien Kropotkine qui, pendant sa longue existence, a médité sur une foule de choses, mais jamais sur Dieu, ni sur l’âme. La question religieuse ne se pose pas à lui, pas plus que la question de l’astrologie, de la chiromancie, etc. Dans ma famille, comme dans toutes les familles avec lesquelles nous étions en relation, on ne parlait jamais de Dieu, de la vie future, de Jésus-Christ. En Russie la langue liturgique est le vieux slavon qui est au russe actuel ce que l’anglais de Beowulf ou de Caedmon’s Paraphrase est à l’anglais d’aujourd’hui. C’est pourquoi les prières que récite le peuple russe sont, pour lui, absolument inintelligibles.
Ma ferveur religieuse ne dura pas longtemps. La période mystique fut donc bien brève dans ma vie, mais ma professeure de français m’envouta, avec elle je fus soudain sous le coup d’un véritable étourdissement érotique alors que je vivais alors surtout dans un monde intérieur de rêveries et d’images fictives. Quand elle regardait la reproduction de quelques statues antiques en montrant le bas-ventre de quelque nudité mythologique féminine, elle me disait : « On n’a pas dessiné le plus joli. Voudriez-vous le voir dans la réalité ? » Ces inconvenances me choquaient et je tâchais de l’intéresser aux matières graves, mais elle m’interrompait en disant : « Comme vous êtes savant, comme vous êtes savant ! Si savant ! Vous savez tout ce qu’il y a dans le ciel et sur la terre, vous avez lu tous les livres. Et pourtant il y a un point où je suis plus savante que vous ; il y a une chose que vous ne savez pas et que je sais. Pendant que vous dormirez, je viendrai auprès de vous et entourerai vos testicules (en Russie on désigne vulgairement ces organes par le mot ordinaire qui veut dire œufs, yaitsa) avec une ficelle que je serrerai très fortement en faisant un nœud avec elle ! Et alors qu’est-ce que vous ferez ? Vous ne pourrez rien faire ! » Enfin, un soir, elle fut plus hardie, saisissant brusquement de sa main gauche ma main droite, elle mit celle-ci sur sa vulve, tandis que de sa main droite elle ouvrit mon pantalon et saisit fortement mon membre viril. Tout mon équilibre psychique se modifia, l’érection se produisit… “Voilà, comme ça ! Fais-moi ça encore ! Mets-le dedans ! Plus fort ! J’étais tourmenté du désir ardent de recommencer l’expérience. Pendant les jours suivants, je m’arrangeai de façon à me retrouver seul avec elle pour avoir des coïts plus ou moins complets. Accablé de fatigue et moulu d’excitation sexuelle, le pénis constamment érigé, avec des douleurs aux testicules je m’endormais, sans peine et me me réveillai assez tard, à la mode russe. Seuls les soupirs qu’elle poussait de temps en temps et quelques rares mouvements involontaires qu’elle ne pouvait réprimer me démontraient qu’elle jouissait. Je ne me lassais pas de la regarder, ses seins se sonr ainsi profondément gravés dans ma mémoire. Elle était l’idéal de la beauté. Le mont de Vénus, très prononcé, replet et rebondi, élastique sous la pression, était à peine ombré d’un léger duvet doré, à travers lequel transparaissait la blancheur rosée de l’épiderme dont la finesse était admirable. Et ses épaisses grandes lèvres, en s’entrouvrant, laissaient voir les tons les plus riches du rouge, depuis le rose tendre jusqu’au carmin et à l’écarlate. Rose était le clitoris érigé, dont la dureté résistait élastiquement au doigt, roses étaient aussi les ailes extérieures des petites lèvres, mais le sillon qui s’ouvrait entre elles et qui se prolongeait vers le vestibule était d’un magnifique cramoisi sanguinolent. Au fond du vestibule on voyait l’ombre mystérieuse de l’entrée des régions inconnues, humides, les nombreux plis de l’intérieur de la fente génitale, gracieusement et harmonieusement modelés, reluisaient quand les rayons du soleil ou de la lampe les frappaient et cela rehaussait encore la splendeur de leur couleur vermeille. Encore aujourd’hui, je n’ai qu’à fermer les yeux pour voir tout cela mentalement jusqu’aux moindres détails. Elle s’opposa d’abord à l’idée des cunnilingus mais finit par céder à mes instances. Après en avoir goûté, elle préféra cet amusement au coitus in ore vulvæ. Et, en effet, il était visible que cette seconde méthode la faisait jouir davantage. Il n’y avait qu’à observer son visage, qu’à voir les contorsions de son corps, qu’à entendre sa respiration et les cris involontaires qu’elle poussait. Je voyais les tressaillements de son ventre convulsé, je voyais se tordre son bas-ventre, la grasse pelote de son mont de Vénus, qui, par des mouvements involontaires de côté, échappait à ma bouche. Pendant que je suçais, léchais et mordillais le clitoris et les petites lèvres, toute la vulve palpitait, je voyais l’orifice du vagin s’élargir et se rétrécir spasmodiquement ; un liquide visqueux filait de cette ouverture de plus en plus abondamment, ruisselait partout. Pendant ce temps, elle se démenait frénétiquement, agitait les bras en l’air, en crispant les doigts, ou saisissait les objets qui étaient à sa portée, mon épaule, mon bras. Tantôt elle serrait vigoureusement, à m’étouffer, ma tête entre ses cuisses veloutées et parfumées, comme si ses jambes avaient des crampes ; tantôt, au contraire, elle ouvrait ses jambes et les distendait démesurément, comme si elle voulait se fendre en deux, tantôt les levait en l’air, les agitait, les approchait de sa tête. Elle se débattait si énergiquement que ses organes sexuels à chaque instant s’arrachaient à ma bouche qui les reprenait ensuite. Des paroles entrecoupées exprimaient aussi l’intensité de sa jouissance. Le goût même des muqueuses sexuelles était très agréable à ma langue et à ma bouche. C’est, du reste, ce qu’éprouvent tous les viveurs : souvent ils disent qu’il n’y a pas de mets plus savoureux que ces parties de la femme. Le mucus que sécrète la femme qui jouit (qui jute, comme disent les Français) est également très agréable au palais, malgré son goût âcre et salin et quoique Aristophane l’appelle (dans les Chevaliers) l’abominable rosée.
Je lisais de préférence à cette époque les romans français. Les romans russes n’étaient pas suffisamment érotiques pour moi. La littérature russe était alors très chaste elle a bien changé depuis, surtout dans ces dernières années. En ce qui concerne la manière de traiter des relations sexuelles, il y a autant de différence (mais dans le sens inverse) entre la littérature russe d’il y a vingt à trente ans et celle d’aujourd’hui qu’entre la littérature anglaise du temps de la reine Anne et celle de la période comprise entre 1830 et 1862. Nous avons aujourd’hui des écrivains dont raffole le public (Artsibacheff, par exemple) qui poussent la pornographie aussi loin que les naturalistes et décadents français les plus libidineux. Il n’en était pas ainsi alors. Les belles lettres étaient austères. Une lecture me donna la plus forte émotion érotique. C’était un article publié dans un périodique qui tomba entre mes mains. C’était le compte rendu détaillé d’un procès qui fit alors beaucoup de bruit en Russie. Une jeune personne excentrique, fille d’un marchand très riche, tua, avec la complicité de ses compagnons de débauche, dans un lupanar de Moscou, un homme appartenant, comme elle, à la bonne société. Cette jeune fille de moins de vingt ans était homosexuelle et le mobile du crime fut la jalousie : elle voulut se venger de ce qu’on lui avait enlevé une amante. Il résulta du procès que cette riche héritière, nageant dans le luxe, avait coutume de se déguiser en homme et de visiter, en compagnie de jeunes gens de la jeunesse dorée, les lupanars de Moscou, les plus luxueux comme les plus misérables. Telles sont les circonstances de ce procès, si j’ai bonne mémoire, car jamais, depuis, je n’ai eu l’occasion de lire quelque chose au sujet de cette affaire. Mais je me souviens avec précision que, dans le compte rendu publié par la revue en question, il y avait la reproduction complète de l’expertise médicale. Il y avait, entre autres, une description des parties sexuelles de la jeune fille, description tellement complète que je n’ai vu, depuis, rien de pareil : le moindre détail était indiqué, tantôt en termes pittoresques, tantôt avec des mesures exactes en centimètres, millimètres, etc. En lisant cela, je m’excitais à penser de quelle façon ces mesures avaient été prises, comment on avait mesuré la longueur du clitoris, les dimensions des petites lèvres dans leurs différentes parties, la profondeur du vagin ; je me représentais les savants appréciant les teintes de la coloration de la vulve sur différents points… Cette phrase me faisait rêver : « La sensualité de la patiente se décèle par la grande excitabilité des petites lèvres et du clitoris qui entrent en érection violente au moindre attouchement. » Il y avait des détails sur les sensations qu’elle éprouvait, d’après son propre témoignage, dans le coït normal ou bien dans les relations homosexuelles. Bref, cette lecture agit sur moi comme un puissant aphrodisiaque. Je suis constitué, en effet, de telle façon que c’est par l’imagination que je reçois la plus forte excitation sexuelle. Les images mentales ont sur moi, à cet égard, autant et plus d’action que les images physiques. Mais ce n’est pas tout à fait de l’auto-érotisme : enfermez-moi entre quatre murs et l’obsession sexuelle m’abandonnera bientôt. Mon imagination, pour travailler dans la direction érotique, a toujours besoin d’un stimulus extérieur vue des organes sexuels de la femme, vue d’un dessin obscène, lecture pornographique, conversation grivoise. Il ne suffit pas qu’il y ait auprès de moi une femme, jolie et appétissante ; la vue de la plus jolie, de la plus charmante femme, si elle est habillée avec décence et a un maintien honnête, ne me suggère jamais le désir de coïter avec elle, ne provoque jamais chez moi une érection. Pour que l’appétit érotique se réveille chez moi, il est absolument nécessaire que la femme se comporte d’une manière provocante, que j’entende des paroles lascives, que je voie des nudités ou bien que je sois sous l’impression d’une lecture érotique, d’une conversation obscène toutes fraîches. Les souvenirs érotiques anciens cessent de m’exciter, une lecture lascive me laisse généralement froid si elle n’est pas neuve pour moi, c’est-à-dire si elle date car, au commencement, les mêmes grivoiseries m’excitent, même si je les relis plusieurs fois de suite : au bout de quelques jours l’aiguillon s’émousse. Ainsi je puis rester pendant longtemps dans un état de neutralité sexuelle absolue : une image voluptueuse qui, par hasard, se présente du dehors (il est absolument nécessaire qu’elle vienne du dehors et ne soit pas engendrée par mon propre esprit) vient brusquement rompre cet équilibre et m’enflammer d’ardeurs charnelles. Je ne sais pas jusqu’à quel point ces dispositions psychologiques sont anormales et morbides c’est à un spécialiste de se prononcer là-dessus.
Au milieu des nombreuses servantes de la maison, des filles de ferme et des filles de champs, j’étais plongé dans une atmosphère vraiment cythéréenne. Je ne tardai pas à nouer des relations avec la plupart de ces filles, on pouvait tout obtenir de ces viragos robustes avec quelques cadeaux insignifiants : un paquet d’épingles à cheveux, un ruban de quatre sous, un bonbon, un gâteau, même un morceau de sucre. Et, en effet, pour ces offrandes dérisoires, les « vierges fortes » de l’Ukraine me permettaient de regarder et de palper les parties les plus secrètes de leur corps. Cela se passait n’importe où, dans une chambre, dans un hangar, une écurie, derrière une meule, dans les buissons, elles riaient toujours aux éclats quand elles entendaient une obscénité. À toute heure de la journée et de la nuit (excepté peut-être pendant le sommeil), elles ne pensaient qu’à l’acte sexuel. Comme des chiennes en chaleur, elles rôdaient partout où elles avaient la chance de rencontrer un mâle isolé et elles se livraient ! Ces fortes femelles, Ukrainiennes admirablement râblées, étaient exubérantes de santé et de vie animale, avec leurs joues rouges, leurs énormes postérieurs, leurs seins durs et saillants, leurs jambes semblables aux colonnes doriques, leurs vulves musculeuses et puissantes. Ma vie sexuelle pendant toute cette période a été très active. Chez moi, comme, sans doute, chez toutes les personnes nerveuses, l’imagination constitue l’élément le plus important du plaisir sexuel. Je ne puis pas jouir si le ne me représente la jouissance éprouvée par la femme. Il me serait impossible de faire l’amour à une femme endormie ou évanouie. Et l’idée seule qu’une femme éprouve une émotion sensuelle suffit pour me faire moi-même jouir. Les idées ou (si l’on veut) les préjuges spiritualistes rendent les jouissances sexuelles plus aiguës et plus variées. C’est ce que Huysmans (en parlant de l’art de Rops) a exprimé avec exagération et grosso modo en soutenant que la grande et profonde luxure n’est pas possible sans le diable, et ce que Renan fit remarquer avec une finesse exquise en glorifiant le christianisme comme le maître des voluptés érotiques plus subtiles que celles de l’Antiquité. Voilà ce qu’oublient les nombreux auteurs qui flétrissent le christianisme au nom de l’érotisme triomphant et des droits de la chair. La titillation purement physique dans les relations sexuelles n’est rien ou presque rien à côte de l’excitation psychique et du prurit mental : or le christianisme a précisément exaspère ce côté psychique de la jouissance charnelle ; il a ouvert une carrière immense à l’imagination sexuelle, et il me semble que, chez l’homme civilisé, les plaisirs sexuels tirent toute leur valeur et tout leur attrait de l’imagination ; sans elle, l’acte sexuel n’est ni plus ni moins agréable que la défécation ou, tout au plus, que le boire et le manger pour les personnes non gourmandes. La pudeur féminine est un aphrodisiaque pour l’homme, mais seulement quand elle se laisse vaincre par la volupté de la même personne. Quand je suis au lit avec une femme comme il faut, ce qui m’excite le plus, c’est cette idée qu’il se passe quelque chose de paradoxal, d’invraisemblable : voilà une femme qui considère comme quelque chose de terrible le fait de montrer certaines parties de son corps ; elle les cache à tout le monde, surtout aux hommes, elle les considère comme honteuses, elle n’ose pas les nommer… Et pourtant, cette même femme les montre maintenant à un homme et à celui-là précisément à qui elle devrait s’obstiner le plus à ne pas les montrer, car c’est l’homme qu’elle aime, c’est-à-dire celui qui l’intimide et la trouble le plus et celui qui les regarde de l’œil le moins indifférent, le plus lascif ; et cet homme, non seulement regarde ces parties, il les touche, les manie, les excite par des attouchements ; il les touche non seulement avec la main, mais avec une partie du corps qui est également honteuse aux yeux de la femme et que celle-ci, normalement, a peur non seulement de toucher, mais de voir, de nommer, à laquelle elle ne devrait jamais penser (telle est, du moins, la convention), et le contact n’est pas seulement superficiel, l’homme introduit sa partie la plus honteuse dans la partie la plus honteuse de la femme… Et cette violation de la pudeur est d’autant plus piquante qu’elle est temporaire. Une heure plus tôt ou une heure plus tard, la femme a été ou sera habillée, cachera soigneusement presque toutes les parties de son corps et rougira rien qu’à entendre le nom de la chose qui lui causa tant de plaisir… Combien diminuerait le plaisir sexuel sans tout ce conventionnalisme — absurde en apparence — de la pudeur féminine !
Pour les mêmes raisons, les sécrétions voluptueuses de la femme ont pour l’imagination la plus grande valeur symbolique ou fétichiste. Rien ne m’excite autant que la vue, le contact ou la seule idée du mucus vulvo-vaginal. C’est que c’est le signe visible et tangible de la sensualité, de la volupté de la femme. L’érection des organes sexuels féminins est à peine visible ; en revanche, grâce au liquide sexuel, il y a une preuve évidente et matérielle que la femme est érotiquement excitée, qu’elle a « des sens », comme disent les Français, que c’est un être terrestre comme nous autres ou que, si c’est un ange, c’est un ange qui quelquefois déchoit… Par toutes les forces de mon imagination, je me transporte dans les parties sexuelles de la femme, je me représente la jouissance qu’elle éprouve et cela décuple ou centuple ma propre jouissance directe. Dans tout cela, il y a des éléments non seulement sensitifs, mais moraux (ou, si vous aimez mieux, immoraux) éthico-affectifs et intellectuels. Mais je reviens à mon récit. Je me suis étrangement passionné pour la politique, lisant la littérature révolutionnaire clandestine, m’affiliant à des sociétés secrètes, communiant dans la religion anarchiste et terroriste et lisant aussi des livres sérieux : Spencer, Mill, Buckle, Renan, Louis Blanc, Taine, Marx, Lassalle, Laveleye, Proudhon, Darwin, Häckel, Summer Maine, Morgan, Engels, Tarde, F.-A. Lange, Büchner, Letourneau, etc. Mes deux états habituels étaient, ou l’excitation érotique directe, ou la prostration mélancolique accompagnée de rêveries souvent également érotiques. Quand je me remettais à travailler avec une certaine énergie, c’était pendant les intervalles d’abstinence sexuelle mais, comme je l’ai dit, cela ne durait guère. Je me masturbais ce qui contribuait à augmenter ma dépression morale, facilitée par le libéralisme des mœurs russes. Alors pour changer, je lisais Marx, Nietzsche, Weininger, Tolstoï et B. Shaw, non à cause d’une grande largeur d’esprit, mais à cause du manque de clarté dans les idées, du caractère chaotique de la mentalité russe et aussi d’une grande idolâtrie pour toutes les célébrités et autorités intellectuelles : comme les gens religieux trouvent toujours le moyen de concilier les textes sacrés les plus contradictoires, de même les Russes finissent toujours par prêter les mêmes opinions (les leurs propres) aux hommes célèbres dont les opinions divergent le plus et interprètent, par exemple, Nietzsche dans le sens du communisme révolutionnaire et de la social-démocratie ! Mais laissons cela. Le livre dont je parle était intitulé, je crois : Éléments de la science sociale. Misère, prostitution, célibat. L’auteur anonyme se disait docteur en médecine. On croyait en Russie que c’était un fils du célèbre Robert Owen. Cet ouvrage contenait des notions sur les phénomènes sexuels et recommandait aux jeunes gens des deux sexes de commencer le commerce charnel de bonne heure en pratiquant le néo-malthusianisme pour éviter les grossesses. J’avais lu ce livre depuis longtemps quand je le vis sur la table de Nadia (appelons ainsi la fiancée de mon ami nihiliste. Elle me dit que l’abstinence sexuelle était condamnée par la raison et la science, puis elle n’apprit qu’elle avait eu des relations sexuelles et que maintenant elle avait des rêves érotiques avec pollutions nocturnes qui la fatiguaient beaucoup. « Voyez, ajouta-t-elle, même en ce moment, en causant avec vous de ces choses, j’éprouve l’excitation sexuelle. Vous aussi, continua-t-elle, vous devez souffrir de votre vie anti-naturelle » Elle me dit que ma chasteté pouvait me faire beaucoup de mal, me conduire a la folie. « C’est pour cela, dit-elle, que vous avez si mauvaise mine, l’air si maladif. » Finalement, elle me proposa d’avoir avec elle des relations sexuelles, ce qui devait faire un grand bien a sa propre santé et à la mienne.
Nadia avait un extérieur assez agréable : les cheveux blonds cendrés, des yeux gris expressifs, des traits assez réguliers, sauf les lèvres trop grosses. Elle était bien proportionnée, de taille moyenne, avec de très grosses fesses et cuisses. Ses seins, au contraire, étaient petits, les parties sexuelles jolies et fraîches, avec une pilosité modérée, le vagin étroit. Jamais je n’ai eu de relations sexuelles avec une femme aussi sensuelle que Nadia et qui me donnât autant de plaisir physique. L’orgasme survenait chez elle vite, facilement et était prolongé, le spasme vénérien se renouvelait à de courts intervalles, se manifestant avec une grande intensité. Pendant le coït elle se démenait de toutes les façons, elle soupirait, gémissait, râlait, poussait des exclamations incohérentes et des cris, ses membres se convulsaient et se raidissaient cataleptiquement, sa vulve se contractait violemment et même, au paroxysme du plaisir, d’une façon douloureuse pour mon pénis ; son visage prenait alors une expression d’agonie, se voilait d’une lividité effrayante. Quelquefois le paroxysme de la volupté se terminait par une attaque de nerfs hystérique qui, dans les premiers temps, m’épouvantait, mais qui passait vite : elle riait hystériquement, pleurait, se débattait, etc. Les sécrétions voluptueuses de Nadia étaient très abondantes, jusqu’à s’écouler sur les draps du lit et y faire de grosses taches ; l’érection du clitoris, des grosses lèvres et des autres parties sexuelles était perceptible au toucher, ainsi que la chaleur accrue de la vulve congestionnée et dont les tissus se dilataient en devenant plus rouges. Tout le bas-ventre avait des mouvements convulsifs. Nadia n’était pas savante en matière érotique ; elle ne connaissait que le coït normal dans la posture ordinaire. Profitant de mes expériences et de mes lectures, je lui appris toutes sortes de raffinements. Je lui fis connaître le baiser more columbarum et le cunnilingus qui lui plut beaucoup et qu’elle finit par préférer au coït. Je l’excitais par toutes sortes de manipulations mammaires, clitoridiennes, anales, vaginales. Nous essayâmes toutes les postures imaginables du coït : le coït par-derrière ou more ferino, des Grecs, le coït debout, enfin toutes les figuræ Veneris que nous pouvions inventer ou que je connaissais par les livres ou par les images obscènes. Nous coïtions sur tous les meubles (chaises, canapés, même sur une table, comme nous l’avions lu dans Pot-Bouille), et par terre sur un tapis et des coussins. Une fois, elle pencha la partie supérieure de son corps par la fenêtre dans la rue, en laissant le reste de son corps derrière les rideaux clos, tandis que je la coïtais par-derrière, more ferarum. En nous réunissant nous lisions d’abord ordinairement quelque ouvrage lascif, les contes de Boccace, par exemple, ou les productions naturalistes françaises ; une fois suffisamment excités par cette lecture, nous nous déshabillions pour faire l’amour. Guidé par les livres, j’eus l’idée de pratiquer sur Nadia le coitus inter mammas et l’irrumatio ; pendant que je travaillais ses organes sexuels avec ma bouche et ma langue, elle prenait mon pénis dans sa bouche et opérait la fellatio. Ayant appris de moi que les femmes introduisaient dans leur vagin différents objets, elle me pria de l’onaniser en y mettant des bougies, des clefs, des crayons, des bâtons de cire à cacheter, etc. Je lui dis que le chatouillement de l’orifice urétral devait être particulièrement agréable aux femmes (je l’avais lu) par suite, elle m’autorisa à lui exciter l’urètre par différents objets effilés, par exemple par des épingles à cheveux en corne. Elle me demanda si je pouvais pratiquer sur elle la paedicatio. J’acquiesçai à ce désir et ne pus consommer l’acte qu’avec beaucoup de peine et après plusieurs tentatives infructueuses. Cette forme de copulation plut à Nadia, bien que l’acte lui fût d’abord douloureux. Dans la suite, nous renouvelâmes la paedicatio assez souvent. Nadia disait que cela ne valait pas le coït vaginal, mais que c’était agréable « pour changer ».
Si j’ai appris à ma compagne de lit différents raffinements érotiques, ce ne fut pas uniquement par luxure, mais aussi parce que souvent j’en étais réduit à la contenter en l’onanisant de différentes manières, n’ayant plus les forces suffisantes pour la satisfaire par le coït. Nadia avait, en effet, un appétit sexuel très grand et qui dépassait mes forces. Nous coïtions plusieurs fois pendant la nuit ; quelquefois elle me réveillait pendant la nuit ou au point du jour pour renouveler le coït. Quand je me sentais trop épuisé, je la satisfaisais par différentes manipulations et surtout par le cunnilingus qu’elle affectionnait particulièrement. Tous ces excès ne firent, je crois, aucun mal à sa santé, mais la mienne en fut ébranlée. Ce qui m’inquiétait surtout c’était l’affaiblissement de ma mémoire ; c’était peut-être une simple apparence, provenant de ce que les livres m’intéressaient de moins en moins ! Mes entrevues avec Nadia étaient fréquentes ; je passais la plupart des nuits dans son lit et ne rentrais chez moi que le matin. Je me souviens que, couché avec Nadia la nuit, j’entendais quelquefois, à travers le mur, un bruit de formidable hoquet, avec des intonations hystériques et presque des hurlements. Nadia m’expliqua (elle l’avait su par les domestiques) que ces attaques vraiment monstrueuses de hoquet s’emparaient de sa voisine immédiate, une jeune Polonaise, chaque fois qu’elle jouissait pendant le coït avec son mari. Chacune de ces attaques durait plus d’une demi-heure. Heureusement pour nous, la jeune Polonaise quitta bientôt ce logement. J’ai déjà dit que Nadia elle-même avait quelquefois des crises hystériques après un coït (ou une séance de cunnilingus) particulièrement voluptueux ; mais cela n’arrivait que de temps en temps. Ma liaison avec Nadia dura une dizaine de mois. J’étais assez fortement attaché à Nadia, mais par une passion purement physique. Ce qui l’indique, c’est que, quand il lui fallut me quitter, j’en éprouvai beaucoup de chagrin parce que je perdais en elle une source de grands plaisirs. Je partis ensuite à Milan. Je me mis à étudier l’italien avec un véritable plaisir. Depuis mon départ de Kiev, je vivais dans l’abstinence. Les besoins érotiques se faisaient sentir, mais, contrairement à mon attente, je ne trouvais pas le moyen de les satisfaire. Le temps passait et je commençais à m’habituer à l’abstinence. L’instinct érotique comprimé, au lieu de s’exaspérer, se calmait, ce qui ne laissait pas de m’étonner. Les livres de médecine que j’avais lus me faisaient croire que mon abstinence absolue pourrait avoir les conséquences les plus terribles ; elles ne venaient pas et ma santé physique semblait se fortifier. Mon énergie morale semblait renaître également, je commençais à m’intéresser réellement à l’art. Les tentations m’assaillaient à la suite de certaines lectures, à la vue de certaines images, d’un ballet, etc., mais comme je ne savais quelle suite donner à la révolte de ma chair, mes désirs s’apaisaient peu à peu. Je continuais à me masturber. Je m’intéressais de plus en plus aux choses de l’industrie, aux applications de l’électricité, suivais différents cours techniques, Quelle est donc la puissance de l’imagination dans la vie sexuelle de l’homme ! C’est un vrai poison aphrodisiaque. Il n’y a aucun rapport entre l’intensité du prurit produit par la réplétion des vaisseaux spermatiques, ainsi que par la tendance qui en résulte, et la violence infiniment plus grande de l’excitation et du désir provoqués par les images voluptueuses. Il y a là quelque association trop intime et regrettable de fonctions neuro-cérébrales distinctes qui, dans l’intérêt de notre équilibre psychique, seraient, si notre organisation était plus parfaite, plus différenciées, mieux isolées l’une de l’autre. Encore un manque d’harmonie de la nature ! La machine prodigieusement compliquée du cerveau se détourne partiellement de ses fonctions véritables et intervient dans le jeu des organes, qui se passeraient bien d’une immixtion si fréquente où elle apporte des troubles, tels ces gouvernements qui, à force d’intervenir à tout propos dans les relations entre individus, ne font que fausser la marche de la vie sociale. L’imagination exerce sur les fonctions sexuelles un véritable abus de pouvoir, excède ses propres attributions d’utilité biologique. Quelle utilité y a-t-il, en effet, à ce qu’on désire violemment le plaisir vénérien quand on a dépensé tout le sperme dont on disposait et quand on se sent épuisé ? Et pourtant c’est une chose très ordinaire sans cela, on ne ferait pas d’excès !
C’est parce que j’ai observé le rôle immense de l’imagination dans le développement de la libido que je me permets d’avoir une opinion particulière sur la geschlechtliche Aufklarung. Je sais que j’émets une hérésie épouvantable, un paradoxe qui va à l’encontre de l’opinion de la presque totalité de mes contemporains et que je m’insurge contre toutes les autorités scientifiques, mais il m’est difficile de croire que la geschlechtliche Aufklarung soit le meilleur moyen de se préserver. J’ai remarqué en effet que l’éveil de l’instinct sexuel a souvent un point de départ purement mental. C’est un livre scientifique qui fit naître chez moi pour la première fois le désir génésique, la libido, et je connais beaucoup de cas analogues. La révélation sexuelle déclenche ce mécanisme inactif, met en jeu l’imagination, et l’activité sexuelle se développe rapidement. Mais la question est complexe et je n’insiste pas. Mon expérience m’a montré aussi que, seule, l’activité de l’imagination rend l’abstinence difficile. Si, par suite de quelque circonstance, l’imagination est détournée des choses sexuelles, on réprime facilement l’excitation purement physique. Deux ou trois jours après mon arrivée à Naples, un individu se cramponna à moi sur la place Carlo en se faisant fort de me faire voir des choses « vraiment intéressantes ». « Je ne vous trompe pas, me disait-il, je suis un parfait gentleman, io sono un galantuomo, je vous montrerai des choses que vous ne verriez pas ailleurs ; vous pourrez vous vanter de ne pas avoir été pour rien à Naples, vous aurez un sujet de conversation avec vos amis. Je vous conduirai chez une femme très honnête, que vous pourrez voir et toucher nue, et le prix est très modéré, c’est quarante francs. Vous ne voulez pas ? Voyons, trente-cinq francs, trente francs et un pourboire pour moi ! » Mû d’une part par la curiosité d’observateur des mœurs, excité d’autre part par l’aiguillon charnel dans cette ambiance de luxure, je me laissai tenter, pour mon malheur. Nous montâmes dans l’appartement. À en juger par l’appartement et l’ameublement, c’était, en effet une femme bien, sinon de bien. Tout portait le cachet de l’aisance. La Dame vint me faire l’article, haussa le prix en affirmant que l’entremetteur s’était trompé, là-dessus. L’audace de son regard démontrait qu’elle était loin d’être novice. Cela tranquillisa un peu ma conscience. Pour la calmer, je me disais : « Je ne corromps personne. Si on peut m’accuser de favoriser la luxure, c’est dans la même mesure où tout homme qui paie une prostituée favorise le mal social de la prostitution, qui sait aussi quelle tournure l’affaire prendrait pour moi, surtout dans une ville comme Naples où les pouvoirs publics sont souvent les compères des criminels, où la police est évidemment de complicité avec les trafiquants de chair humaine ? Donnons-nous donc un moment de plaisir qui ne fait, en somme, de mal à personne ! Ce n’est pas moi qui régénérerai la Babylone italienne ! » … Grands yeux noirs, traits fins et réguliers, le teint du visage d’une jolie nuance olivâtre. Le corps était fait au tour, les organes sexuels charmants, une toison peu abondante sur le pubis, mais son expérience était vaste. Elle était très sensuelle, mais, chose curieuse, elle avait des orgasmes violents, avec un visage d’agonisante et des sécrétions abondantes, adorait les conversations, photographies et lectures obscènes, exerçait ses talents érotiques avec passion, son visage rayonnait de joie. Elle confessa aussi qu’elle éprouvait les désirs charnels les plus forts au matin, après le réveil. Elle aimait à baiser mon pénis, de son propre mouvement et indépendamment de la fellatio : elle exprimait ainsi son amour pour cet organe. Elle le sortait en se répandant en exclamations admiratives sur sa grosseur et sa longueur, le baisa et puis elles se mit à me masturber avec ses doigts, si vite et si rapidement qu’elle obtint une éjaculation au bout d’une demi-minute ou d’un quart de minute. La sensation fut nouvelle, âcre et délicieuse, elle me parut plus agréable que celle du coït. Ainsi naquit chez moi un vice qui devait m’être funeste.
Mon sang était embrasé comme pendant la première fougue des passions précoces de mon enfance. Je ne pus m’empêcher de revenir et d’y revenir souvent. Le coitus in ore vulvæ qui lui plaisait tant ne me suffisait pas ; je la soumettais au cunnilingus et ne m’opposais que trop mollement à ses tentatives de me manueliser ; après une lutte à moitié simulée, elles remportait sur moi la victoire, enthousiasmée de voir mon sperme lancé à une grande distance. Rentré chez moi, je repassais dans mon esprit les scènes brûlantes que je venais de voir et ne pouvais m’empêcher de me masturber de nouveau. Ma griserie sexuelle augmentait de jour en jour. Du reste, à Naples, ville de la camorra, personne ne se mêle des affaires d’autrui quand elles sont louches ; au contraire, dans ce domaine règne l’entraide la plus touchante, qui se limite quelquefois à la conservation du secret, à charge de revanche. Après avoir été chaste si longtemps, je devins ou redevins un débauché, par suite d’une circonstance purement fortuite, ce maudit voyage à Naples, et de la direction perverse qu’y reçut ma vie sexuelle. L’habitude que j’avais prise de me masturber devenait de plus en plus tyrannique ! Après les âcres voluptés dans lesquelles je venais de me plonger, le coït normal me semblait un peu fade, presque insipide. Mais ce qu’il y avait de plus triste, c’est que, quelques heures après le coït, en y pensant, il fut plus voluptueux dans mon imagination qu’il ne l’avait été dans la réalité et je ne pus m’empêcher de me masturber de nouveau en repassant dans mon souvenir tous les détails de l’acte accompli. À mon grand désespoir, il en fut ainsi plusieurs fois de suite. Mais un jour j’eus la joie de goûter le coït normal plus fortement que d’ordinaire et de ne pas rechuter ensuite dans la masturbation. La même chose se répéta deux jours après. Je voyais en cela le commencement de ma guérison psychique et je recommençais à rêver. Mais la fatalité me poursuivait. Quelque temps après, je quittais Naples. Non sans peine j’en avais vraiment besoin, car, à Naples, j’avais dépensé toutes mes économies. J’étais maintenant bien différent de l’homme que j’étais en partant de Milan. D’abord, je suis devenu un masturbateur endurci. Chose étrange ! Si je pratique à présent le coït, ce n’est pas pour lui-même ; il ne me satisfait pas assez, c’est pour pouvoir me masturber ensuite, en excitant mon imagination par le souvenir même de cet acte, que je revois mentalement dans ses moindres détails. C’est pourquoi je coïte ordinairement dans la journée et me masturbe la nuit suivante dans mon lit. Le coït est devenu ainsi pour moi comme le fétiche ou le symbole de la masturbation ; c’est un simple excitant ou stimulant de l’imagination, comme une lecture pornographique ou une image obscène ; il ne vaut pas par lui-même. Il ne m’est réellement très agréable que dans le souvenir, dans l’idée, non dans la réalité. Dès que je coïte plus souvent, il faut aussi que je me masturbe plus souvent, dans la même proportion. Récemment une Espagnole me raconta qu’elle s’était laissé déflorer par un amant, qu’elle aimait d’amour, pour lui complaire. Depuis ce moment, l’amant ne voulut plus la coïter in ore vulvæ. Comme le coït complet ne la satisfaisait pas et comme elle avait la nostalgie des anciennes sensations, elle fut obligée de s’adresser à des amis pour lui faire faire l’amour à l’ancienne façon. Elle trompait ainsi son amant qu’elle continuait à aimer sentimentalement quoiqu’il ne lui procurât presque plus de plaisir sexuel, car il s’obstinait à ne plus pratiquer avec elle que le coït normal. Une exquise Napolitaine me dit, toute rayonnante de volupté après avoir été coïtée par moi in ore vulvæ : Non vale questo piu di una chiavata ? (cela ne vaut-il pas mieux qu’une « foutée » ?), et pour atténuer la crudité de l’expression chiavata, elle ajouta pudiquement et en baissant les yeux : come dicono i Napoletani… (comme s’expriment les Napolitains). Cela m’a rappelé le « outre… que vous me feriez dire » dans le Tartarin de Daudet. Sur ma prière, elle expliqua sa préférence : In una sola seduta ho fatto due volte. Cio non mi succede mai chiavando. Quando mi si chiava, non ho fatto ancora nemmeno una volta, a malapena comincio a riscaldarmi ed ecco, zick-zack, il benedetto signore ha già sborrato, l’uccellone è uscito fuor della gabbia, ed io rimango fritta. Nell’altro modo, al contrario, io sborro due, o tre volte prima che l’altro abbia fatto. C’est-à-dire : « En une seule séance j’ai fait deux fois. Cela ne m’arrive jamais en foutant. Quand on me fout, je n’ai pas fait encore une seule fois ; à grand-peine commençais-je à m’échauffer et voilà que mon monsieur, une, deux, a déjà éjaculé, le grand oiseau (le membre) est sorti de la cage et je reste en panne. De l’autre façon, au contraire, j’éjacule deux ou trois fois avant que mon partenaire ait fait. » Puisque je parle des particularités que j’ai observées chez les hétaïres italiennes, j’ajouterai encore que la plupart m’ont assuré préférer les relations homosexuelles aux relations normales avec les hommes. m’affirmant que ces goûts étaient maintenant bien plus répandus qu’autrefois.
J’ai maintenant environ quarante ans. J’ai passé les huit ou neuf dernières années dans les fumées de la luxure. Pendant cette période, au milieu des jouissances physiques, j’ai été très malheureux. J’ai mené une existence absurde, étant fait, cependant (j’en suis convaincu) pour une tranquille vie monogamique), j’ai cruellement fait souffrir, physiquement et moralement, puis je suis devenu masturbateur… Et dire que, depuis mon enfance, la masturbation était ce que je craignais le plus ! J’ai acquis des passions honteuses et ridicules ; ma santé générale, depuis que j’ai cessé d’être continent, est redevenue mauvaise. Mon système nerveux est détraqué. J’ai des insomnies fréquentes et des cauchemars. Le coït lui-même n’est devenu pour moi qu’un excitant à la masturbation. Je me méprise moi-même. Ma vie n’a pas de but et j’ai perdu tout intérêt pour les choses honnêtes. J’accomplis mon travail professionnel avec indifférence et il me devient de plus en plus difficile de m’en acquitter consciencieusement. Un travail que je faisais autrefois très aisément demande aujourd’hui de moi un effort pénible. L’avenir m’apparaît sous des couleurs de plus en plus sombres. Mon père est mort il y a quatre ans, un an après notre voyage commun en Angleterre où il fut écœuré par l’amour du public anglais pour les sports et par le modérantisme des « prétendus » radicaux anglais. En mourant, il ne m’a laissé aucun héritage, la propriété qu’il avait eue s’étant effondrée depuis longtemps sous le poids des hypothèques surhypothéquées ; quant à ce qu’il gagnait par son travail, il le dépensait à mesure, d’une façon qui, du reste, n’était que partiellement égoïste. Dans ces dernières années, j’ai eu l’occasion de revoir la Russie deux fois. J’ai fini par quitter l’Italie et par m’installer à nouveau à Kiev où j’ai trouvé une situation plus avantageuse. Mais, je n’ai pas changé d’humeur et reste aussi pessimiste (en ce qui me concerne), aussi dégoûté de moi-même qu’auparavant. Des idées de suicide me hantent de plus en plus souvent. Ma santé s’affaiblit toujours, mais non mes besoins sexuels, ni, par suite, mon penchant à la masturbation. J’ai eu l’idée d’ajouter mes quelques faits et méfaits aux histoires d’Anamary del Miguel Saavedra en les envoyant à mon site-web préféré : SecretsInterdits, je me suis dit que peut-être quelques-uns des renseignements que je donnerais pourraient présenter un intérêt psychologique pour les internautes qui viennent sur SecretsInterdits. Je crois que ma vie sexuelle a été assez extraordinaire par son intensité. Elle le paraîtrait peut-être moins si nous possédions beaucoup d’autobiographies sexuelles complètes. Mais on a honte de parler de ces choses-là. Contrairement à l’opinion générale, les gens sont très cachottiers pour certaines choses. Mais j’ai une mémoire particulièrement tenace pour tout ce qui concerne les phénomènes érotiques, peut-être parce qu’ils m’ont toujours fortement intéressé et ma pensée revenait toujours aux souvenirs de ce genre. J’ai tâché d’être le plus exact possible et cela donne peut-être quelque valeur à mon récit.