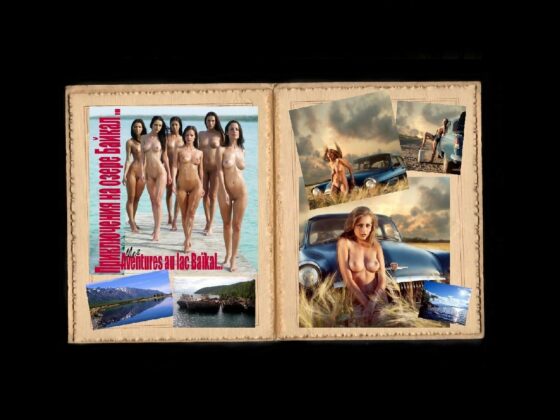Déviances utopiques de temporalité schyzophrénique abstraite des objets sexuels.
Les déviances utopiques de temporalité schyzophréniques abstraites par rapport aux objets sexuels tels que le vibromasseur, le gode, le plug et autres objets d’excitations…, est un exposé lumineux du professeur X…
Objet… D’où vient ce mot? L’objet, chez Lacan, a-t-il le même sens? Sans réflexion préalable, tout en lisant Lacan, on pense à l’objet sexuel au sens de «l’objet aimé» ou de «l’unique objet de mon ressentiment»; à moins qu’on ne l’assimile à l’objet des sciences dites «objectives», lesquelles posent l’objet sexuel en face, toujours en face; mais en face de quoi? Du sexe pardi ! Il serait opportun de reprendre quelques passages d’un texte de Johannes Lohmann («Le rapport de l’homme occidental au langage») qui démontre qu’il y a eu fracture dans l’évolution de la pensée, vers les XIIIe et XIVe siècles, fracture qui a permis aux sciences dites «objectives» de se développer, du fait de la séparation entre le sujet et l’objet. («Plus le Moi s’éprouve lui-même comme le point de départ de la pensée, plus le langage est objectivé»…
«Entre le subjectivisme radical des Temps Modernes, et la forme de pensée grecque originaire, se trouve une forme d’existence, dans laquelle la forme du langage devient un mode du comportement humain». J. Lohmann). L’objet, c’est d’abord ce qu’on rencontre. On est bien tranquille dans une nébuleuse narcissique… et on rencontre — par hasard, comme toujours, par exemple chez Quelqu’un ou dans un sex-shop — quelque chose d’excitant qu’on va appeler un «objet». C’est un «événement». L’objet, au sens traditionnel, c’est un mixte de cette rencontre (tugkanon) et du dicible (lekton). Il s’agit donc encore d’un objet «non objectivé». C’est l’objectivation – c’est-à-dire une sorte de coupure projetée – qui fait qu’il y a un «objet» distinct et qu’on va pouvoir l’étudier. L’objet s’oppose alors au «sujet» avant de le pénétrer.
La problématique de l’épistémê de l’objet de la psychanalyse est inséparable de la critique de la conscience en tant que centre de la connaissance. C’est tout le sens de l’avènement du désir inconscient; à tel point que chez Lacan, il y a une sorte de réduction de la notion d’objet à celle d’objet du désir. Il énonce que l’objet de la science analytique, «science conjecturale», c’est l’objet «a», l’objet du désir. Il y a là subversion de la position traditionnelle, mais cela suppose qu’on ait déjà promu le concept d’inconscient. Lacan proposait d’écrire le cogito de Descartes: «Je pense: donc je suis». Il s’agit du «donc» au sens de «ergo», non de «igitur». «Ergo» suppose que «je pense», mais ce n’est qu’une supposition. Guillaume d’Occam aurait pu dire que le «je suis» est de l’ordre de la «suppositio» d’un «je pense», lequel ne serait pas pris dans la parole, dans l’énoncé, et que ce qui reste «singulier», c’est «je suis». «Je pense» étant hypothétique…
Cette problématique restait donc en suspens jusqu’à la promotion de l’inconscient en tant que concept. Celui-ci permet de donner un lieu au «je pense» ou plutôt au «penser»: denken. (Pour Heidegger, le «penser» est un cheminement: «das Wegcharakter des Denkens», et parler de «la pensée» est une erreur.) Donc, si le désir est au niveau du «je pense» de Descartes – c’est-à-dire au niveau les -, tout le processus du désir suppose que l’objet est en rapport avec ce niveau les. L’objet du désir, c’est ce qui va «justifier» le désir. Dans son commentaire du Banquet, de Platon, Lacan précise les relations entre Socrate, Alcibiade et Agathon. Quand Alcibiade dit désirer «l’agalma» de Socrate, Socrate ne veut rien entendre. Il lui dit: «Mais tourne toi un peu, regarde Agathon, c’est lui que tu désires sans le savoir!»… Le bel Agathon, le beau parleur, le champion de la parole vide… Il y a «interprétation» de la part de Socrate vis à vis d’un sexe en érection.
Dès qu’on lie «l’objet» à la problématique du désir inconscient, il est évident qu’il n’a pas du tout le même statut que l’objet de la science expérimentale. Pour Lacan, l’objet de la pulsion, c’est l’objet du désir. Il n’y a qu’un seul objet, matriciel; il l’appelle objet «a». Il y a une loi générale de l’objet, mais cet objet va pouvoir se singulariser. La loi générale – ce qu’il reprend dans son analyse du Banquet – c’est que l’objet du désir est en corrélation avec le manque. Ce qui est en jeu ici peut apparaître dans une dimension apophatique: «Montrez-moi l’objet, montrez-moi ce sexe turgescent»… «Surtout pas!» Le montrer, ce serait le disqualifier dans son essence. «Cachez ce sein que je ne saurais voir!». Le sein, concrétisation singulière de l’objet «a».
Il est nécessaire de distinguer objet «a» et «phallus». Sur une courbe, convexe vers le haut, Lacan place les différentes occurrences de l’objet. Sur la branche ascendante, l’objet oral puis l’objet anal. A l’inflexion, le phallus, en précisant bien que ce n’est pas un objet; le phallus, agent de passage, de réversion, etc. Sur cette courbe, les correspondances. En face de l’objet anal, on trouve sur la branche descendante l’objet scopique, c’est-à-dire le «regard». En face de l’objet oral, la «voix». Lacan concrétise donc une série d’objets. Ceci implique une critique de la théorie des stades: stade oral, stade anal, stade phallique…, laquelle a provoqué une sorte de régression logique par rapport à ce que Freud apportait. Ce qui peut apparaître le plus typique, le plus original dans la position de Lacan, c’est cette promotion du regard au rang de l’objet; mais, à mon avis, le plus spécifique de sa pensée est moins ce statut du regard que celui qu’il accorde à la voix. C’est le fait de considérer la voix comme «objet» qui va lui permettre d’introduire la distinction entre «incorporation» (l’objet oral) et «introjection» (la voix), mais aussi entre Imaginaire et Symbolique.
En effet, l’entrée dans l’Imaginaire se fait par le registre scopique, alors que l’entrée dans le Symbolique se fait par la voix. Ce qui s’accorde avec ce qu’écrivait Freud dans les lettres à Fliess en 1894, à propos de la distinction entre les hallucinations visuelles et les hallucinations auditives. Il faudrait reprendre aussi ce thème tel qu’il apparaît dans les travaux de la phénoménologie, ceux de Zutt entre autres (à ne pas confondre avec “zut”). A ce sujet, il me semble qu’il y a une certaine confusion dans l’Ecole kleinienne (ne pas confondre avec l’école clitoridienne) du fait de la non-distinction entre l’objet oral et la voix, entre l’incorporation et l’introjection. L’incorporation du psychotique n’est pas du même ordre que l’incorporation de Quelqu’un qui n’est pas psychotique (je peux en témoigner). Et c’est peut-être un des apports les plus importants de G. Panko’w que de préciser cette distinction. Gisela Pankow dit que, chez les schizophrènes, il y a un défaut «d’incarnation».
Le problème de l’incarnation est en rapport avec l’incorporation (que, quelquefois, j’ai appelée «l’encorporation», la «fabrication» du corps) qui ne peut se faire que dans un système où déjà le désir est là; mais ce qui est «encorporé» reste lié à la sphère de l’oralité; incorporation «cannibalique», comme le dit Freud, première identification, du registre de l’être. Identification à l’espèce, à la station verticale, à l’érection du verbe incarné, le père primordial. Cette identification est bien distincte de la seconde, laquelle est de l’ordre de l’introjection du «trait unaire» (einziger Zug), marque de la distinctivité du sujet. L’introjection, c’est l’entrée dans le Symbolique. Mais quand on parle de première et de seconde identification, ça ne veut pas dire que l’une se situe chronologiquement avant l’autre. Mais peut-on vraiment parler «d’objet oral»? Il s’agit plutôt d’un «pré-objet».
L’objet véritablement constitué dans son statut logique n’apparaît qu’au stade anal, c’est-à-dire au moment où s’instaure pour le sujet la possibilité d’assumer le détachement, la séparation de l’objet, ce qui permet qu’il soit vécu «hors corps». Tandis que dans le «stade» oral, «l’objet» lui-même (pré-objet) fait partie du corps. Il n’y a aperception de l’objet comme distinct qu’au moment où celui-ci peut apparaître comme détaché, par l’intermédiaire du «voir»: voir l’autre dans sa totalité. C’est seulement à ce moment qu’il y a une aperception de l’objet, en ce que le sein, qui faisait jusque-là partie du sujet, se détache. Mais l’enfant ne pourra avoir la maîtrise de cette séparation qu’au stade anal, et c’est donc seulement à partir de là qu’on pourra parler d’objet proprement dit.
Lacan précise que la problématique de l’objet est toujours prise dans une forme d’aliénation où intervient le rapport à l’Autre: la demande. L’objet oral se situe toujours dans une dimension de dépendance, de demande: demander «à l’Autre». Tandis qu’au stade anal, c’est l’Autre qui demande… Et c’est à ce moment-là que l’on peut s’affirmer, en disant «non». L’objet se constitue du fait de la négation de la demande de l’Autre.
Approximativement, on peut dire que c’est une défaillance de la fonction de l’objet «a» qui conditionne l’hallucination («perception sans objet», dit-on) du fait que c’est le «a» qui permet la coupure entre «intérieur» et «extérieur». C’est lui qui va être le gardien, triant, séparant l’intérieur de l’extérieur, en sachant bien que «l’intérieur» reste une notion ontiquement vague. C’est en ce sens que Lacan utilise une autre image pour situer l’objet «a»: il dit que l’objet «a» est comme une espèce de clapet, une pulsation entre l’inconscient et la réalité. S’il n’y a pas d’objet «a», ne pourra pas se constituer «d’étoffe» qui tienne le coup, tissée de fantasmes. Quel est le prototype archaïque de l’objet «a»?
Lacan reprend en ce sens la problématique de l’objet transitionnel de Winnicott. Le «champ transitionnel» implique la notion de zone «frontière», de limite, de coupure, de point de «symbiose-séparation». Mais à un niveau encore plus archaïque, le premier «objet», c’est le placenta: l’entre-deux coupures, entre le décollement du placenta et la coupure du cordon. Le placenta, objet mythique, d’où les rituels qu’il suscita dans les sociétés dites «primitives». C’est parce qu’il est un support: bien qu’il soit hors corps, il est lié à l’enfant qui vient de naître. L’objet transitionnel serait une sorte de rêverie de placenta qui reste flottante, et va ensuite se concrétiser dans l’objet «a». Le passage du placenta à l’objet «a», c’est le «pas au-delà» (Blanchot)! Dans l’objet «a», il y a toujours une dimension nostalgique. Et l’objet transitionnel, comme le souligne Winnicott, ce n’est surtout pas un fétiche; il n’est même pas pris dans un réseau de souvenirs, mais il est toujours là; c’est ce qui donne le style de la personnalité…
Ces caractères de l’objet transitionnel pourraient être évoqués à propos de l’objet «a». Mais le «a» ne se manifeste que dans le fantasme, par son articulation avec le sujet $.L’objet «a», c’est ce qui «reste» (par exemple, d’une rencontre). On pourrait parler ici d’un «en plus». Ceci se rapproche de la façon dont Lacan définit l’objet «a»: «plus-de-jouir». Il est en effet cause du désir, lui-même articulé avec la jouissance; mais l’objet «a» est hors-jouissance. C’est parce qu’il est hors jouissance que c’est du négatif qui devient du «pins de jouir»… Je dis ceci pour préciser ce que j’entends par «l’objet a, c’est ce qui reste». On est en train de converser poliment avec Quelqu’un (je peux en témoigner), et quand on se retrouve seul, on peut se dire: «Quel emmerdeur!» ou bien: «Quel moment agréable!», et on reste fasciné, pris dans le «regard» de l’Autre. De même à propos de la voix, etc.
L’objet «a» est «hors jouissance», mais la jouissance, elle, est dans la rencontre. Et quelque chose va typifier ce mode de jouissance, sous forme d’un «sentiment», d’un «Einfühlung». A rapprocher ce phénomène de ce que Rümke désigne comme «Praecox Gehfühl» (il vaut mieux ne pas traduire cette expression) et de ce que Lacan appelle «l’instant de voir». Nous pourrions proposer aussi «l’instant de sentir», au sens pathique du terme: sensibilité pathique, immédiate, au style de celui qui se présente; une certaine qualité spécifique de son mode de présence… Ce qui permet de faire un diagnostic avant tout repérage de symptômes. Devant toute personne non schizophrène on a le sentiment d’une certaine unicité, d’un faisceau de lignes virtuelles qui convergent en un point, lequel peut être dit «point de rassemblement».
Ce sentiment de «rassemblement» n’existe pas quand on se trouve devant un schizophrène. Dissociation, éclatement, dispersion des lignes de fuite, symptomatologie basale de la personnalité schizophrénique. Le «point de rassemblement» est un nœud, plus ou moins serré, qui permet qu’il y ait objet «a». L’objet «a» est alors comme un sceau, un cachet de cire qui estampille quelque chose; preuve qu’il y a rassemblement. Nous pouvons supposer que le Praecox Gefühl est le sentiment pathique de la présence ou de l’absence du point de rassemblement. Mais il ne faut pas confondre la dissociation avec la simple distraction: celle-ci n’altère pas la qualité d’unicité de la présence. Il en résulte que le diagnostic peut se faire par l’aperception de la présence – ou de la non-présence – de l’objet «a».
Notons bien que l’objet «a» est en corrélation avec «l’introjection», «le trait unaire». On peut rapprocher, dans une quasi-équivalence, l’objet «a», le «trait unaire» et la «coupure», mais aussi la barre du $. L’objet «a», objet du désir, réactive le fantasme, fantasme dont il est lui-même partie constituante ($ ? a). La vraie rencontre, celle qui va, dans sa contingence, creuser un sillon dans le Réel, peut provoquer un «fading» du sujet ($), dans un contexte d’angoisse, voire d’évanouissement. L’objet «a», c’est ce qui donne du poids, du lest au fantasme. Il est le corrélat de l’unicité, du rassemblement, et d’une délimitation. Pour qu’il y ait délimitation d’une surface, il faut qu’il y ait un point en dehors de cette surface. Pour qu’il y ait structure, il faut un point défini hors de cette structure. Dans ses premières formulations, Lacan disait que le «a» est «l’enforme» du «A», sa «mise en scène»… Par contre, dans l’état maniaque, l’objet «a» a perdu sa fonction de lest, de poids; d’où cette impression de flottement, de «fuite des idées», etc.
Insistons sur le fait qu’il y a une quasi-impossibilité d’avoir un accès direct à l’objet «a». L’objet «a» ne fonctionne «qu’enveloppé» dans un écrin… D’où l’allusion de Lacan à «l’agalma» dans son commentaire du «Banquet». L’agalma, silène sculpté, à quoi Alcibiade compare Socrate, silène qui peut s’ouvrir, montrant des Divinités en or. Préserver et présenter ce que cache cette enveloppe sans laquelle le «présent» perd de son attrait. Ce qui enveloppe l’objet «a», c’est l’image spéculaire, i(a). Pourquoi tant de précautions? C’est que l’objet «a» vient colmater une faille (double sens intentionnel). Cette couche imaginaire, i(a), enveloppe l’objet «a», qui lui-même colmate la menace permanente de la castration. Superposition d’enveloppes: i(a) «a», – j. Quand l’autre se présente, c’est à cet ensemble composite qu’on a affaire, c’est lui qui donne un certain relief à la rencontre: un avènement stratifié… Car il y a toujours un risque dans la rencontre, un risque mortel parfois.
L’objet «a», «pathos de la coupure», suppose le passage par la castration. C’est en ce sens que l’objet «a» est le corrélat de la séparation; il assume une fonction spécifique, bien précise; c’est pour mieux délimiter son statut logique qu’il me semble important de signaler que la notion «d’objet partiel» prête à confusion. C’est Karl Abraham qui aurait introduit cette notion, mais en réalité, il y a un malentendu (du fait de la traduction?): ce n’est pas l’objet qui est partiel, mais l’amour; il s’agit en fait «d’objet de l’amour partiel». On a beaucoup trop usé de ce soi-disant objet partiel. Par exemple, chez les psychotiques, là où il s’agit de multiréférentiabilité, d’investissements partiels, ce sont bien ces investissements qui sont partiels, non les objets.
En fin de compte, quand on parle de «relation objectale», le terme «objectal» vient là surtout pour marquer qu’il ne s’agit pas d’une relation «objective», d’une forme d’objectivation. «Objectal» suppose que la relation est liée au désir, donc à l’inconscient. Par exemple, il y a une confusion, dans le comportementalisme, entre objectivité et objectalité. L’objectivité: «Voilà, tu n’as qu’à t’installer, prendre un appartement, trouver un travail… » et c’est vrai, objectivement, c’est quand même plus confortable. Il peut se faire que cela entraîne des modifications objectales, mais on ne peut pas vraiment parler d’une thérapeutique. «L’aménagement» (au sens de Winnicott et de Masud Khan) tient compte directement de l’objectalité. C’est très différent; «l’aménagement», ce n’est pas simplement chercher du travail. Bien sûr, c’est de l’objectif, mais à l’intérieur d’un «projet» objectal.
Il faudrait reprendre ici les différentes acceptions: objectivité, objectalité, objectité, et les variations sur «l’objet» (au sens de Francis Ponge et d’Henri Maldiney: «Le legs des choses dans l’œuvre de Francis Ponge». Henri Maldiney).A l’arrière-plan de ces notions, il y a toujours des options «philosophiques». A titre d’exemple, citons la critique de la position de Hegel par Francis Ponge… Mais bien que Francis Ponge veuille se démarquer de Hegel, c’est étonnant, dit H. Maldiney, quand on compare des extraits de la Phénoménologie de l’Esprit et des textes de Francis Ponge, de constater combien ils se ressemblent – jusqu’à un certain point – précisément au point où F. Ponge reprend à son compte, sans le savoir, la critique de Hegel par Heidegger.
Heidegger souligne l’importance d’un remaniement de la logique depuis la fin du XIIIème siècle et du début du XIVème par, entre autres, Duns Scot, Guillaume d’Occam, Maître Eckhart… Et, par la suite, la révolution luthérienne, le cartésianisme, jusqu’à Kant… Le néo-positivisme, influencé par le néo-kantisme de la fin du XIXème siècle, aboutit à des positions extrêmes, comme celles vis-à-vis des sciences dites «expérimentales», ce qui entraîne une certaine naïveté qu’on retrouve, à mon avis, dans «l’empiriocriticisme» de Lénine…Dans cette longue histoire, il me semble intéressant de situer schématiquement l’étape représentée par la thématisation de Leibniz, en particulier à partir de ce qu’il nomme la «logique de variations».
PS ; maintenant, lorsque vous serez mis en présence d’un objet sexuel, vous ne le verrez-plus de la même façon (vous ne l’utiliserez-plus sans penser à cet article…)
Comment peut-on se représenter l’objet dans une logique de variations où il n’y a pas de vide, où il n’y a pas possibilité de spatialiser l’objet d’une façon précise? Sous le terme «d’objectif» proposé par Gilles Deleuze («Le pli. Leibniz et le Baroque»), Leibniz considère l’objet comme une fonctionnalité pure: l’objet est pris dans une logique de variations continues, série de «décimations» possibles. On pourrait l’imaginer comme une surface à courbure variable, pressentiment d’une nouvelle topologie. Mais alors, qu’est-ce que Leibniz entend par «sujet»?
Supposons une courbe qui présente deux concavités. Si, en chaque point de la courbe, on élève une perpendiculaire à la tangente (dont la pente est donc variable), on va définir une zone qu’on appelle «le foyer» (comme dans un miroir concave). La question se pose de repérer en quel point de la courbe le concave devient convexe. C’est un indiscernable (logique des indiscernables). Il y a alors un autre foyer, mais qui, logiquement, est le même que le premier. Ce foyer, Leibniz l’appelle: «le point de vue». Ce «point de vue» est la place du sujet …. Et l’objet? Leibniz reste dans la tradition médiévale qui distingue sujet et objet (mais également Lacan qui distingue $ et «a», le sujet et l’objet, sans tomber dans la «naïveté» de Sartre qui, dans L’Etre et le Néant, maintenait la pleine opposition entre le sujet et l’objet). «L’objectil» suppose une «série de décimations possible», et ce qui est en question dans cette opération, c’est la «transformation» du visible en lisible (C’est le problème du «livre», le «Livre» de Mallarmé par exemple, ou la façon dont on peut se représenter l’espace de Riemann: un espace feuilleté). Comment va donc s’inscrire le visible?…
Tout à l’heure, je lisais au hasard, un petit livre d’Henri Michaux: Passages. Il dit: c’est fatigant, décevant de lire car on est obligé de suivre une ligne jusqu’au bout; on n’est pas vraiment libre. Tandis qu’un tableau, c’est autre chose, on fait ce qu’on veut! On peut le regarder, s’attarder sur un petit détail; une errance est possible sans être obligé de suivre un itinéraire. C’est donc la démarche inverse! Il semble bien plus attiré par le visible que par l’écriture; c’est pour ça qu’il a tant écrit!… Bien qu’il y ait de petits dessins, des traces, pour essayer de récupérer le visible.Le passage du visible au lisible est un travail: le travail monadique. La «monade» de Leibniz (terme qu’il reprend de Malebranche) est tapissée de «plis» et de replis. Le «livre» est dans la monade, non dans le monde. Dans le monde, il y a des inflexions, des surfaces courbes; la monade est constituée d’inclusions d’inflexions qui forment les plis (Zwiefalten)…L’objectal «est inséparable des différentes strates qui se dilatent comme autant d’occasions de détours et de replis»; possibilités de greffes «d’incorporels», au sens stoïcien du terme: les événements.
Y aurait-il corrélation entre l’objet «a» et l’objectal? Quelque chose qui ne se fixe pas dans une essence, surface à courbure variable, occasion de détours impliquant la rencontre? Ce qui fait événement, c’est la présence de l’objet «a»; l’événement va «allumer» quelque chose au niveau du fantasme. Une vraie rencontre va s’inscrire dans le Réel, pourra infléchir l’assise fantasmatique, et peut-être la «présentation», la Darstellung, le style. L’objet serait un «mixte» entre le tugkanon et le lekton, le hasard et le dicible. Et Leibniz précise qu’il y a un premier et un deuxième moment de l’objet: «Le premier moment de l’objet, c’est l’objet comme perçu ou le monde comme exprimé». C’est ce qu’il appelle «singularité d’inflexion». Pour le second il ne s’agit pas d’expression mais de contenu, ce qu’il appelle «singularité d’extremum». Maximum et minimum, définissant ainsi une logique de «l’extremum», dont une corrélation est la délimitation.
Lacan dit que l’objet «a» est «l’enforme du A» (sorte de Gestaltung?) Il est la «mise en scène» du A. On pourrait supposer qu’il s’agit du passage du monde à la monade, c’est-à-dire au sujet, c’est-à-dire au théâtre intérieur. Comment le monde va-t-il «se représenter»? Par le biais de l’objet du désir: indispensable pour qu’il y ait inscription. Le «vinculum», c’est ce qui permet de se lier et de s’inscrire dans les feuillets, dans les strates. Nous sommes alors au niveau de l’objectalité. Il ne s’agit pas de l’objet de la science expérimentale. Dans cette perspective, Deleuze fait la comparaison avec «l’objet technologique», qui n’est que «la fluctuation de la norme»… «La fluctuation de la norme remplace la permanence d’une loi… L’objet prend place dans un continuum par variation» (G. Deleuze). Par exemple, les parapluies en papier: si vous voulez aller à une soirée et qu’il pleut, vous pourrez acheter votre parapluie, même dans un taxi, et vous le jetterez après… Un parapluie en papier, c’est un objet technologique. On voit bien qu’il y a de moins en moins de stabilité, le continuum par variations se substituant à la permanence de la loi.
Mais, pour en revenir au problème de «l’objet» chez Freud, il est peut-être utile de le confronter avec les théories de l’intentionnalité. On a fait grand cas du fait que Freud a suivi, avec Husserl, les cours de Brentano. Mais ça ne semble pas l’avoir beaucoup marqué, bien que ça l’ait peut-être orienté vers une espèce de philosophie un peu abstraite dans laquelle la position de l’objet est contaminée par l’intentionnalité. C’est donc d’autant plus important de tenir compte, ne serait-ce que partiellement, de la position critique de Heidegger. Maldiney, dans son commentaire sur Francis Ponge, s’appuie en particulier sur deux textes fondamentaux de Heidegger: «Das Ding» («la Chose») et «Vohnen, bauen, denken» («Habiter, bâtir, penser»). On peut trouver un très bon commentaire de «das Ding», à propos du «Geviert» (Uniquadrité), dans Jean Beaufret.Ce qui est en question dans l’émergence de l’objet «a» (ou de l’objectal) est déjà au cour des réflexions de Freud autour de das Ding.
La problématique de das Ding reste, chez Hegel, dans un certain degré d’abstraction; tandis que chez Heidegger (et c’est en cela que Heidegger aide à mieux comprendre Francis Ponge), il y a, à ce niveau, quelque chose de l’ordre de l’opacité, de l’épaisseur, ce qui situe «la Chose» dans le registre du pathique, c’est-à-dire du pré-prédicatif et du pré-intentionnel. Ce qui reste dominant, dans la problématique de l’objet suivant Lacan, c’est qu’il y entre une réflexion sur l’émergence. Il s’agit de l’émergence au sens de Heidegger: «Unverborgenheit», que je définis depuis longtemps comme «paraître du retrait». On trouve en particulier cette préoccupation sur «das Ding» chez Lacan, dans la première partie du Séminaire sur l’Ethique dans laquelle il commente «l’Entwurf».Un autre problème essentiel pour la pratique clinique, c’est la question, soulevée par Heidegger, de la différence ontologique, c’est-à-dire la différence entre l’ontologique et l’ontique (la psychanalyse n’aurait été possible qu’à partir de cette différence ontologique, laquelle n’existait pas dans la philosophie grecque).
On pourrait reprendre ici un autre texte de Heidegger: «Moira», qui tourne autour de la problématique du destin. Heidegger y donne une très grande importance à la notion de «pli»: le pli entre l’être et l’étant. Si on reste au niveau de l’étant, tout se perd dans l’infini. De même dans le domaine de l’être. Or, ce qui permet la «prise» (dans tous les sens du terme «prise»: être pris dedans, mais aussi saisir, «prendre», au sens de Begriff) c’est le pli. L’objet «a» est de l’ordre du pli, de la pliure… Quand Heidegger parle de «Moira», du destin, il dit que le destin, c’est le pli du pli, un redoublement du pli (Zwiefalt).Lacan dit que l’objet «a» n’est pas spécularisable, qu’il n’est pas dans le grand Autre. Cela met en question la notion très complexe de limite.
A ce niveau de la limite se joue quelque chose qui est central pour la problématique de l’existence. Comment traiter la limite? L’objet «a», l’objet du désir tient compte du grand Autre, mais en même temps de l’existence. L’objet «a» joue le rôle d’une sorte de sas, de clapet, au niveau du grand Autre.Si l’objectalité est du côté de ce «pli» entre l’être et l’étant, l’objectité est un concept qui risque toujours de glisser vers l’ontologie. Quand Lacan dit: «L’ontologie, c’est honteux», il s’agit d’une prise de position par rapport à ce qu’en dit Hegel: «L’ontologie, c’est l’infini», et à ce que cette assertion suppose de glissement vers un pseudo-universel. A la limite, on pourrait dire que l’ontologie est du côté de ce que Peirce appelle «le général», qui est cependant nécessaire pour donner forme, pour établir un cadre à l’intérieur duquel pourra (peut-être!) se manifester quelque chose de bien plus singulier, qui se trouve ainsi pris dans une sorte de syntaxe… On pourrait dire, de façon imagée, que ce cadre est comme une prosodie de l’existence du sujet, de l’objet «a», ce par quoi le désir peut se manifester.
Il me semble nécessaire de reprendre un peu ces «arrières» pour éviter de faire glisser l’objectal vers l’objectité – qui est un abstrait quasi-ontologique – ou vers l’objectivité -qui serait simplement un constat de l’empirisme – et pour garder la spécificité de l’objet «a». Ce qui sera l’objet «a» – et Lacan y insiste aussi beaucoup – est là depuis toujours. Il ne va devenir objet «a» proprement dit qu’à partir du moment où il est pris dans une prosodie, marquée par «le pathos de la coupure». L’objet «a» comme tel implique la coupure; à tel point qu’on pourrait dire: l’objet «a», c’est la coupure. La coupure, c’est sur le plan logique, une sorte de matriciel de surfaces. D’où la phrase de Lacan: «L’objet «a», c’est la mise en scène du A». Une coupure fait donc délimitation, elle détermine une scène (dans les psychoses, il y a une difficulté, sinon une impossibilité de délimitation d’une scène). L’objet «a» est pris dans ce qui est déjà là: dans le corps; le corps, non pas au sens de Körper, mais au sens de Leib, c’est-à-dire non pas le «corps porteur» mais le «corps que je suis». D’où la référence de Lacan au «Marchand de Venise» de Shakespeare: une livre de chair prélevée au plus près du cour, comme garantie, comme gage, comme enjeu.
On retrouve ce caractère d’enjeu dans le commentaire de Lacan, dans son séminaire: «La logique du fantasme», sur le pari de Pascal: la dimension d’enjeu de l’objet «a».Pour s’approcher de ce qu’il en est de l’objet «a», il faut donc dissiper les illusions de la logique sérielle, linéaire. Il faut repartir au niveau de la problématique des pulsions («Trieben»): la poussée («Drang»), la source («Quelle»), le but («Ziehl») et l’objet («Objekt»). Il existe une sorte d’intoxication logique par l’intentionnalité qui pourrait faire croire que c’est l’objet qui est au bout de la course. Or, c’est le «Ziehl», le but… Ce qui fait que l’objet peut aussi bien être la cause. D’où la formule de Lacan: l’objet «a» est cause et objet du désir. L’objet ne prend pas la teinte de l’existence, mais il en donne le style. Il est intéressant de rappeler la représentation, de Lacan, du circuit pulsionnel: la pulsion sorte de boucle qui se referme sur un bord, le bord étant la source (Quelle). Quand la boucle s’écrase sur le bord, qu’il n’y a plus d’espace pour l’objet, et qu’il n’y a même plus de boucle, c’est l’image de l’auto-érotisme; une bouche qui se baise elle-même. Dans ce cas, il n’y a plus d’objet «a»; l’objet «a» est en effet ce qui maintient la Spannung, la tension pulsionnelle, ce qui empêche la pulsion de s’affaisser. Mais on ne peut pas imager le pulsionnel simplement par une boucle; il y a une relation complexe entre ces quatre éléments de la pulsion: la source, la poussée, le but et l’objet.
En fait, la pulsion est proche du domaine de la demande; la demande et le désir ne sont pas du même ordre. Ce qui compte, au niveau pulsionnel, c’est le but, la satisfaction. Dans la demande, il s’agit d’atteindre au plus vite le but: la satisfaction, et même de façon illusoire. Alors qu’au niveau du désir, il n’y a même pas de but. La demande crée une sorte de pseudo-temporalité, ne serait-ce qu’à travers son propre énoncé qui est toujours, en dernière analyse, formulé dans le mode appellatif. Mais y répondre ne met pas en question l’objet du désir. Justement, le piège, c’est de croire que la réponse à la demande est l’objet du désir. Bien au contraire, répondre à la demande étouffe le désir. La demande, c’est une procédure pseudo-temporelle greffée sur quelque chose de quasi-intemporel: le désir. Dans la société, il y a une surcharge écrasante d’objets de consommation, c’est-à-dire «d’objets» de demande, qui étouffe complètement la problématique du désir et de son objet. Heidegger, dans ses derniers séminaires, faisait une critique du «Dasein». Et, en même temps, il essayait de cerner la notion «d’Ersatz». Il semble que dans la société de consommation (mais aussi dans une psychothérapie insuffisamment rigoureuse) ce qui tient lieu d’objet «a» est quelque chose de l’ordre de l’Ersatz.
Bien sûr, ce qui est dominant dans la relation consommatoire, étatique, banale, c’est une prévalence au niveau de la demande; non seulement il s’agit de satisfaire la demande, comme on dit dans le commerce, mais surtout de la susciter. Il y a une énorme confusion entre besoin, demande et désir, souvent d’ailleurs en interprétant Marx de travers; d’où la réaction, à la fin du XIXème siècle, de tous ces courants qui prétendaient suppléer à la théorie de Marx, en particulier ceux qu’on a appelé «marginalistes» (notions d’écart, de désirabilité, de désirance, d’ophélimité) (Jean-Joseph Goux: «Calcul des jouissances». «Critique». Octobre 1976). Certains contemporains semblent même avoir régressé de cent ans en reprenant ce vieux thème selon lequel ce qui ferait la loi de la production, ce serait le désir. Mais il ne s’agit même pas du désir; ce serait plutôt quelque chose d’apparenté au «besoin», non pas au sens de besoins qui seraient «déterminés par la nature», mais au sens des «besoins soi-disant nécessaires»; c’est-à-dire de ceux qui «dépendent du degré de civilisation d’un pays», mais aussi «des habitudes et des exigences particulières de chaque classe de travailleurs».
Donc, «un besoin» qui est en réalité une demande, laquelle est présentée comme désir.Mais, pour mieux mettre en relief ce dont il s’agit, il faudrait parler de la jouissance. Et en particulier à propos de ce qu’on évoquait sur ta société de consommation: de la jouissance de l’objet, du droit à la jouissance de l’objet, qui devient parfois un devoir. C’est frappant, dans certaines publicités: «Le disque que vous devez absolument avoir!» ou: «Si vous n’achetez pas la lessive Machin, c’est que vous ne voulez pas que votre mari ait des chemises propres… Si vous n’achetez pas les couches Truc, vous êtes une mère qui ne mérite pas de l’être parce que vous ne voulez pas que votre bébé ait les fesses au sec»… On vous indique quel objet vous devez vouloir…
Tout ceci sert à masquer le désir. Et c’est apparemment bien plus confortable! La problématique de l’accès au désir est très bien développée par Lacan dans son article: «Subversion du sujet et dialectique du désir». Le désir est là, avant et après la demande. Pourtant, paradoxalement, il n’y a d’accès au désir que par la demande, mais à certaines conditions… Parce que la demande, c’est ce qu’il y a de plus socialisé. C’est d’ailleurs ce que dit Marx: il n’y a pas de besoins qui ne soient pas travaillés par le socius. Et un besoin qui est travaillé par le socius, c’est une «demande»: dire «j’ai faim», ça s’agrémente toujours, de façon plus ou moins consciente, d’une assiette, d’une fourchette, d’un bifteck, de pain… Il n’y a pas de «besoin» en soi, du fait même (et c’est sa particularité) que l’être humain est un «parlêtre». La demande n’existe qu’au niveau du «parlêtre».
Bien sûr, le chien, le chat, quand ils entendent le cliquetis de la vaisselle, se précipitent et ils sont là. à japper, pour avoir à manger… Mais est-ce que c’est bien une demande? Je crois qu’il faut avoir le courage de dire non; ou peut-être de dire: c’est peut-être une forme de demande, du fait qu’ils sont pris eux-mêmes dans le grand Autre… Ce sont des sortes de code qui s’instaurent, là, presque sous forme d’imprégnation (Pragung), de réflexes conditionnés, mais qui sont simplement des manifestations de l’ordonnancement des signifiants auxquels ils sont sensibles, mais en tant que signaux. Mais nous fonctionnons, nous aussi, en partie comme ça. L’odeur du bifteck frites, quand nous passons dans une rue et que nous avons faim, fait que nous allons dire, au restaurant: «Donnez-moi un bifteck frites»…Pour qu’apparaisse ce qui a toujours été là, et qui est, comme le dit Freud à la fin de la Traumdeutung: le désir impérissable, qui passe à travers tous les avatars, mais qui reste masqué, et souvent étouffé, il faut avoir épuisé la demande, ce qui est corrélatif d’une problématique de la castration.
Mais c’est au niveau de la demande que nous pouvons déchiffrer la problématique du don, au sens de Marcel Mauss: les prestations, les contreprestations, ce qui fait la trame de la civilisation… Monsieur X, un patient hospitalisé qui est entré tout à l’heure dans le bureau pour me demander un petit cigare, m’a bien spécifié: «Moi je te ramène un cadeau quand je vais à Paris, tu peux bien me donner un cigare!s. Mais la demande du cigare, c’est aussi une façon de mettre en question son désir, être reconnu. Donc, il ne s’agit pas simplement de donner un cigare! Il faut que ce don soit accompagné de tout un cérémonial. Mettre un distributeur, ça ne marcherait pas. Ce qui compte, c’est bien plus le fait de me rendre visite, de dire «Alors, ça va bien! Et qu’est-ce que tu deviens?» ou la variante de X: «Alors ça va? Tu n’es pas encore mort?» – «Tu veux un cigare?»; et le cigare ne vient là que comme élément du cérémonial.
Le cérémonial, c’est une façon de civiliser la demande. Et c’est à partir de là – si c’est bien conduit – que peut émerger quelque chose de l’ordre du sujet. Il s’agit donc bien de quelque chose de l’être reconnu en tant qu’existant, à savoir que l’on compte, que l’on compte pour… Pour passer à ce stade, il faut donc travailler cette thématique du don, il faut essayer de s’en désengager, le don étant pris dans un système régressif, sociétaire… Georges Politzer, en parlant de la société de consommation capitaliste, disait que l’on est dans un système «anal»… Toute l’organisation des prestations, contre-prestations et le cérémonial (tout ce qui fait la civilisation) comme le dit bien M. Mauss dans «L’Essai sur le don», reposent sur «le contrat», c’est-à-dire à un niveau de mise en place de toute une armature, de toute une structure où peut s’effectuer un certain choix dans les signifiants afin d’organiser les choses; et c’est seulement à partir de là qu’on peut avoir accès à quelque chose de l’ordre du désir, avec toujours le risque de l’étouffer.
Dans «Psychologie collective et analyse du moi», Freud parle de deux sortes d’amour, l’amour par identification narcissique et l’amour objectal: le premier étant ce qu’on voudrait être (en l’incorporant, en le bouffant, en essayant de prendre la place de l’autre), le second comme ce qu’on voudrait avoir. La problématique de l’objet (ce qu’on voudrait avoir) met donc en relief l’opposition de l’être et de l’avoir. C’est à partir de ça que Lacan définit le phallus (4) et la castration. La castration, c’est justement la barre qu’il y a entre l’être et l’avoir. Ceci peut se rapprocher de la façon dont Maldiney présente «das Ding». Il le reprend à partir d’une réflexion sur l’expression «Il y a»…
La place de la chose, c’est-à-dire quasiment l’inaccessible, c’est le «y» de «il y a», dit-il. On retrouve là la notion de pli. La place du désir, ce serait la jointure, le pli entre l’être et l’avoir. Mais dans l’objet «a», il ne s’agit pas de l’être ni de l’avoir. Dans ce que Lacan appelle, à propos de l’interprétation, le «désêtre», il s’agit de cette position de l’analyste, où – d’une façon fugitive, l’instant de voir – l’analyste, dans le désêtre, va «incarner l’objet «a». Ce serait une erreur de dire qu’il «est» l’objet «a». Ça se situe davantage comme une fantasmagorie, mais efficace, une sorte de «jeu» où l’objet «a» se montre comme détaché. Une des caractéristiques essentielles de l’objet «a», c’est en effet d’être détaché. C’est en ce sens que je reprenais tout à l’heure le «Marchand de Venise»: un morceau pris au niveau du corps, mais détaché; d’où le rapport de «a» et de la coupure. Dans l’interprétation du transfert, l’objet «a» joue un rôle primordial.
Quand l’analyste, par désubjectivation, par désêtre, se trouve, juste le temps d’un éclair, à cette place de l’objet «a», à ce moment là, ça déclenche une sorte de «fading» du sujet, et apparaît alors une possibilité d’articulation. Pour qu’il y ait articulation, pour qu’il y ait fantasme, il faut qu’il y ait eu détachement. On ne peut articuler que ce qui est détaché; sinon, on reste pris dans une sorte de magma. C’est justement ce qui fait la difficulté de soutenir le désir. Il ne peut survenir que par détachement. Il faudrait reprendre le terme «détachement»… («Détachement», c’est le titre d’un petit livre de Michel Serres; et ce n’est pas un hasard si, dans ce livre, il parle de son enfance, de son histoire personnelle.)Le détachement, ce n’est pas la séparation. C’est un mécanisme beaucoup plus archaïque: détachement de l’objet «a», qui ne fait plus alors partie, ni du corps, ni du grand Autre, ni du sujet. C’est pour cette raison qu’il peut être «cause».
Une «cause» ne doit pas être prise dans le processus. C’est ce qui est là, avant; et après, c’est ce qui aura servi à… Et l’objet «a», c’est ce qui va permettre au désir de se manifester; et ce qui sert à se manifester, c’est bien quelque chose de l’ordre de la cause… Encore faut-il savoir ce qu’on entend par «cause»; il ne s’agit pas de tomber dans une pensée causaliste, d’un niveau logique rudimentaire: «Voici la cause et voici l’effet»… Il y a belle lurette que, même en physique, on a dépassé ce stade archaïque. L’objet «a», de par sa double fonction d’objet et de cause, remet radicalement en question cette tendance toujours actuelle de considérer l’objet comme objet de possession, objet de maîtrise, objet à conquérir, objet à demander, à recevoir, etc. Il faudrait refaire, à partir de là, un statut épistémologique de l’objet. C’est ce que Lacan a tenté d’élaborer, et c’est ce que j’essaie de reprendre ici.Il y a une phrase que je répète à chaque occasion: «Quiconque parlera du transfert sans parler de l’objet «a» … » (Je ne dis d’ailleurs jamais ce qui va lui arriver comme châtiment…) On pourrait peut-être dire à l’inverse qu’on ne peut pas parler de l’objet «a» sans évoquer le transfert. Ce n’est pas vraiment réciproque, mais il faut forcément dire quelque chose du transfert si on parle de l’objet «a».
En fait, j’ai déjà fait allusion au transfert à propos de la castration, de l’identification, de l’être et de l’avoir, de la demande… D’une façon aphoristique et pragmatique, on peut dire que le transfert, c’est l’interprétation; à la limite, c’est le désir. On peut même préciser: c’est le désir de l’analyste, c’est ce qui reste là, contre vents et marées. Mais sur un plan logique, on peut se demander ce qui fait qu’il y a objet «a», un objet «a» qui était déjà là sans être manifeste. C’est ici que Lacan a recours à la figure topologique du cross-cap (ou «plan projectif», ou «bonnet croisé»). Par une certaine coupure, celle du «huit inversé», figure de la réversion, le cross-cap change de configuration topologique; cette coupure tourne autour d’un intraversable et délimite une surface non-spécularisable, qui fait justement toute la spécificité du cross-cap, celle-ci ne pouvant se manifester que par cette coupure; cette partie découpée représente l’objet «a», ce qui reste devenant une bande de Moebius, représentation du sujet, d’où «l’image» du fantasme, c’est-à-dire l’articulation entre l’objet «a» et la bande de Moebius qui représente le sujet.
L’opération du transfert et de son interprétation est d’arriver, par la coupure, à faire surgir ce qu’il y a de plus spécifique chez l’individu: la structure du fantasme. L’opération de la coupure crée donc quelque chose; le transfert n’est pas de l’ordre de la répétition, il est créationniste. Créationniste, parce qu’il va faire émerger l’objet «a», qui est la marque du désir. Le désir passe donc en-deçà et au-delà de toutes les configurations cérémoniales et étatisées de la demande. Il est dans un tout autre domaine. La grande erreur des marginalistes, dont je parlais tout à l’heure, était de préconiser une nouvelle politique économique basée sur la satisfaction d’un soi-disant désir, c’est-à-dire à la fois de croire qu’on peut le susciter, et que n’importe quel objet commercial, par l’action de l’Etat, peut devenir objet du désir. Mais il faudrait essayer de mieux situer l’objet «a» dans la métapsychologie, pour en mieux définir la fonction. C’est, là encore, qu’on retrouverait le transfert, la castration, l’interprétation, et, bien sûr, le désir; il faut reprendre le problème à partir du «défaut fondamental». Ce défaut fondamental, en première approximation, c’est que le sujet, l’être du sujet, quand il vient au monde, est dans un état d’incapacité, du fait qu’il n’est pas fini. Freud insistait beaucoup sur cette dimension, il y voyait même «l’origine de la morale»: cette sorte d’infirmité fondamentale fait que le nourrisson est dépendant de ce qui l’entoure, il s’agit même d’une «dépendance vitale». Mais qu’est-ce qui l’entoure?
C’est «quelque chose» qui n’est pas neutre, et dont on pourrait dire, d’une façon un peu fantaisiste: il y a de l’être désirant… mais dont lui, l’enfant, n’est pas forcement la cible ou l’objet. Tout le travail du nourrisson va donc être d’essayer de s’articuler du mieux possible, dans un équilibre cependant toujours boiteux, avec l’être désirant; parce que, sinon, il est condamné à mort. Toute l’opération va donc dépendre de la «position» de l’être désirant. Si l’enfant vient au monde dans un milieu qui le rejette ou qui ne montre aucun intérêt pour lui, le pauvre sujet en question va en pâtir. La difficulté, c’est que ce qui est en question est une sorte de fonction entre deux termes, entre lui-même et l’Autre, avant même qu’il ne soit reconnu comme existant. Comment va-t-il pouvoir s’articuler, positivement ou négativement, ou paradoxalement, avec le désir de l’Autre? La place de l’Autre est alors tenue, de façon très massive, par ce qui se trouve là, comme être nourrissant, à tout point de vue, aussi bien alimentaire que d’ambiance. Ce qui va compliquer encore la situation, c’est que ce sujet, pas «fini», est en même temps en rapport avec la loi du langage… C’est un peu comme la lutte qu’a développée l’UNESCO contre la famine: pour lutter contre la famine, le problème n’est pas d’envoyer des céréales, mais de faire de l’alphabétisation. Ce qui veut dire que l’on est «responsable de la responsabilité d’Autrui». (Emmanuel Lévinas.) Il faut faire en sorte que l’autre puisse être responsable. Et il ne peut l’être qu’en apprenant à cultiver les céréales…
Le langage lui-même va donc apparaître à l’enfant comme un élément essentiel à conquérir; non pas à acquérir, parce qu’en fait, il est, déjà, dans le langage, et c’est même pour cette raison qu’il est venu au monde. Ce n’est pas comme dans une société animale; l’enfant vient au monde du fait (explicite ou non) qu’il y a eu contrat, un contrat d’alliance; et il fait partie d’un lignage. Or, c’est cette place dans le lignage qui va poser la question du contrat d’alliance. Il y a là tout un «texte» à déchiffrer, mais il n’en a vraiment pas les moyens. Donc, dans cette déréliction («être jeté là», comme dirait Heidegger), il y a tout un cheminement à faire, et à faire dans une certaine ambiance. Ce qui va se concrétiser en ce qu’il est lui-même un être désirant. Il faut qu’il y ait collusion entre l’ambiance, l’être désirant, et lui-même en tant qu’être désirant. Et la qualité de cette collusion va marquer son destin.
Comment l’enfant va pouvoir se débrouiller pour être «lui-même» (tout au moins comme finalité) à partir d’un tel état de dépendance vitale, aussi bien de nourriture que de langage? Bien sûr, si cette problématique arrivait à un niveau plus élaboré de son existence, il essaierait de faire passer la loi par son langage. Parler implique déjà la loi, qui essaye de s’articuler; c’est ce que Lacan appelle «la demande», laquelle est tissée de lois. Mais on est encore très loin de ce point de structure qui est la loi. C’est en ce sens que l’on peut dire (comme le dit Lacan, mais aussi les ethnologues) que ce «point» de la Loi, c’est «le désir du père». Il ne faut surtout pas voir là une dimension «machiste». Le désir du père, c’est la Loi: c’est une position transcendantale presque «perverse», mais qui est structurante et structurale. Sur ce chemin, il faudra bien que l’enfant lui-même ait un point de densité pour exister, pour ne pas rester dans une dépendance flottante. Et ce point de densité est de l’ordre de l’objet «a». Autrement dit, on va pouvoir définir le désir, non pas comme quelque chose de délimité, mais comme une fonction à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés, une fonction entre le sujet et le grand Autre.
Tout ça n’a de sens que si, topiquement, on se situe à un niveau inconscient. D’où le concept d’inconscient; car si on en fait l’économie, on tombe dans le ridicule de vouloir faire de tout ce cheminement un simple problème de communication. C’est là que je trouve intéressant d’essayer de définir ce à quoi l’être du sujet qui vient au monde a à faire, ce devant quoi il est, dans la déréliction. Le drame, c’est qu’il est totalement «naïf». Il est dans l’ignorance, il n’a aucune maîtrise… D’ailleurs, qu’est-ce que voudrait dire une maîtrise à ce niveau-là? On en reviendrait à des schémas traditionnels, qui n’aboutissent qu’à une sorte de maîtrise moïque; et pourquoi pas, pendant qu’on y est, imaginer que la technocratie pourrait gérer les rapports entre le sujet et l’Autre? La difficulté pour que l’enfant puisse exister en tant que lui-même, c’est que, avant qu’il ne se reconnaisse, il est déjà situé dans un point d’ignorance vis-à-vis de lui-même; ce point d’ignorance, c’est justement ce qu’on peut appeler son propre désir; il coïncide aussi avec ce fait que ce sujet est distinct de tout autre, par ce que Lacan appelle «le point de nomination impossible». La seule chose qui puisse le sauver dans ce cheminement, c’est d’arriver à repérer des signes, des indices, des indexs (et dans une collectivité soignante, on voit souvent resurgir des mécanismes logiques analogues). Dans cette navigation, la fonction peut-être la plus importante, c’est la fonction déictique: il faut que le sujet approche de cette fonction déictique.
Mais qu’est-ce qui va «indiquer»? C’est l’objet «a». Mais paradoxalement, pour y accéder, il faut qu’il affronte – par nécessité – le désir de l’Autre. Mais le désir de l’Autre, foncièrement – c’est même dans l’essence du désir, qui n’est pas une chose, mais une sorte de fonction – c’est la mise en acte d’un manque à être. Ce manque à être de l’Autre (incarné provisoirement par ce qui tient lieu de mère), qui est l’essence du désir de l’Autre, l’enfant va être amené à le reconnaître comme tel, mais, à ce moment-là, il doit faire le constat que l’Autre incarné «n’existe» pas. Cette non-existence va se manifester de façon éphémère, précaire: l’instant de voir. Mais par l’aperception de cette béance dans l’Autre, le sujet, qui, de façon vitale était suspendu au désir de l’Autre, va se trouver lui-même en péril, dans état de quasi non-existence. C’est le passage de l’aliénation à la séparation. Bien sûr, ce qui devrait fonctionner normalement – ce qui est rare – c’est un opérateur de cette jonction entre l’aphanisis du sujet et la béance de l’Autre. Cet opérateur, c’est l’objet «a», reste de cette opération qui va indiquer le point où ça peut se nommer: une conjonction de la loi et du désir.
Existentiellement, c’est difficile, sinon quasi impossible, d’accepter sa propre disparition apparente, en tant que sujet. C’est pourquoi il va y avoir des dérives, des masquages, de l’objet «a». C’est dans ces modalités d’évitement que l’on peut retrouver toute la nosographie: la phobie, l’hystérie, l’obsession, la perversion… Le pervers simplifie le problème en affirmant que le désir est là, en lui-même; tandis que le névrosé reste apparemment plus honnête en disant que le désir est au loin, toujours au loin: il n’est pas là, mais on y va. Peut-on dire que ce qui est en question dans l’objet «a», c’est justement ce qui est en question dans l’analyse? Chez quelqu’un qui se présente «normopathiquement», l’objet «a» -c’est-à-dire ce qui est en question dans le problème du désir – est complètement recouvert par des fantasmagories, des préjugés, des comportements, des engagements multiples, qui, la plupart du temps, sont fait justement pour qu’il n’apparaisse pas. C’est plus qu’un évitement.
Ce serait intéressant d’étudier les différents circuits d’évitement qui se mettent en place pour esquiver la mise en question du sujet quand il se trouve confronté à cette problématique paradoxale de la béance, à cette sorte de manque dans l’Autre. Par ces évitements, l’Autre peut continuer à fonctionner comme une sorte de couveuse artificielle… Cet affrontement à ce qu’il en est du désir de l’Autre nécessite une opération de «décollement», ce qui ne se fait que rarement; car quand A n’est pas incarné par une personne, il l’est par une institution, un parti politique, ou bien la religion… et le sujet y reste collé. C’est donc un problème de «clivage» – un «décollement», au sens Occamien du terme – qu’il ne faut surtout pas essayer de se représenter d’une façon positiviste. C’est dans cette même opération qu’il y a «émergence» de l’objet «a», et que le sujet se dégage de cette sorte d’infiltration imaginaire qui envahissait les chaînes signifiantes.
Ce qu’on appelle «évitement» (et il y a beaucoup de modalités d’évitement de la castration), est un renoncement à cette confrontation au désir de l’Autre, c’est-à-dire à ce fait que l’essence même du désir, c’est le manque; du fait même de son incapacité à exister par lui-même – dépendance vitale du sujet infans – le sujet a toujours tendance à vouloir qu’on l’aide, à vouloir être reconnu, à vouloir compter pour quelque chose, afin qu’il soit dans le monde, qu’il soit assuré de pouvoir vivre, parler, respirer, manger, être distinct des autres. C’est une nécessité de base: qu’il y ait quelqu’un, ou quelque chose qui lui dise: «Oui, tu es bien, tu es beau»; bien que, ontiquement parlant, ça n’ait pas de sens, du fait même que son essence, c’est d’être «parlêtre». Il ne fallait pas commencer à parler. Après, c’est trop tard. On sait bien que le problème du «langage adamique» a toujours fasciné les humains, mais ce ne pouvait pas être un langage, ce ne pouvait être qu’un «langage» de nomination, ce qui est une idée absurde, du fait de l’essence du langage: «Dès que je parle, je m’exclue, je ne suis pas dans le discours; je suis hors discours, sinon je ne parlerais pas». On ne peut pas y échapper car si on dit: «Bon, je ne parlerai plus», à ce moment-là, plus rien n’existe… Ça ne se pose même pas c’est absurde. Donc du fait que je parle, je suis exclu, mais je ne veux pas le savoir, parce que c’est trop désagréable. Alors, je m’adresse au désir de l’Autre comme étant la seule voie possible pour être reconnu. Mais ontiquement parlant, ce qui est en question, c’est justement qu’il n’y a pas de garantie.Donc, l’émergence de l’objet «a», c’est à la fois se confronter au désir de l’Autre, et c’est, du même coup, passer de A à A barré, à ce «sans garantie»; c’est la même opération. Le décollement d’avec le A incarné c’est la même chose que $, et que l’émergence du «a». Et c’est la même chose que de dire: du fait même que je parle, je ne suis pas dans le discours… Tout cela se fait du même coup. Il faut donc bien que ça s’articule quelque part…
C’est pour cela qu’il serait intéressant de suivre les petits circuits stéréotypés des différentes pathologies: du pervers, du phobique, de l’hystérique, de l’obsessionnel… afin de saisir comment ils se débrouillent pour éviter cette «jointure» négative entre le désir du sujet et le désir de l’Autre. Par exemple, on pourrait dire: «On n’a qu’à supprimer cette jointure!» C’est ce que fait le pervers; sa manière de supprimer cette jointure, c’est de s’identifier à la fente. Des auteurs américains, comme Gillepsie, qui ont étudié la métapsychologie des pervers: ceux-ci s’identifient à la fente. C’est pour ça que le désir, ils l’ont en eux-mêmes. Ça peut aller jusqu’à des fantasmagories anatomiques, le pervers va s’identifier à la vulve, clivé par les deux «battants»; et le manque, c’est alors lui-même. C’est une façon de supprimer le manque dans l’Autre que d’être soi-même ce manque… Et une sorte de désir est fabriqué par ce processus basé sur une jouissance qu’il faut aller chercher ailleurs.
C’est ce mécanisme qui est en acte chez le voyeur, l’exhibitionniste, etc.Mais, pour éviter la jointure, on peut aussi la masquer: y mettre du plâtre, ou la peindre pour ne pas la voir. C’est ce que fait le phobique. Il se débrouille pour éviter de passer devant tel «objet», croyant ainsi qu’il va éviter la jointure. Il pense l’éviter en se faisant «peur» à partir d’un objet quelconque, dont il dit: «C’est ça l’objet». Mais ce n’est pas l’objet «a». C’est le commentaire que fait Julia Kristeva de l’objet phobique, qui n’est qu’un pseudo-objet. (Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’objection.) L’objet phobique est précisément là pour permettre d’éviter l’objet «a» en se faisant passer pour lui. Et la peur suscitée par l’objet phobique va se substituer à l’angoisse liée à l’objet «a». Chez l’hystérique, le sujet fait lui-même semblant de s’identifier à l’objet phobique, c’est-à-dire qu’il se met à la bonne place pour empêcher la confrontation avec le manque.
Quant à l’obsessionnel, il fabrique une procédure très compliquée, pour faire croire que ça se passe ici; mais il se débrouille pour être ailleurs. Et du côté de la paranoïa, c’est encore un autre système; la jointure, il n’y «croit» pas.Ce catalogue, permet de situer ce qui n’est pas l’objet «a»; ces tours de passe-passe, c’est plus ou moins efficace, plus ou moins cousu de fil blanc… Parce que ce qui réapparaît toujours à ce moment là, c’est la problématique de l’objet du désir de la mère. Mais «la mère», ça ne veut rien dire; il n’y a pas de mère en soi. Il n’y a de mère que dans une filiation, dans une génération. Qu’il y ait «la mère», cela implique qu’il y a des lois d’alliance et de filiation, cela nécessite donc le désir d’un autre, le désir du père. Ce qu’on peut représenter par une fonction qui va résumer toutes les autres fonctions signifiantes: la fonction phallique (P, le phallus). Dans tous les cas d’évitement, on voit réapparaître le phallus, sous une forme dégradée, c’est-à-dire de castration sauvage. Référez-vous à l’histoire de la Comtesse de Ségur: «Gribouille»… Il pleut. Pour ne pas être mouillé, Gribouille se jette à l’eau. La suite, c’est qu’il se transforme en branche, qui flotte et va s’échouer sur la rive. Et des fleurs y poussent. Autrement dit, Gribouille se transforme en phallus. Il y a toujours une ombre de phallus à l’arrière-plan de tous ces évitements.
Mais alors, s’il n’y pas toutes ces manigances phobiques, hystériques, obsessionnelles, perverses et autres, à quoi le désir du sujet va-t-il se trouver confronté? Justement à ça, au phallus. La fonction phallique est inséparable de ce qui est en question dans le désir. La fonction , c’est dans le symbolique; mais, dans l’imaginaire, on rencontre -j. On retrouve là cette intuition extraordinaire de Freud: ce qui est en question dans tout ça, c’est la castration (-j), dit-il. Mais il faut essayer d’aller encore plus loin. Pour qu’il y ait de l’Autre, il faut qu’il y ait une loi, et la loi est représentée – non pas incarnée mais représentée – par une autre fonction, qui est la fonction paternelle. C’est la conjonction du désir et de la loi qui fait que l’Autre est le lieu des articulations signifiantes. Mais il ne faut pas pour autant se précipiter et dire que c’est une problématique de «l’ancestral», au sens mathématique du terme. Ce n’est pas tout à fait ça, bien qu’il y ait quelque chose d’analogue; ce troisième terme doit avoir une certaine congruence à cette fonction, il n’est pas simplement une petite pièce, un petit bout de truc qui va faire la jonction, une sorte de tiers entre le désir du sujet et le désir de l’Autre.
Mais cet ensemble du sujet, de l’Autre et de la «loi-désir», cet ensemble n’a de possibilité d’être que s’il met en question, s’il indique le Réel. Le Réel, ce n’est pas la réalité, le sujet n’existant qu’en tant qu’il fait trou dans le Réel. Le «tiers» doit indiquer à la fois la loi, le désir et le Réel; il est le seul capable de les articuler, et en particulier d’articuler les différentes formes de manques. Le manque est camouflé, chez le sujet, sous forme de demande, et cette demande vitale draine avec elle, caché, le désir, le propre désir du sujet. De même que le désir de l’Autre ne peut se manifester que comme manque, le manque étant l’essence même du désir. Ce troisième terme, logiquement nécessaire, c’est ce que Lacan a proposé d’appeler objet «a». Il implique une confrontation entre la loi, le désir, le Réel -dont chacun est déjà en fait quasiment inaccessible – le désir, lui-même, étant une fonction, une sorte de matrice de tenseurs.
La tendance la plus habituelle pour ne pas se donner trop de peine, pour ne pas mettre tout ça en question, c’est de trouver une conduite d’évitement. C’est d’autant plus facile que toute l’organisation de notre société est faite pour ça. Il faut bien dire que la plupart des gens vivent dans un état de boiterie extraordinaire; il leur manque des bouts, mais ils se tiennent, c’est ce qu’on appelle «les effets de groupe». Dans la pratique, on se heurte au fait que beaucoup de personnes plus ou moins «tordues» ne peuvent pas accéder à la castration, à l’objet «a». Ils «remplissent» ça par l’alcool, des toxiques, des fantasmagories, des symptômes, des comportements ridicules… Mais grâce à l’effet de groupe, ils se tiennent; on peut même quelquefois parvenir – mais en prenant quelles précautions! – à ce qu’à l’intérieur de cette sorte de prothèse groupale, il puisse y avoir une possibilité d’évolution, de dialectisation, pour que puisse apparaître quand même une problématique singulière.
Peut-on accéder à ce tiers – c’est-à-dire à l’objet «a» – sans que ne se déclenche ni phobie, ni hystérie, ni obsession, ni perversion, ni paranoïa, etc.? L’objet «a», d’une façon canonique, il est toujours là, mais camouflé, souvent énigmatique. Pour parvenir à être sujet de son propre désir sans avoir recours à toutes ces procédures d’étayage ou d’évitement, ça nécessite le dégagement de cet objet «a>, et la mise en question du grand Autre qui devient un grand Autre barré, sans garantie. C’est le chemin vers la singularité. Les poètes disent aussi: le chemin vers la solitude. Il faut bien dire que c’est la même chose…L’objet «a» ne se présente pas à l’état nu. Il est toujours véhiculé par tout un appareillage, dans une sorte de char fleuri, un peu comme dans les défilés dionysiaques, avec des fleurs, des voiles, et en même temps, le phallus qui est là.
Mais qu’est-ce qu’il y a au fond de la carriole? Si on ne se pose pas la question, la carriole risque de s’effondrer un jour, et ce sera un corbillard qui la remplacera. C’est ce qui se passe la plupart du temps. L’analyse, justement, est là pour essayer de dégager ça; et on voit bien que l’analyse est absolument inséparable du traitement de l’aliénation, de la «pathoplastie», etc., dont le but est d’éviter cette mise en question. Mais la difficulté de l’analyse, c’est qu’en fait, souvent, c’est l’analyste qui se met à incarner le grand Autre; ça demande alors toute une ascèse de l’analyste pour ne pas rester dans cette position. Bien entendu, quand quelqu’un va voir un analyste, c’est toujours dans le registre d’une demande, et l’analyste est donc toujours un «sujet supposé savoir»; tout le travail de l’analyste, c’est justement de sortir de cette position. C’est un travail énorme. Si, encore, on avait affaire à des névroses pures, des phobies pures, des hystéries pures, des obsessions pures, des perversions pures! Mais le plus souvent, c’est mélangé, et on se trouve devant des problèmes cliniques d’une complexité incroyable, encore augmentée avec tout ce qui se vend maintenant dans la société de consommation, pour «être bien dans sa peau»… Ce qui n’est jamais qu’une reprise de l’hédonisme ontique.
Pour reprendre ce que je disais tout à l’heure de la fonction tiers, il faut encore ajouter que, puisque cette fonction tiers est en connexion avec la loi, le désir, le Réel, l’objet «a» se trouve au cour de toute cette opération qui est le garant qu’il y a du désir; or, le désir, c’est ce qu’il y a de plus spécifique du sujet, c’est au plus proche de sa «singularité», dirait Guillaume d’Occam; la matière, la «hylé» de l’objet «a», doit être d’une certaine densité. Le «a», ce n’est pas un pur concept, l’objet «a» est là depuis longtemps, mais on ne sait pas que ça pourrait être l’objet «a». On peut reprendre une autre formulation – c’est en ce sens que je rappelais le marchand de Venise -: l’objet «a» est pris sur le corps, c’est comme si, dans un ensemble, on prenait un bout de l’ensemble et qu’on le mette en dehors de l’ensemble. L’objet «a», c’est ce qui n’est pas pris dans l’image. D’où l’importance de la distinction entre le moi et le sujet, entre le miroir et le point de rassemblement – que j’appelle aussi «point d’horreur» -L’objet «a» n’est pas pris dans le miroir, mais on ne peut le dire qu’une fois la problématique du miroir franchie: on retrouve là le rôle que Lacan donne au «a», au niveau des anneaux borroméens. C’est l’objet «a» qui articule le Réel le Symbolique et l’Imaginaire; symbolique et imaginaire venant ensemble dans la problématique du miroir; et le Réel est là bien avant la phase du miroir.
Bien que le symbolique, lui aussi, soit déjà là bien avant, il ne peut se manifester qu’une fois délimité le cadre, c’est-à-dire le miroir. L’objet «a», c’est quelque chose qui reste, qui ne passe pas dans l’image. C’est pour cela que Lacan dit qu’il est «non spécularisable». On peut donc le considérer comme le résultat de cette opération spéculaire; autrement dit, il est le reste d’une coupure, un effet de coupure («pathos de la coupure»). Il est évident que pour qu’il puisse y avoir une mise en fonction de l’objet «a», il faut qu’il y ait coupure, donc délimitation. Son «épiphanie» est le corollaire de la séparation. Et l’unicité, le «un» de la personne, reste le corrélat de la coupure, c’est-à-dire du trait unaire. L’objet «a», c’est la même chose que le trait unaire. Pour qu’il y ait de l’unicité, il faut qu’il y ait de l’unarité.Je dis souvent que dans la psychose, le «a» est éclaté parce que dans la psychose, il n’y a pas «d’unarité», il n’y a pas de séparation. Prendre une livre de chair près du cœur? mais chez un schizophrène, le cœur lui-même est dissocié…
Voila, mon exposé se termine…
J’espère que vous avez compris.
Lorsque vous vous retrouverez face à divers objets sexuels, tels que Godes, vibromasseurs, plugs, et autres…, vous penserez à mon texte humoristique (auquel vous vous êtes laissé(e)s prendre…) avant de vous en servir en poussant des cris de jouissances philosophiques….
Avouez que pour utiliser un Gode ou un vibromasseur, pas besoin d’être savant, de s’en laisser conter par de prétendues études universitaires, ni de croire en tout ce qu’on raconte et publie…
Quoique, en y réfléchissant bien, Lacan ne disait-il pas que…..