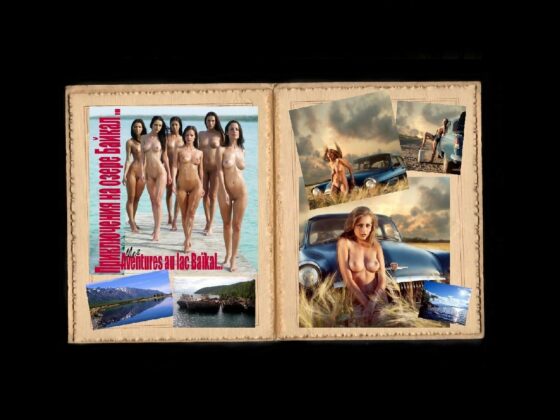Un parking derrière un immeuble centenaire… l’endroit est sinistre… pas d’éclairage… des voitures à demi désossées.
Ses talons accrochent les pavés disjoints… à force de prudentes exploration du terrain, du bout des semelles, elle parvient, vaille que vaille, à rejoindre la silhouette géante, épave sombre, de l’entrepôt quasi-abandonné.
Des fenêtres sans lumière édentent la façade en décomposition.
Est-ce la nuit sans lune qui déguise d’angoisse la bâtisse ébréchée ?
Seule une porte vitrée troue l’obscurité d’un halo blafard, phosphorescence blême diffusée par des néons tels qu’on en rencontre dans les usines qui s’abandonnent.
La cathédrale industrielle résonne des échos d’une musique qui crépite, loin, par-dessus sa tête.
Les murs blêmissent sous le fard badigeonné par les tubes à l’opalescence blanche.
S’ouvre un labyrinthe en étoile, des couloirs décolorés, boîtes à lettres, canalisations qui grimpent et escaladent les parois, tentacules gris cendre qui semblent vibrer.
Se diriger à l’oreille, suivre le tintinnabulant chahut de la fête…
Entre les orgues grises qui alimentaient autrefois les chambres froides, des femmes peintes, Vénus callipyges, déballent leurs obscènes rondeurs : des mamelles comme des courges et des ventres fécondés.
Un escalier…
Elle commence une lente ascension pour se perdre dans les dédales sournois du bâtiment.
Les murs sont couverts de graffiti colorés de tailles diverses.
Ils cèdent parfois leurs vagues calligraphiées à une Vénus Shemâle dont la virilité triomphe, agressive.
A chaque étage, des réseaux de galerie s’effilochent et se perdent sans qu’elle ose les explorer.
Les accords métalliques planent toujours et l’incite à grimper plus avant dans les entrailles de la forteresse.
A force de monter, la musique se rapproche.
Un palier, et elle l’entend, distinctement.
Un couloir…
L’ultime invitation s’accroche à une porte dont la serrurerie chatoie, éclaboussée d’ors mats.
Elle se retourne ; face à l’entrée, une fresque découpe ses bras, ses jambes, entrelacs désordonnés, des visages en quête de sexes… et des sexes sans visages.
Une pieuvre dont émerge parfois une main, un regard, débauche l’uniforme grisaille du grand corridor.
Elle sonne, en insistant, comme une affiche le suggère.
La porte s’ouvre sur un seuil tendu de velours rouge.
Dire “Bonjour” aux invités qu’elle connaît ; un sourire à ceux qu’elle ne connaît pas.
Quelques enjambées et le décor bucolique qui orne les murs l’interpelle.
Des amours dodus, aux fesses potelées, joufflues, bandent des arcs de leurs menottes piquées de fossettes.
Ils voltigent sur les ciels bleus ou blancs, cotonneux, moutonnants.
Ils s’ébattent en groupes, guettant des cibles qu’elle imagine, tendres couples étreints sur une herbe nouvelle.
Dans un angle, trois de ces chérubins épient, farceurs, quelque gracile naïade blottie derrière un coquillage nacré.
Une lumière diffuse galbe leurs bouilles enfantines.
Sont-ils anges ou démons ?
Ils exhalent la volupté perverse de ceux qui font naître des émois sensuels.
Elle songe !
Elle aurait mit un grand lit dont le coquillage aurait formé la tête ; un nid drapé de satin noir, imprégné des parfums de nudités gourmandes.
Toile de fond, enclavée entre deux fausses colonnes de faux marbre, s’étale une vallée, lumineuse comme un jardin de Toscane.
Elle oublie les relents de musique qui pulsent, elle franchit la plinthe comme on saute une haie, elle s’en va balader, elle a tant parcouru les sentiers caillouteux que ses semelles, encore, s’en souviennent, son pied connaît les rondeurs de ces pierres qui parsèment le rivière, basalte et calcaire enchevêtrés… et le ciel est si bleu, qu’il évoque la mer, troquant l’odeur de l’iode contre le parfum des herbes séchées, des arbres fruitiers, de la vigne abandonnée…, là, les montagnes découpent leurs rotondités, comme des seins trop lourds, de trop de lait, de trop d’années…., s’y nichent dans les creux, au bord des chemins, intrépides, du serpolet, la myrtille soigneusement peignée, le sureau et la fougère.
Quand la nuit s’incendie de toutes ses étoiles, si nettes, alors le silence se trouble, les bêlements des dernières chèvres laissées sauvages, à flanc de coteaux, évoquent ces légendes dont bien peu se rappellent ; quelques vieux … et elle, qui se les invente.
Retour à la réalité glauque…
Le bar, une table encombrée d’assiettes, de bouteilles, attire l’assemblée.
Elle s’approche : ça bourdonne ; ça papote ; ça marmonne.
Elle saisit des bribes de phrases, des mots en quête d’identité, creux, malades de leurs vides, des phonèmes assemblés sans soucis d’esthétique, un lieu où l’on cause, déballant, pêle-mêle, états d’âmes et considérations philosophiques, un lieu où l’on boit, s’imbibant pour se griser, s’alcoolisant pour s’amuser.
Des visages, déjà rubiconds, dévoilent leurs dentures étincelantes dans d’étranges imitations de rires, des regards, déjà brumeux, s’attardent sur des nuques balayées de boucles.
Il y a dans ces yeux avides quelque chose du boucher estimant sa bête.
Une jolie serveuse s’affaire, abeille industrieuse, offre un sourire, bise une joue, virevolte et toupille, comme une poupée sur sa boîte à musique, un verre dans chaque main.
Une arrivée : un oiseau de paradis dans une volière.
Il a troqué son éternel jean contre une éblouissante robe de marquise : dentelles noires et strass dorés.
Il ne marche pas : il glisse, cerceaux et jupons se balancent, amples ondulations des tissus qui brasillent aux éclairs des spots.
La voilette de son bibi accroche une pudeur de jeune fille à son fin visage.
Elle aime sa pupille bleu-lavande et son nez retroussé.
Il est toute blondeur et des diamants, petites étoiles enchâssées, avivent les lobes translucides de ses oreilles.
Il a de ces rougeurs de vierge !
Des paupières qui s’affolent quand elle lui murmure qu’il est belle.
Des rires cristallins, maladroits et timides quand elle dépose un baiser sur sa joue tendre.
Ironie de la nature qui fabriqua, de ce beau garçon, une évanescente demoiselle !
Elle songe à son lit de satin noir, perdue dans les brouillards bleutés des fumées de cigarettes, elle palpite faiblement.
Elle est assise et ses jambes, qu’elle a enduites de paillettes, s’irisent de rayons argentés, qu’elle s’amuse à faire serpenter le long de sa cuisse.
Des mains…
Un groupe d’hommes, de jeunes hommes, s’agglutine autour d’un pilier.
La musique clame si fort ses tempos ponctués de chants gutturaux, qu’ils ne s’entendent pas.
Commence alors une pantomime à plusieurs.
Ils conversent à grands gestes, amples et vigoureux, accentués des jeux de leurs physionomies.
L’un esquisse une cambrure, amphore grecque, pleine de chairs laiteuses, l’autre caricature quelque coquette : pruderies et chatteries.
De mines en mimiques, ils se racontent.
Une main s’est envolée, dans l’espace, à demi suspendue, une main comme l’aile d’un rapace qui se déplie…, elle retombe, inutile, démunie…, elle triture, discrètement, une couture de pantalon, une poche…, puis, courageuse, décolle à nouveau, vient se poser sur une épaule… et la main s’anime, doucement.
Elle invente un ballet, elle remonte sur la nuque, tendre et câline, elle s’attarde, alors qu’elle explore au creux des reins, s’appliquant à épouser tous les contours, elle s’aventure, plus bas encore, à la recherche des émois de l’autre….
Les demoiselles, assises près d’elle, gloussent, elles ont des rires gênés, des malaises, des regards interrogateurs ou désapprobateurs.
Les demoiselles, engoncées dans leurs tenues sages, fausses vierges, pas même coquines, se gaussent des amours masculines.
Mais elle sait bien, elle, qu’elles imaginent ces mains d’hommes sur leurs cuisses ouvertes.
Une fille, presque rousse, la peau très pâle, vêtue de rouge et de noir, avec un gros papillon posé sur son petit derrière : le noeud de sa robe ; cette fille titube.
Ivre, elle se cogne aux murs.
Elle ose des sourires comme s’ils étaient sacrilèges.
Quand la musique s’enfle, elle hasarde un pas de danse… et ses jambes, largement découvertes, s’ouvrent et se ferment aux rythmes, elle s’accroche à un bras, s’abandonne… et qu’importe que l’autre soit homme ou bien femme !
Elle mendie un baiser, offre sa bouche qu’elle a grande et mince, barbouillée de peinture, rouge, largement étalée.
A trop boire, elle se perd, incapable désormais de brider ses pulsions.
Tout lui est prétexte à sensualité.
Chatte, elle ronronne, elle frôle les peaux, arque son buste menu où pointent deux tétons.
Elle se désarticule, préservant un équilibre précaire…, elle tangue, barque dans une tempête, s’empare de mains salvatrices, se pend à des cous, se colle à des ventres…, elle, elle en voit des qui s’amusent de ces tendres excès, profitant des élans passionnés qui la jettent dans leurs bras.
Trop de bruit : une musique agressive qui réussit parfois à interrompre ses rêveries.
Trop de fumée qui pique ses yeux.
Trop de gens qui semblent s’amuser.
Une petite chinoise, fragile comme une porcelaine, enlace tendrement un grand jeune homme mince.
Une sensuelle brune dont le décolleté plonge jusques aux reins, qui ondoie aux rythmes infernaux, tortille ses fesses dessinées par une courte jupe.
La charcuterie sur la table, étalée, où s’ébattent des mains, des couteaux, des fourchettes, gueules voraces, ventres affamés.
Une file d’attente qui s’allonge, chacun attendant son tour devant les toilettes, qui pour pisser, qui pour gerber.
Une Marilyne, blonde platine, qui se déhanche, qui trépigne, qui gesticule, caoutchouteuse, élastique.
Des femmes lianes qui s’enroulent.
Des hommes roseaux qui balancent.
Des groupes compacts qui babillent : éclats de rires, éclats de voix.
Des odeurs d’eaux de toilette mélangées de sueurs, de tabacs, de nourritures et de boissons : effluves qui aromatisent l’air de leurs lentes marées.
Des jambes : une forêt de gambettes agitées de frissons, qui sautillent ; un pied décolle, un autre atterrit ; souliers vernis ou ballerines ; des bijoux qui scintillent sur des chevilles ; des genoux qui se découvrent ; des mollets qui gigotent …
Déclaration…, une petite coiffeuse, toute blonde, la tignasse coupée court, le visage poupin, éclairé d’un beau sourire ; elle danse, indifférente au grondant murmure des conversations.
Elle se fatigue… et, peu à peu, son allure se ralentit.
Une femme la regarde, qui la désire ; une femme glissée dans un tailleur masculin.
L’une a rejoint l’autre.
Et, dans un élan, l’une susurre “je t’aime”, à l’autre…, lui ensérant les poignets avec des menottes, puis fixant un collier de chien à son cou…, pour ensuite l’entrainer vers une machinerie au plus profond de l’immeuble.
Elle la plaque contre le mur qui suinte, l’odeur est poussiéreuse, il règne une noirceur de poix.
A tâtons, elle trouve la machine de forge et de volutes.
Le fer est froid…, elle est plaquée contre le métal glacial.
Et, pendant qu’elle commence à la caresser d’une main, de l’autre commence à l’attacher.
Puis, méthodiquement, ficellée, les bras et jambes écartées.
L’une est absorbée par sa tâche, l’autre commence à haleter d’être totalement immobilisée !
Son entrecuisse, déjà humide, déjà béant est exploré, doucement, doucement, doucement…
Elles écoutent le silence, les yeux dans les yeux, mais aveugles les yeux, des yeux qui se mangent et le souffle qui se perd.
Elles écoutent le rythme de l’autre et oublient les mots pour se parler mieux encore les langages du corps.
Ses reins tressaillent sous les assauts, des mains la cherchent…. et le regard de l’autre, déjà si foncé, noircit encore plus, la couleur d’un lac un soir d’été sous le soleil couchant.
Son ventre à elle se tend et sa bouche s’entrouvre.
Elle sent comme elle se perd encore plus en elle et elle s’ouvre, à vouloir être autre.
Elle parle enfin…, elle raconte comment son ventre soudain explose de mille plaisirs, comment ce frisson là éclabousse sa peau, elle implore, avec, dans la voix, une intonation qui ressemble à une prière.
Ses jambes ne peuvent se serrer, elles sont entravées.
Mais son bassin remonte encore…, elle est tendue vers elle, son sexe vibre !
Jamais elle n’avait été aussi offerte.
Une larme perle à sa paupière… et elle disparaît dans le sub-space dans une infinité d’orgasme…
C’était une histoire, vécue dans la chaleur d’une sombre nuit, de ces nuits qui se traînent dans le fond d’un verre d’alcool.
Il faut bien tuer sa misère.
Elle errait rue des blogs, guettait les lumières et observait l’un, l’une et l’autre, à leur clavier, décrire leur univers, parler des émotions tourbillonnantes de leur salle de bains !
Ces balades nocturnes, quand on passe en silence, quand on effleure les mots, alimentent les imaginations.
Cette nuit là, l’atmosphère était lourde, chargée d’orages… et tout s’en ressentait.
Les mots volaient, s’agressaient, se répondaient, certains s’alliaient pour se sentir plus forts.
Les photos s’en mêlaient et s’entremêlaient.
La musique s’incrustait, douce, chantonnait, ou d’un rythme endiablé réveillait… la vie grouillante d’une rue des blogs perdue dans l’infinie mégalopole d’un monde comme une toile tissée de cauchemars gluants…