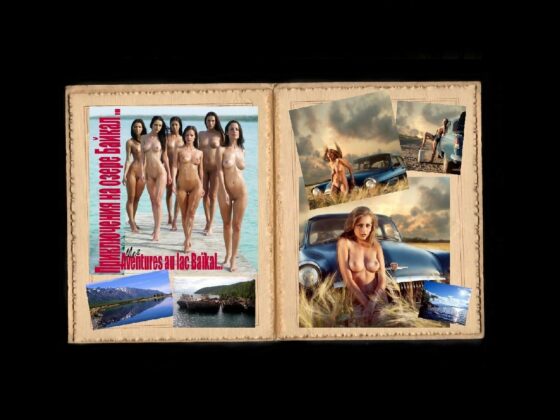Mourir, ce n’est rien quand on a vécu, quand on a goûté au monde…
Les prétextes à mes escapades banlieusardes se font rares…, je désigne un hameau au hasard sur la carte et m’y rend sans besoin d’avoir quelque chose d’autre à y faire que tout et n’importe quoi, ainsi que le faisaient certains explorateurs du XIXème siècle, en faisant tourner leurs mappemondes de bois et en l’arrêtant brusquement d’un doigt malicieux sur l’emplacement assigné par le destin.
L’écrivain, le photographe, sont des observateurs, des témoins, des historiens d’un temps donné, ils ne recherchent pas le grand frisson, sinon pour le fixer dans l’éternité.
L’intensité de ce glorieux exemple m’incite à faire de même, j’y cherche l’inspiration, me disant qu’un soutien-gorge fort bien fourni fait pardonner allègrement le sans intérêt brillantissime du médiocre, car si je suis volontiers explorateur, je suis bien plus aventurier.
L’adrénaline n’aide guère à trouver les mots qu’il faut, ni à réussir un cadrage.
Je m’offre donc un amusement futile et néanmoins friand d’expérimentations.
D’habitude, lorsque l’envie me prend, je choisis un lieu, moitié par impulsion, moitié par calcul, m’appuyant sur ma connaissance de la région avoisinante ou même de la ville elle-même.
Mais, alors que l’envie d’errance photographique me prend, il n’y a rien, désespérément rien, ni personne qui m’attire.
D’où l’idée d’aller voir ailleurs si j’y suis…
Ce n’est pas tellement plus loin que les banlieues les plus éloignées.
J’y trouve déjà plus de manifestations, mais presque toutes dans des villages ou des hameaux inaccessibles.
Finalement, je porte mon choix sur un hameau.
Il me faut moins d’une heure pour y arriver.
A peine là, je suis las… lorsque mon regard tombe sur un panneau, aux lettres étrangement dégoulinantes.
Je ressens une impression désagréable, sans trop savoir pourquoi.
En fait, cette étrange déchéance graphique est assez annonciatrice de ce que je vais voir plus loin.
La place est un immense parking glauque et désert en ce dimanche, qui donne un peu l’impression d’un terrain vague qu’on aurait hâtivement aménagé.
Sur la droite, deux étranges bâtiments se dressent au milieu des toits vétustes des habitations locales.
Ils sont horribles à voir, comme des proues de navire fantôme, comme des épouvantails de tôle et de béton.
Celui le plus à gauche doit être une sorte de silo à grains ou assimilé.
Il dresse sa rectitude de tôle vers le ciel, et malgré sa couleur beige assez sobre, il dégage quelque chose de puissamment morbide que je ne saurais expliquer.
Celui immédiatement à côté est plus effrayant encore, peut-être parce que je n’arrive même pas à l’identifier réellement.
Il tient à la fois de l’immeuble insalubre, d’une usine désaffectée et d’une prison d’un autre temps.
Quelle qu’ait pu être sa couleur d’origine, il porte aujourd’hui celle du temps qui ronge les pauvres œuvres humaines, un mélange de poussière séculaire et de noirceur de pots d’échappements, qui font de lui une épave du XXème siècle, échouée de tout son poids sur des maisons vétustes qui semblent tenir comme par enchantement… ou par malédiction.
En même temps, voilà qui me donne l’occasion d’expérimenter de nouveaux clichés.
Pour une première escapade, il faut que je tombe sur un endroit encore plus glauque qu’une ville ouvrière de banlieue.
Tout cela fait un peu le Snob qui s’esclaffe des loisirs futiles de nos amis les ploucs.
C’est un peu facile… et je répugne à tomber dans ce genre de clichés provinciaux, mais en plus sordide encore.
Pas âme qui vive pour me renseigner, pas un commerce ouvert, je suis le dernier homme sur Terre.
Je me dirige vers le centre-ville d’instinct, et je finis par croiser quelques personnes âgées errant dans la rue.
Elles me regardent toutes d’un air terrifié, me détaillant de haut en bas, comme si j’étais un fou échappé d’un asile.
L’une d’elles complètement édentée se lance dans une longue explication dont je ne saisis pas un traître mot.
Quand elle termine son laïus, j’ai l’impression d’avoir entendu du polonais.
Je n’ose pas lui faire répéter.
J’amorce un geste au hasard…, elle acquiesce…
Tous les gens que je croise me regardent vraiment bizarrement, avec crainte et incompréhension. Visiblement, je ne fais pas couleur locale.
Tous les vieillards que je croise affichent tous une vénérable calvitie et, visiblement, c’est là tout un phénomène de société !
Un peu plus loin, alors que je m’apprête à traverser une rue perpendiculaire à l’avenue principale, une voiture me bloque le passage.
La vitre du côté passager descend, et une grosse dondon en robe à fleurs qu’on croirait sortie d’un dessin de Cabu passe la tête et me crie : On cherche quelqu’un !
Je souris, et de mon ton le plus aimable, je rétorque : Je ne peux guère vous aider, je le cherche aussi !
Comme un lapin qui se serait aventuré trop loin de son terrier, la grosse femme rentre sa tête sans un mot, tandis que la voiture démarre en trombe pour aller dans une direction au hasard.
Je la regarde s’éloigner en me disant : “Quels gens charmants”.
Un homme, la cinquantaine grisonnante, chemise largement échancrée sur un torse décharné où se dessinent les côtes…
Un peu plus loin encore, sur cette avenue déserte, j’aperçois sur le trottoir une silhouette vacillante.
J’ai d’abord l’intention de lui demander quelque chose, mais je me ravise.
Sa démarche est brinquebalante, égarée.
Ses yeux se perdent dans des paradis éthyliques de lui seul connus.
D’ailleurs, il ne me voit pas.
Arrivé devant moi, il s’arrête, regarde autour de lui, puis d’une démarche curieusement plus sûre, il traverse l’avenue.
Je poursuis un instant mon chemin, mais je vois l’homme s’arrêter alors en plein milieu de la route, se frotter les yeux de ses mains pendant de longues minutes.
Je m’arrête.
Je n’aime pas trop les ivrognes, mais pas au point de les laisser en danger.
L’homme sait-il seulement où il se trouve ?
Cette avenue est aussi une départementale.
Elle est relativement droite, sans virages dangereux, mais les voitures doivent y foncer à des vitesses assez conséquentes.
En même temps, c’est ce qui doit se passer en semaine.
Là, nous sommes dimanche.
La seule voiture que j’ai vue passer, c’est celle de la grosse femme et elle est partie dans une direction opposée.
A présent, il n’y a ici que deux hommes : l’un qui regarde l’autre, et l’autre qui ne voit plus rien.
Au bout de quelques minutes, l’homme reprend sa marche.
Je me rends compte qu’il sait parfaitement où il va.
De l’autre côté, il y a un petit terrain vague confiné entre deux résidences, un terrain vague d’à peine une vingtaine de mettre carrés, aux herbes hautes, comme on en voyait encore dans la banlieue des années ’80.
L’homme s’y dirige à présent d’un bon pas, et je comprends à son empressement qu’il a un besoin urgent à soulager.
Je crois un instant qu’il va aller contre l’un des murs qui jouxtent le terrain vague, mais non, il se place à peu près au milieu du terrain vague et il commence à trifouiller sa braguette avec des gestes patauds et hésitants.
Trois minutes s’écoulent, il y est encore.
Je reste fasciné par le drame poignant et ridicule de cet homme qui, alors qu’il vient enfin de trouver le lieu où soulager une envie qui le tenaillait peut-être depuis un long moment, se trouve incapable d’ouvrir sa braguette.
Comment tout cela peut-il se finir ?
Pas bien, je m’en doute, et je ne me trompe guère.
Au fur et à mesure que ses tentatives s’enchaînent, l’homme s’énerve, et cela devient d’autant plus grave qu’il n’est même pas en état de s’énerver.
Et pourtant, d’un geste violent, il s’attaque à son ceinturon, parvient à l’ouvrir, arrache comme il peut le bouton et la fermeture… et baisse purement slip et pantalon jusqu’à ses chevilles.
Enfin, il se redresse, l’air extatique, sa vieille quéquette ratatinée offerte aux yeux du monde… et il se branle comme un malade…
Je vois alors qu’il tire son plaisir du spectacle de deux femmes qui s’embrassent, puis se deshabillent pour ensuite se lécher avec une sorte de désespérance…
Quant à l’ivrogne, il n’éjacule pas, il pisse, bon sang, il pisse les litres qu’il a si longuement ingurgités…
Les yeux fermés, le visage tourné vers le ciel, comme un saint touché par la grâce, il urine longuement, en extase.
Dans un premier temps, le jet puissant se projette droit devant lui, en une courbe harmonieuse, puis perd progressivement de sa force.
Le flot jaunâtre se rapproche alors dangereusement de son émetteur et au final, plus d’un tiers de ce que le pisseur ivre doit évacuer aboutit directement dans le pantalon qui cercle les chevilles.
Toujours tourné vers le ciel, l’homme ne voit rien du dénouement tragique de son soulagement.
Je l’abandonne là à son destin, m’épargnant la vision de son reculottage et vous épargnant, du même coup, la description rigoureuse de cette humiliation dernière.
C’est un hameau sacrément glauque.
Trouverais-je seulement un peu de beauté, d’insolite ?
Et lorsqu’un bâtiment s’en distingue, c’est pour dresser une paroi métallique qui reflète le ciel pâle jusqu’à s’y confondre, non pas pour le rejoindre mais pour s’en accaparer l’architecture.
J’essaye de m’en convaincre, mais les pavillons sans grâce qui s’enchaînent le long de l’avenue ne méritent guère le détour.
A un moment donné, alors que je marche d’un bon pas, je constate que le lacet d’une de mes chaussures est défait.
Je m’arrête donc, pour le refaire et là, j’aperçois quelque chose d’atroce qui semble être disposé là spécialement à mon intention.
Je ne crois pas au Destin, mais il est troublant de constater que si je m’étais arrêté à n’importe quel autre endroit pour refaire mon lacet, je n’aurais pas vu cela.
A quelques centimètres de ma chaussure, reposent les corps de deux oisillons, vraisemblablement tombés d’un nid situé en haut de l’arbre qui me surplombe.
Leurs petites carcasses sont à moitié dévorées par des insectes charognards, mais il semble qu’il n’y en ait même pas eu assez dans le coin pour faire disparaître les traces du drame.
Ils reposent-là, sur le bitume un peu terreux, depuis sans doute plusieurs jours, tels deux petits pantins désarticulés.
Deux jeunes moineaux, probablement… et la vision de ces deux petit cadavres me crève le cœur à un point difficilement supportable.
C’est une nouvelle étape de mon voyage, même si je suis bien conscient qu’il n’y a pas qu’ici que les oisillons tombent des nids.
Il n’empêche, après le spectacle de la déchéance, me voici nez à nez avec la mort… et dans ce qu’elle peut avoir de plus odieux, de plus injuste, de plus inutile.
Je repense à ceux qui croient tant en Dieu et militent activement contre le massacre animalier fait par l’homme.
J’ai envie de leur montrer ma photo, de leur dire : Vous accusez l’homme, mais regardez ce que la nature est capable de se faire à elle-même. Regardez ce que votre Dieu d’amour et d’harmonie, auquel vous croyez corps et âme, regardez donc ce qu’il est capable de faire ou de laisser faire !
Mourir, ce n’est rien quand on a vécu, quand on a goûté au monde.
Mais périr ainsi, à quelques semaines d’existence, d’une mort horrible et idiote, qui ne profite à personne, c’est seulement ignoble.
J’en ai les larmes aux yeux, mais il n’est rien, rien que je ne puisse faire, sinon me rebeller intérieurement contre ce mauvais sort, puisque si l’homme est un assassin comme tous les animaux, il est aussi capable de se révolter contre les ordres établis, il est le seul être qui peut refuser, même si ce refus ne redonne pas la vie et n’empêche parfois même pas de la perdre.
Mais face à ces deux petits corps abandonnés, l’humanisme n’est pas plus de secours que la littérature.
J’ai envie de tout arrêter et de repartir chez moi.
Je suis triste à présent.
Je me fais cependant violence.
Je n’en suis encore qu’au début de mon voyage et ce n’est pas bien de me décourager aussi vite.
Il faut toujours aller au bout des choses, au bout de soi-même.
On ne regrette réellement au fond que les choses que l’on n’a pas faites.
A une intersection, se trouve un calvaire comme on en voit souvent en Bretagne ou en Normandie.
Dans un pays où on se glorifie d’interdire les signes ostentatoires de religion, où l’on fait la chasse impitoyable au foulard coranique et à la burqa, je m’étonne toujours qu’on tolère encore des crucifix géants plantés aux carrefours de nos campagnes.
C’est bien plus gênant pour l’œil, et largement plus propagandiste.
Vu que je me trouve sur le trottoir de droite, le christ de fer me tourne le dos.
Vu d’un certain angle, il se confond avec le poteau électrique situé juste devant lui.
Je parlais de rébellion plus haut.
Celle contre Dieu est assurément la plus belle, même si elle n’est jamais que la révolte de l’homme contre la création d’autres hommes pour asservir les masses.
Le symbole reste efficace et j’en tire une photo finement irrévérencieuse.
Au bout de la rue, je distingue un amoncellement de voitures garées.
Je souris.
J’ai enfin trouvé.
C’est bien, j’ai assez vite envie d’en finir.
Lorsque j’ai fait le tour, je m’arrête prendre un casse-croûte à la petite buvette locale…, elle est tenue par une association de retraités pas très diligents quand il s’agit de servir le client.
L’un d’eux porte un tee-shirt hallucinant, avec le dessin d’une bouteille de Ricard et écrit au-dessus : Je protège la couche d’eau jaune.
No comment…
A l’autre bout de la table, deux vieilles dames obèses posent sur moi leurs regards vides, assez comparables à celui des vaches qui regardent passer les trains.
En face d’elles, deux vieux beaufs aux visages patibulaires me jettent eux un regard plus ouvertement hostile et bombent instinctivement le torse, tels des coqs de combat parés à l’attaque.
Entre eux et moi, une cinquantaine de centimètres jalonnés par des canettes vides.
Eux dégustent de la bière tiède dans des gobelets en plastique.
Je les observe à la dérobée.
C’est la France profonde dans toute son absence de splendeur.
La France de Michel Sardou et Mireille Matthieu, du Petit Rapporteur et des Jeux de 20 heures.
La France dont je suis issu et dont je me suis acharné à me dégager pendant toutes ces années.
La France qu’on trouve touchante quand on regarde les vieux documents de l’INA et qui nous fait vomir quand on se trouve immédiatement à côté.
La France qu’on préfère savoir morte pour pouvoir enfin vivre.
Autour de nous, vrombissent des guêpes, attirées par la nourriture et les boissons sucrées.
L’une d’elles tourne autour de la canette vide de Coca-Cola qui se trouve non loin de moi.
Elle finit par s’y poser et rentrer à l’intérieur.
Le beauf immédiatement à ma droite a alors un mouvement d’humeur il saisit la canette dans son gros poing, la soulève et la frappe violemment sur la table.
L’insecte s’en échappe avec empressement.
L’homme me regarde et me dit alors : Y’a une guêpe qui était rentrée !, comme si cette constatation justifiait à elle seule son geste stupide et brutal.
Son visage porcin affiche une belle couleur rosée, qui ne doit certainement rien au Coca-Cola.
Son regard brille d’une excitation alcoolisée.
Je ne lui réponds rien.
Il n’y a rien à répondre à un con.
Le beauf qui a vidé son gobelet de bière, le retourne sur l’insecte avec un rire bête, qui se communique rapidement à ses trois comparses.
La guêpe, hélas pour elle, est tenace et réapparaît rapidement sur l’autre bout de la table.
Prisonnière sous la cloche de plastique, la guêpe tente de s’envoler, mais se cogne aux parois de plastique où qu’elle aille.
Les quatre vieux en rigolent à s’en décrocher le dentier.
La vieille aux lunettes noires est particulièrement hilare.
Le beauf pose sa grosse main sur le verre et se met à le frotter rapidement sur la table en riant.
Terrifiée, la guêpe ne parvient pas à suivre le mouvement, les bords du gobelet lui arrachent des pattes.
Je me lève, je crois que je vais vomir si je reste à cette table.
Ceci dit, mon sexe a plus de ressources que je le pensais, car en passant devant un bureau étrangement ouvert, tenues par deux femmes plutôt souriantes, je décide de m’en offrir une, voire les deux.
Les deux femmes doivent avoir entre 25 et 30 ans.
Elles portent toutes deux les cheveux mi-longs, blonds, un reliquat de coupe new wave années ’80.
Elles sont très amicales, je leur dis que je viens de loin.
Ca les impressionne un peu, venir de si loin pour rien.
Celle à ma gauche, semble atterrée : Par cette chaleur, vous avez du courage !
Elle me rend mon sourire tout en me tendant la main.
Je la prend et elle me dit alors d’une voix plus douce : Vous repartez à quelle heure ?
La question m’étonne un peu, mais j’y réponds sans ambiguïté : Je n’ai pas encore décidé…
La femme semble précocement épuisée par la baise qu’elle imagine.
A moins que ce ne soit une déception pudique ?
Toujours est-il qu’elle m’indique fort aimablement les rues à prendre pour arriver chez elles…
Cette rue est évidemment déserte, mais il faut croire que le reste de la semaine, elle est assez fréquentée, car bien des voitures y sont garées et il se trouve même un propriétaire de pavillons qui y fait un petit trafic de pneus…
Je redescends jusqu’au croisement et je coupe une longue rue étroite qui descend en pente douce avant de remonter vers la butte sur laquelle se trouve la vieille ville.
Une rue perpendiculaire débouche à un moment sur la droite, il s’agit probablement d’un croisement dangereux, car on a implanté sur le trottoir opposé une sorte de miroir courbe, joliment orné d’un cadre blanc traversé de rayures noires en diagonale, qui permet à chaque conducteur de voir ce que font les autres voitures sur la route perpendiculaire à la sienne.
Évidemment, c’est ce miroir qui m’intéresse, qui semble régner en maître, tel un œil pédonculaire, sur cette partie de la route.
L’isoler de son contexte, le photographier sous un certain angle, permet de le transformer en écran psychédélique, en accessoire à la fois pop-art et inquiétant, digne de la série “Le Prisonnier” avec Patrick McGoohan.
Il en résulte une situation étrange, comme je les aime…
Alors, peut-être bien qu’à ce moment, sans vraiment m’en rendre compte, je bascule de l’autre côté du miroir, dans un hameau parallèle, très différent de celui dans lequel j’errais jusqu’ici.
Au fur et à mesure que j’avance, les pavillons façon Bouygues laissent la place à de vieilles maisons de pierre et le vert même des arbres me semble plus intense.
Je suis en train de passer d’une bourgade terne et morte à une cité médiévale, pleine de vieilles pierres, de verdure et de papillons.
Il me semble alors que je sors du cauchemar de la médiocrité ambiante.
D’ailleurs, une vieille bâtisse qu’on croirait sortie d’un roman de Marcel Proust est là pour me le confirmer.
Je suis de retour dans un passé sans avenir…
Sous mes yeux, c’est l’ébauche d’un pan d’histoire qui se dessine, et qui me laisse sur ma faim, sans espoir d’en savoir plus.
J’ai d’autant plus à cœur de m’en rappeler que bien des gens qui pratiquent, comme moi, le regard en arrière jusqu’à en faire l’un des thèmes récurrents de sa production artistique et littéraire, se laissent parfois assez facilement séduire par les idéaux de l’époque sans réaliser que sur ce point-là, l’évolution que l’on a connu depuis a été libératrice et que s’il est bien une chose dont il ne faut avoir ni regret ni nostalgie, c’est du carcan moral que dictait l’élitisme chrétien et la haine des différences.
Juste à côté, se dessine un hideux crucifix marron qui me rappelle insidieusement que le passéisme a son revers, et que je suis encore dans une époque où, malgré la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la barbarie chrétienne est encore active et où aucun de mes écrits n’aurait pu être publié sans que j’y risque ma tête.
Pourtant, encore aujourd’hui, bien des nostalgiques s’y abandonnent, en partie sous l’influence d’écrivains comme Gabriele d’Annunzio, Barbey d’Aurevilly et surtout Léon Bloy, ce dernier tristement sorti de l’oubli par un Maurice Dantec à peine moins siphonné que son modèle.
Bloy est sans doute le plus sordide catholique extrémiste que nous ayons jamais eu en France, ses ouvrages représentent à mon sens la pire déchéance dans laquelle un écrivain puisse tomber.
Aussi malgré la fascination pour les temps anciens et la beauté dont on savait enluminer chaque objet de la vie, il ne faut jamais oublier que cette beauté servait une mauvaise cause et que le christianisme, comme toutes les religions, est une spiritualité dangereuse, viscéralement mauvaise et qui alimente encore aujourd’hui de nombreuses sectes et groupuscules malsains.
La croix est le meilleur ennemi de l’homme.
Face à moi se dessine une montée de vieux pavés, une ruelle d’un autre âge, qui m’apparait comme une invite.
Une rangée de vieilles maisons borde le côté gauche de cette montée, certaines ont la porte d’entrée au ras du sol, y opposant la verticalité de leurs seuils.
Il semble que le sol les tranche en biais, avec ironie.
La pente est plus raide qu’il n’y paraît, et les pavés très anciens, polis par les pluies, disjoints par le temps, sont de dangereux obstacles.
Je plains les éventuelles jeunes filles en talons aiguilles qui s’aventureraient sur ce chemin pavé de mauvaises intentions.
La montée débouche sur une nouvelle rue perpendiculaire qui amène cette fois-ci vers le vieux village.
Et là, je change véritablement d’univers.
Envolés, les bâtiments glauques du XXème siècle industriel, je me retrouve dans un bastion médiéval encore vaillant.
Certes, la rue qui y mène possède des commerces, mais il serait audacieux de parler de modernité.
Ou alors d’une modernité en difficulté.
Déjà le distributeur voisin, auquel je retire de l’argent, ne me donne ni un billet de 20€, ni deux billets de 10€, mais carrément quatre billets de 5€.
Je sens bien que quelque chose n’est pas normal, par ici…
Le cinéma, par exemple.
Le petit cinéma des jeunesses, où tant d’ados locaux ont dû risquer leurs premiers baisers…
On sent bien qu’il n’a pas vraiment bougé depuis les années ’50… et que la jeunesse actuelle ne doit pas s’y bousculer avec la même saveur qu’auparavant.
Mais après tout, pourquoi donc perdre son temps au cinéma, alors qu’il y a tellement de films à se faire rien qu’en parcourant le vieux quartier de la ville, celui d’où tout est parti, le village originel ?
La rue débouche sur un terre-plein verdoyant, qui se trouve être l’orée d’un petit bois assez charmant…, mais le terre-plein est occupé par une fête foraine en train de s’installer.
C’est donc un véritable village de caravanes et de roulottes que je traverse, non sans une certaine curiosité. Certaines attractions sont déjà ouvertes.
Les stands de tirs, les jeux divers et la quasi-absence de visiteurs n’empêche pas la fête de se mettre en place.
Les auto-tamponneuses sont en service, même si, au final, il n’y a que deux véhicules en piste, ce qui limite tout de même pas mal le plaisir du carambolage.
Un petit train, représentant une chenille colorée au sourire schizophrène, est également déjà au travail, suivant la boucle de ses rails avec une totale précision mécanique.
Il n’y a guère que deux personnes à son bord, à peine le double de spectateurs et l’attraction dégage un sentiment assez dadaïste.
Quand j’approche, les visages se ferment et les regards se détournent.
Sentent-ils, ces gens-là, toute l’ironie qui suinte de mon regard ?
C’est bien possible, après tout…
Je finis par m’éloigner de la fête foraine, suivi par des regards intrigués et hostiles.
On se demande ce que je fais-là.
Je ne dois pas avoir la tête à faire du manège.
Mon appareil-photo est suspect, il donne mauvaise conscience à des individus qui ne devraient pourtant pas se sentir coupables.
Ils sentent juste que je suis d’un autre monde et comme beaucoup trop de gens, ils n’aiment pas l’idée qu’il y ait d’autre monde que le leur.
En marchant vers le petit bois, je croise une jeune fille rousse, assez jolie, qui promène un petit chien, genre chihuahua ou pékinois.
Alors que l’on va pour se croiser, son regard vert sombre me fixe, de manière inexpressive mais néanmoins appuyé.
Arrivé à son niveau, je lui adresse un sourire amusé et je me retourne ensuite sur elle.
Elle aussi se retourne et me sourit.
Mazette !
L’amour m’attend !
Qui l’eût crû !
Je poursuis mon chemin, en me disant que peut-être la jeune fille va me chercher, le soir, à la fête foraine, mais je n’y serai pas, puisque je serai retourné chez moi.
Je me dis aussi que peut-être m’aura-t-elle oublié d’ici les dix prochaines minutes.
Cette perspective-là me séduit déjà moins…
Je jette un dernier regard sur la fête foraine et je me dis que finalement, je n’ai jamais connu de flirts dans ce genre d’endroit.
Voilà ce que c’est que de se la jouer intellectuel marginal !
Voilà l’essentiel de mon tableau de chasse.
Alors que j’étais à peine sorti de l’adolescence, plan mobylette avec une jeune fille, rencontres en boîte de nuit, câlins sur le siège arrière d’une voiture, baisers échangés avec des rockeuses chics, des filles à papa débridées, des intellectuelles perverses…
Mon premier flirt était journaliste-speakerine à la radio télévision belge, ma première vraie petite amie est devenue une illustratrice renommée.
Je ne peux même pas me demander ce qu’elles sont devenues.
C’est bizarre, la vie, l’amour, toutes ces choses qu’on s’imagine choisir dans nos jeunes années et qui ne sont souvent hélas que les seules que nous soyons capables d’accomplir.
Du coup, il me viendrait presque l’idée de rester, d’essayer d’emballer cette fille, ce soir, de lui offrir un tour de manège, de grande roue, de train fantôme.
De l’embrasser dans un wagon de manège, entre deux bouchées de barbe-à-papa.
J’aimerais qu’elle remonte ma main vers ses seins, si elle s’égare trop bas.
Et moi, je ne sais pas, j’aurais un perfecto cuir, un jean bleu, et un tee-shirt blanc.
Ils portent encore le perfecto, les jeunes d’aujourd’hui ?
Je ne suis pas sûr.
J’aurais la clé de ma mob dans une poche et un cran d’arrêt dans une autre, pour le cas où je tombe sur des gars de la bande à machin…
Je souris intérieurement.
C’est dur de rester sérieux quand on a le goût pour inventer des histoires.
Et puis je réalise le côté un peu condescendant de ma rêverie.
Fantasmes, petites nostalgies sincères à la base, mais dès que j’essaye d’y mettre plus de corps, je me rends compte que je ne suis pas fait pour ces plaisirs trop simples.
J’ai du mal à sortir de mon personnage, il y a trop longtemps que je le vis.
En même temps, ça me chagrine.
Je pense souvent que c’est lorsque l’on ne sait plus être quelqu’un d’autre que soi que l’on commence réellement à vieillir.
A un moment, je me rends compte que je ne sais même plus de quelle direction je viens.
Perdu dans mes pensées, je continue à marcher sur le chemin dans le petit bois sans trop faire attention à là où je vais… et fatalement, je m’égare.
Voilà qui est fâcheux…
Le chemin sur lequel je me trouve débouche sur un panorama fort sympathique qui me laisse entrevoir les limites du hameau et la nature environnante.
C’est très joli, mais ça ne me dit pas où je suis.
Je commence donc à m’inquiéter, à me demander si je ne suis pas en train de sortir de moi-même. D’autant plus que juste en dessous de mes yeux, il y a une petite ferme presque rustique où paissent des vaches brunes, qui me regardent avec un air à peine plus bovin que les autochtones de la fête foraine de tout-à-l’heure.
Spectacle ô combien bucolique et reposant, mais qui ne me rassure en rien quant à mes capacités à ressortir dans un futur proche de ce bourbier rural.
Et puis, dans le silence profond de ce petit bois, j’entends alors très distinctement le bruit du passage d’un train, quelque part devant moi, un peu sur la droite.
Et ce bruit, telle la madeleine de Proust, me ramène à des souvenirs lointains, de ma prime enfance, dans une petite ville de province.
Depuis le portail du jardin, où enfant, je me tenais pour regarder passer les quelques voitures, les quelques gens, qui apparaissaient dans ma rue comme des accidents du silence, j’entendais régulièrement, de très loin, le passage d’un train.
Quand le portail m’était ouvert et que je pouvais avancer sur le trottoir, je pouvais voir, parfois, tout au bout de la rue, le train traverser le paysage.
C’était un de ces vieux trains sombres à compartiments.
La gare de la ville n’était pas très loin, alors ils roulaient à une vitesse mesurée.
Suffisamment vite pour qu’on entende le chant de leurs essieux, suffisamment lentement pour que je puisse les détailler de mon regard d’enfant.
Et le train, là-bas loin, déchirait de son passage l’inertie du temps.
Quand on repense à son enfance, c’est qu’on est toujours un peu au bout du voyage.
Rebrousser chemin, d’accord, mais pas en reprenant les mêmes rues.
Avec un peu d’effort, le retour en arrière peut devenir une nouvelle façon d’avancer, d’explorer.
C’est presque l’essence même de la vie.
Un peu plus loin, sur la droite de la rue, un mur de pierre s’ouvre sur un nouveau bois plus sombre…, clôturé de toutes parts par un mur, empli d’arbres touffus et aux feuilles larges, le bois distille une ambiance un peu morbide…, un bois qui, même en été, a des couleurs de faits divers, pourtant, il y a de grands chemins, balisés par des panneaux invitant le promeneur à faire sa petite gymnastique du dimanche.
Je devrais me sentir rassuré, avoir l’impression qu’un coach invisible s’occupe de moi.
Hélas, il n’en est rien.
Même les silhouettes dessinées sur les panneaux, créées pour stimuler le mouvement, ont quelque chose de figé et de cadavérique.
Petit à petit, je laisse le bois derrière moi et je descends une grande avenue dont le nom m’échappe.
A un moment donné, je tombe sur un petit square discret, situé en pente entre deux rues perpendiculaires.
Du moins, ma première impression est celle d’un square, mais il s’agit en fait d’une petite place établie autour du Monument aux Morts.
L’ambiance y est à la fierté nationale et à un culte assez grotesque de la gloire à donner sa vie pour la patrie : A nous le souvenir, à eux l’immortalité…
Je ne sais pourquoi cette phrase m’évoque les corps sans vie des deux oisillons aperçus quelques heures plus tôt à mon arrivée.
Faut-il être odieux comme un militaire pour qualifier la mort d’immortalité !
Le lyrisme cache mal ici la misère des intérêts politiques qui a mené à leur dernière demeure de pauvres gens qui n’avaient rien à faire sur un champ de bataille.
A une époque où nos politiciens se sentent suffisamment désœuvrés pour réfléchir à la façon de redorer notre identité nationale, il n’est pas mauvais de se souvenir à quel usage privilégié servait encore cette identité nationale, il n’y a pourtant pas si longtemps.
Donner sa vie, pour que d’autres conservent la leur, quelle que soit l’issue d’un conflit…
On devine à quel point l’idée a pu plaire suffisamment à nos édiles pour qu’on en fasse, durant de si nombreuses années, la plus éclatante des vertus.
Néanmoins, vivre et mourir pour la France, c’est surtout une manière de ne pas vivre pour soi, de faire don de son existence à des gens qui, eux, ne la sacrifieraient pour rien au monde.
Avec comme cadeau bonus pour les sacrifiés consentants, l’assurance d’avoir son nom gravé sur un monument comme celui-ci, dont pourront librement s’enorgueillir tous les orphelins, même s’ils eussent préférés ne pas l’être.
Je me demande ce que pourraient penser tous ces hommes, morts pour avoir combattu le Nazisme, s’ils voyaient le magnifique ouvrage d’architecture fasciste que l’on a édifié pour honorer leurs mémoires…
Je note les croix autour du flambeau…
Encore des croix, sans doute la guerre n’a-t-elle été qu’une lutte fratricide entre les croix gammées et les croix non gammées…
On sait rendre hommage dignement aux grands hommes qui ont fait l’histoire et aux esprits éclairés de la civilisation occidentale.
Je descends le square et arrive dans une grande rue en pente douce qui porte le nom d’un général américain, auquel la France voue un certain culte au regard de son aide précieuse…, il avait effectivement suffisamment massacré d’indiens et d’autochtones philippins lors de ses brillantes campagnes du début du siècle pour avoir accumulé une expérience hors-norme dans l’art très prisé du génocide organisé.
Aussi, cette très longue rue a-t-elle été baptisée du nom de ce grand homme que sa propre nation a hissé au rang de mythe en donnant son nom à un char d’assaut et à un missile offensif.
La rue poursuit ainsi son chemin vers le nord de la ville, bordée par de nombreuses luxueuses propriétés, dont l’une et pas la moindre, n’est autre que la gendarmerie, assurément le plus champêtre établissement policier qu’il m’ait été donné de voir.
Et c’est sur la vision presque idéale cet étrange cottage procédurier que se termine ma promenade, sur une touche nettement plus colorée et sympathique qu’elle n’avait commencé.
Le temps de déguster un verre au seul bistrot du coin qui soit ouvert, qui annonce lui aussi sur ses murs, avec une immense fierté la venue prochaine de superstars.
A ce moment-là, je ne suis sur de rien.
Le hameau est très contrasté, désagréable dans ce qu’il a de déplaisant, ordinaire dans ce qu’il peut avoir d’attractif.
Reste la bizarrerie de ce contraste, ajoutée à l’étrange lumière pâle, vaguement grisâtre, de cette journée du mois d’août.
Il y a quelque chose à sauver de ce parcours que je me suis imposé… et c’est justement là que mon travail d’écriture doit intervenir, pour tisser en un coloris distinct ce patchwork de couleurs dépareillées.
Lectrice, lecteur, toi qui a eu la patience de me suivre dans cette épopée immobile et jusqu’à ce point final du récit, j’espère humblement ne pas trop avoir raté mon essai et t’avoir fait voyager entre deux airs, entre deux temps, comme une sirène le ferait entre deux eaux… ou un chacal entre deux os…