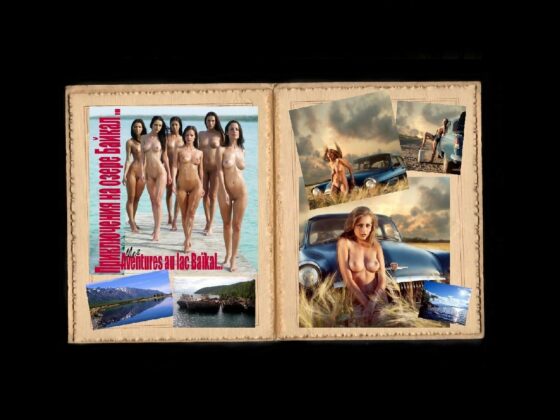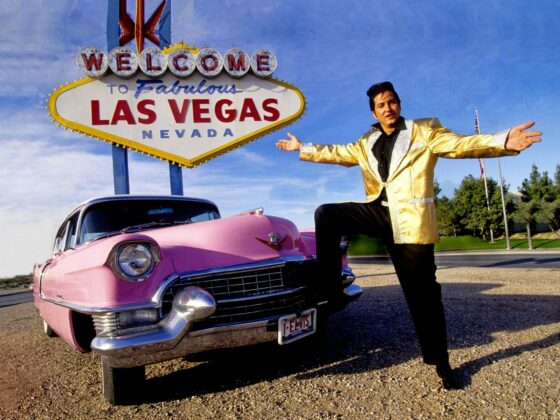Je suis au Belize, dans un resto au bord de la mer; un homme se penche vers moi et éructe une question. « Comment définiriez-vous “blasé” ? », fait-il avec un accent new-yorkais, au moment où je termine mon repas.
Toujours heureux d’avoir un synonyme au dessert, je pense à “pessimiste”, mais propose « Quelqu’un qui a tout vu »…
Le Ricain se tourne vers sa compagne, une fine beauté Maya qui me regarde du coin de l’oeil : « Et comment dit-on “blasé” en espagnol ?», lui demande-t-il.
« Américain ? » susurre-t-elle, moqueuse… en me faisant une oeillade !
Tout le monde se paie une pinte de bon sang, suivie du vrai dessert, de quelques conversations décousues et finalement des cahots du retour en bateau à mon hôtel de San Pedro, l’île même dont Madonna rêvait dans La Isla Bonita.
L’eau est noire comme de la réglisse et le courant, puissant ; quand enfin nous débarquons, nous avons tous un petit air de pirates en détresse et un look à mourir !
Mon hôte, le génialement nommé Bobby Dhillon, semble s’amuser comme un petit fou.
Ce sikh passé par le Japon et Calgary, du genre à n’avoir que des cadets comme soucis, m’a fait venir dans ce petit pays, pour me montrer son petit paradis insulaire.
Ce grassouillet archimillionnaire en shorts orange vif a beau avoir fait fortune dans l’immobilier, son âme se trouve ici, au Belize, où il a acheté cette île de 930 ha il y a une dizaine d’années.
Depuis, c’est bien pour dire, le Belize est devenu à la mode, l’investissement de Dhillon s’est mis à rapporter et Leonardo DiCaprio s’est acheté une île à deux encablures d’ici.
Dhillon, si populaire au Belize qu’il a été nommé consul général honorifique, s’empresse au cours des jours suivants de me faire découvrir ce havre sauvage mais ravissant.
« J’ai un croco domestique », m’informe-t-il en me faisant faire le tour du propriétaire et de la bestiole. « Imaginez des tables sur le sable ici, là des lampes polynésiennes », ajoute-t-il plus tard, en me montrant la pointe de l’île, où il projette de construire un chic bar-restaurant.
Je comprend que ce pays, planté comme un nez entre les yeux du Mexique et du Guatemala, puisse fasciner un homme à la recherche d’un royaume.
Tissé de cultures diverses (Mayas, pirates anglais, anciens esclaves indiens, et même quelque 3000 mennonites dans un coin), l’ancien Honduras britannique est non seulement beau, mais il est aussi paisible. Selon Dhillon, cette torpeur découle de ce qu’« aucun groupe n’est majoritaire ».
Et de ce que Henry Ford n’a jamais entendu parler de ce lieu : les moyens de transport préférés semblent être les bateaux et les voiturettes de golf.
« J’aime cet endroit parce qu’il y a un préposé aux voiturettes », mentionne Dhillon.
Qu’est-ce qui pousse un homme à acheter une île ?
Un matin, je déjeune avec Dhillon sur la plage de sable blanc où viennent mourir les vagues purificatrices.
Attablé pour le repas le plus important de la journée, mon hôte sort une carte du pays et, à l’aide de sa fourchette, se met à pointer par-ci, à piquer par-là.
C’est alors que je comprends.
Oui, cette île est son joujou, mais il ne l’a pas achetée comme il le ferait pour la première Porsche venue.
C’est clair, cet homme souffre du syndrome de Robinson Crusoé.
Comme Johnny Depp, qui s’est payé une île dans les Bahamas pour se remonter le moral, ou l’influent Canadien Tyler Brûlé, ex-rédacteur de Wallpaper, qui en a acquis une en Suède il y a quelques années, ou encore l’excentrique lord écossais Glenconner, rendu célèbre pour avoir acheté Mustique dans les années 1950 et l’avoir transformée en repaire d’aristos, Dhillon est au fond un voyageur romantique, même s’il nourrit des projets d’entreprise, son inspiration est poétique.
À l’heure d’Internet, dans un monde où tout est interdépendant, l’appel d’une île à soi est plus irrésistible que jamais.
C’est du moins l’impression que me donne Dhillon en jouant de la fourchette sur la plage.
C’est aussi pourquoi on ne rencontre pas beaucoup de blasés au Belize…, sauf moi !